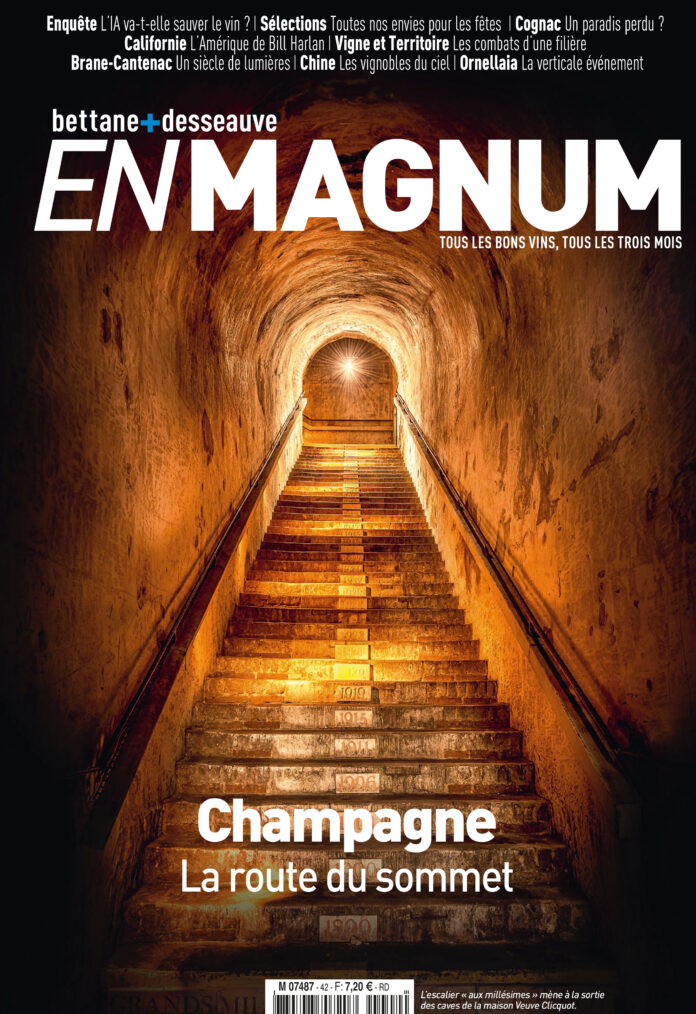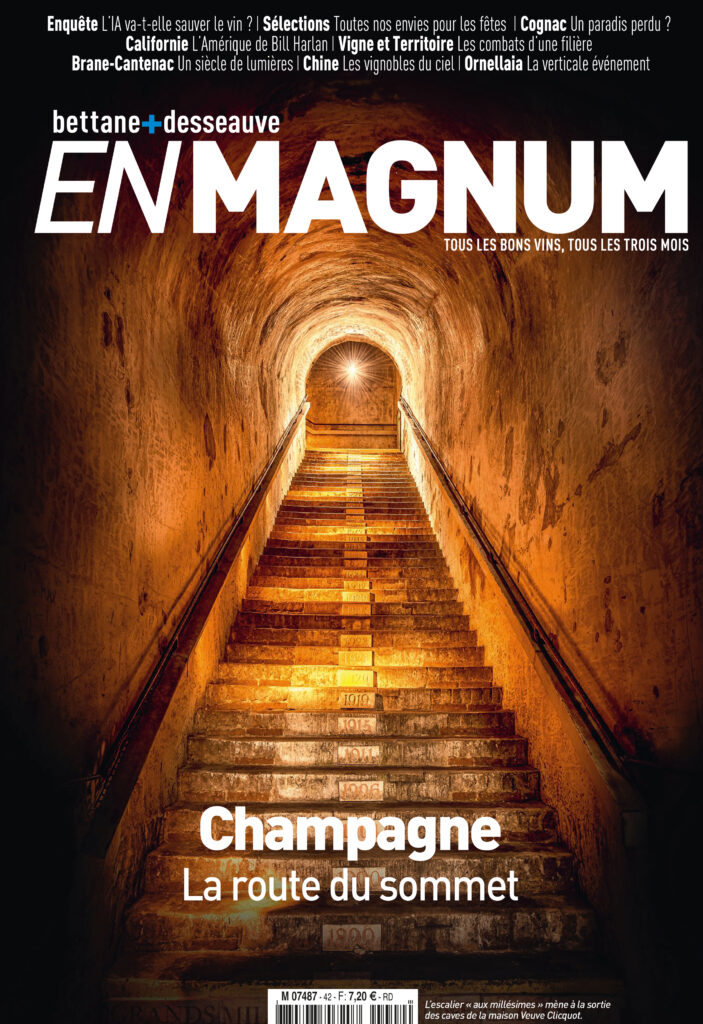Le peuple des vignes* a vingt ans. Ou deux mille, selon le point de vue que l’on prend. Il a vingt ans, pour vous et pour nous, parce que nous fêtons cette année la double décennie du Grand Tasting Paris et que la confiance fidèle que nous font chaque année les meilleurs producteurs de France et du monde pour venir présenter leurs créations nous remplit de joie et de fierté. Il a deux mille ans (bien plus, en fait) parce que la civilisation du vin est à la source d’une culture méditerranéenne qui a traversé les époques et les continents. Il a vingt ans à nouveau, puisqu’au cours de ces vingt dernières années, comme il l’avait fait au cours des vingt précédentes, il a vécu plusieurs bouleversements de son écosystème et de ses fondations mêmes. On en citera ici simplement deux, chacun explosif dans ses conséquences. Le changement climatique est le premier d’entre eux, mettant à bas les pratiques séculaires de la viticulture et de la vinification certes, mais imposant plus encore à chaque vigneron une responsabilité personnelle face à l’avenir de la planète. Le chambardement des modes de consommation ensuite, mêlant injonctions sanitaires, air du temps, moments instagrammables et rejets de modèles sociétaux anciens, fait plus que réclamer de nouvelles stratégies marketing ou commerciales, il interroge sur l’essence même du métier de vigneron. Dans ce monde pris de vertige, que fait le peuple des vignes ? Il revient à l’essentiel, à l’immuable dimension de son métier. S’attacher à sa terre, à sa plante, aux aléas du ciel, à son talent personnel pour incarner ce triptyque immémorial, et comprendre la demande de son client, de son marché, de son époque. Ce métier a des racines profondes, mais aussi une capacité de se réinventer qui peut servir de modèle à notre société tout entière.
*. Pour reprendre l’expression si belle et forte de notre ami Régis Franc.