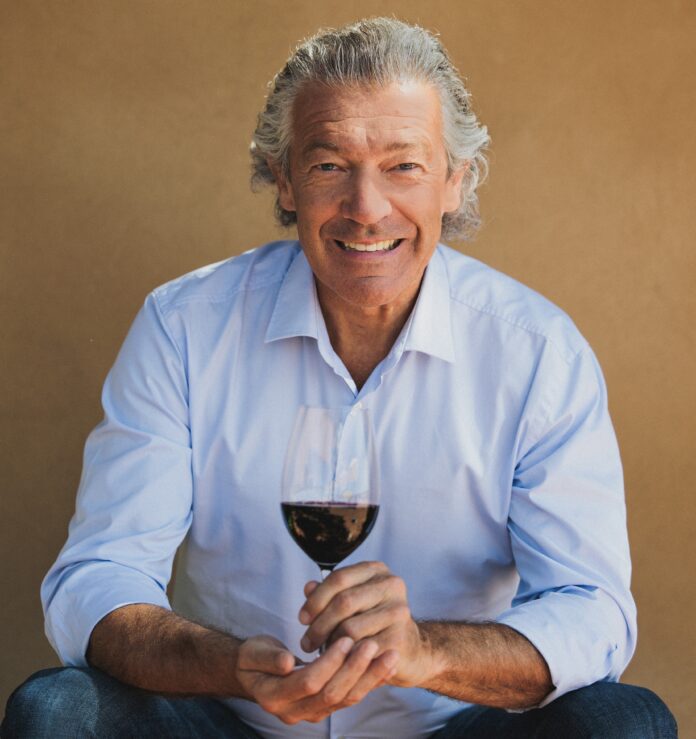Prendre son destin en main
Ce principe est inscrit dans la genèse de Nicolas Feuillatte. Au cours des années 1970, la Champagne a connu de grandes difficultés en termes de stockage des vins. Pour nombre de viticulteurs, c’est un événement qui a été vécu comme un traumatisme : beaucoup ont pris conscience qu’ils ne maîtrisaient rien ou presque. C’est à ce moment-là que la Champagne a décidé de s’organiser et s’est équipée d’outils techniques performants et de capacités de stockage adaptées, tout en apprenant des pratiques œnologiques de plus en plus sophistiquées. Progressivement, nous avons réussi à maîtriser ces aspects et nous nous sommes aperçus que nous étions capables désormais de créer notre propre marque. Henri Macquart avec d’autres pères fondateurs, a créé Nicolas Feuillatte, en 1976, avec la volonté de suivre une feuille de route simple : s’appuyer au quotidien sur une viticulture et une œnologie de précision pour proposer des champagnes qui répondent aux goûts des consommateurs. Son développement a ensuite été porté par toutes les qualités qu’on lui reconnaît : une vision globale, l’ambition de toucher une clientèle très large, une ouverture à l’international, et bien sûr, l’utilisation comme ambassadeur de Monsieur Nicolas Feuillatte lui-même. Aujourd’hui, plus de cinquante ans après, Nicolas Feuillatte encadre plus de 500 pressoirs et accompagne 6 000 vignerons, soit une présence sur plus de 2 500 hectares en Champagne.
S’engager pour rendre durable ses savoir-faire
Notre mission est d’assurer un revenu pérenne pour les adhérents vignerons qui nous accompagnent. C’est comme ça que nous cherchons à rendre plus forte notre démarche collective. C’est une vision à long terme, qui voit au-delà des résultats immédiats. Cette perspective est possible grâce à la transparence de notre management avec nos adhérents. Eux sont face à leur avenir, maîtres de leur territoire et de la mise en marché de leurs raisins. Ce sont des acteurs pleinement impliqués. C’est un modèle d’entraide, de solidarité et d’interdépendance, où les décisions sont prises par des vignerons pour des vignerons, toujours dans un sens qui favorise leurs intérêts. Avec Nicolas Feuillatte, nos champagnes s’adressent à toutes les clientèles et sont présents partout dans le monde, où rayonne de manière collective le savoir-faire de nos adhérents. Nous sommes au service de la Champagne, en portant un message d’excellence et en restant attentifs à ce qui peut affecter la valeur de cette marque si forte. Dans cet esprit d’universalité, nous veillons au bien-être de nos adhérents, de nos salariés et de l’ensemble du personnel. Notre organisation, à taille humaine, accorde une importance particulière à la dimension personnelle. C’est l’une des caractéristiques les plus essentielles du modèle coopératif.
Participer à la défense de notre territoire
Nous sommes présents dans tous les grands secteurs de la Champagne : la montagne de Reims, la côte des Blancs, la vallée de la Marne, la Côte des Bar, le Sézannais, le Vitryat, etc. Cette vision complète du territoire champenois nous permet d’avoir un modèle hybride, au cœur de la stratégie de Terroirs & Vignerons de Champagne. C’est ce qui nous a conduit à développer nos activités. Nous sommes engagés dans la voie de la « Viticulture durable en Champagne », un référentiel spécifique à notre région. Nous avons travaillé avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie pour réfléchir à la dimension cruciale de la gestion de cette ressource. Nous sommes aujourd’hui le plus grand acteur bio en Champagne et nous accompagnons les vignerons qui souhaitent adopter cette approche. Nous les soutenons tout en restant ouverts aux apprentissages et aux pratiques des autres. Mais avant tout, nous sommes attentifs à maintenir un maillage familial de l’ensemble de l’écosystème champenois.
Former et agir pour être compétitif
Nous intervenons auprès de nos adhérents, notamment sur le plan de la formation. Nous leur proposons un panel de services, offerts pour la plupart. Beaucoup sont réalisés en interne et recouvrent différents domaines : la transition environnementale, la transformation numérique, des aides à l’export, etc. Nos techniciens, nos ingénieurs agronomes et nos œnologues se mobilisent pour répondre à leurs questions, dans une optique de transmission. C’est essentiel, surtout dans une région comme la Champagne, où les métiers ont beaucoup évolué. Nous organisons des sondages auprès de nos adhérents pour connaître leurs attentes et essayons, dans la mesure du possible, d’y répondre. C’est un processus intégré dans notre fonctionnement. Chaque année, nous organisons des rendez-vous auprès de nos vignerons autour de sujets techniques, notamment liées à la viticulture. Nous sommes à l’initiative d’une conférence annuelle « Vignoble et Qualités » qui rassemble les acteurs du secteur et durant laquelle nous réunissons des techniciens, des adhérents et des jeunes en formation. C’est un moment de transmission auquel nous convions aussi des étudiants à venir partager et apprendre à nos côtés. Nous avons également mis en place « TEVC Avenir », un groupe destiné aux vignerons de moins de 40 ans. Chaque année, nous leur proposons d’étudier une thématique spécifique et de réaliser un voyage d’étude afin de mieux comprendre le marché mondial, les dynamiques du secteur, etc. Nous avons aussi donné les moyens à chaque chef de cave de prendre en main le destin de sa maison respective. Cela nous permet de maintenir cette agilité, avec des caves conçues différemment à Chouilly pour Nicolas Feuillatte ou à Reims pour Abelé 1757, par exemple. Terroirs & Vignerons de Champagne est le seul groupe hybride de ce type, qui peut aujourd’hui raconter quatre histoires différentes de la Champagne avec quatre maisons différentes (Nicolas Feuillatte, Castelnau, Henriot et Abelé 1757). C’est un modèle unique avec des structures spécifiques et un message propre à chacune. Cela n’existait pas avant nous. Notre mission est aujourd’hui d’affirmer ces messages selon les consommateurs, en prenant soin de respecter l’histoire et les engagements de chacune de ces quatre maisons.