 Pommery, l’art de recevoir
Pommery, l’art de recevoir
« J’ai voulu ce domaine comme un livre ouvert, ouvert sur le monde, sur le temps. Laissez-y votre marque comme moi-même j’y ai imprimé à jamais la mienne. » Ce souhait pour l’avenir est celui de l’avant-gardiste Madame Pommery, qui lança dès 1874 le premier brut, puis ouvrit sa maison au public, mêlant déjà vins et œuvres d’art en cave. De nos jours, l’audace de la maison reste intacte. Cinquante hectares au cœur de la ville, une fabuleuse architecture néo-élisabéthaine et, sous nos pieds, soixante crayères gallo-romaines où, au milieu des cuvées, résonnent chaque année les créations contemporaines des Expériences Pommery. Plus de 300 artistes y ont dialogué avec la craie, les volumes, le silence. En surface, la Villa Demoiselle, joyau Art Nouveau accueille jusqu’au 15 juin 2026 de Merveilleuses Demoiselles, éclosion de peintures, sculptures et installations du XIXe siècle à nos jours pour les 40 ans de la cuvée Demoiselle. Enfin, au Réfectoire, le décor arty de Fabrizio Borrini magnifie les assiettes du chef Philippe Moret, qui rejoue les grands classiques.
Le + : Diverses visites thématiques ou visite privée sur mesure. Boutique proposant toute la gamme, des cuvées emblématiques aux éditions millésimées, dont la toute dernière collection 2025 Mexico.
Vranken-Pommery Monopole
5, place du Général Gouraud, 51100 Reims
Tél. : 03 26 61 62 56
vrankenpommery.com

Collery, une maison réinventée
Longtemps considérée comme une belle endormie, Collery, 132 ans, renaît avec éclat sous l’impulsion de Nicolas Gueusquin. Depuis 2014, cet ingénieur agronome amoureux de sa région renoue avec l’esprit d’ouverture de l’un de ses prédécesseurs, Alain Collery, qui inaugura le premier musée du champagne à Aÿ dans les années 1970. Porté par son credo, « Qui aime le vin le sait vivant », il a entrepris la rénovation d’un hôtel particulier du XIXe siècle pour accueillir les visiteurs. Chaque espace (atelier, caveau, salons) célèbre les terroirs de Collery, tous 100 % grand cru. Un show convivial, autour des « blend » et « single » ou des nuances du dosage. Face au parc, le bar à champagne dégaine ses planches chics (charcuteries, fromages, caviar) et sa déclinaison de coings (fruit cuit, confiture, pâte) cueillis sur le cognassier du jardin. Pour les soirées d’hiver, le Ratacrush (ratafia, tonic, zeste de citron) est idéal. À l’apéritif, se glisse un avant-goût de fête avec le blanc de noirs salin, taillé pour un canard rôti, ou la cuvée Empyreumatic 2015, rêvée avec du foie gras. Quatre chambres d’hôtes, du cottage anglais à la chambre de maître, plus une maisonnette autonome, offrent une hospitalité chaleureuse, avec un verre de bienvenue.
Le + : Box repas (entrée, plat, dessert) livrée sur demande et réalisée par un chef rémois en accord avec trois cuvées et le ratafia. Rooftop privé avec vue sur le clocher d’Aÿ et les coteaux d’Épernay.
Champagne Collery
7, rue Jules Lobet, 51160 Aÿ
Tél. : 03 26 56 86 68
les-chambres-collery.com
 Taittinger, jeux de couleurs
Taittinger, jeux de couleurs
En juin, au cœur du siège historique de Saint-Nicaise à Reims, naissait Polychrome., une table d’un nouveau genre où l’art de l’assemblage se met en scène dans l’assiette comme dans le verre et où chaque convive devient acteur d’un repas interactif. Guidé par les couleurs, les textures et les saveurs du chef étoilé Charles Coulombeau, chacun combine ingrédients et condiments multicolores (miso kumquat, pistache, yaourt fumé menthe, moutarde Earl Grey) selon ses goûts et son inspiration. Cette « table d’assemblage » s’inscrit dans une aventure complète aux côtés des visites des crayères gallo-romaines renfermant les vestiges de l’abbaye Saint-Nicaise et du concept store Chromatique, où créateurs et bulles se répondent. Polychrome, c’est aussi le mariage réussi entre une architecture contemporaine et l’âme des lieux, avec un décor qui s’ouvre sur un parc paysager conçu comme un tableau vivant. Chaque saison, un nouveau chef réinterprètera à sa manière cette polychromie, pour une aventure gustative toujours renouvelée, selon le vœu de Vitalie Taittinger : « Venez jouer et que le beau se joigne au bon ! ».
Le + : Deux visites autour des cuvées Comtes de Champagne, l’une consacrée au rosé et un « instant gourmet » où le tour des caves se conclut avec des bouchées travaillées par le chef Philippe Mille.
Champagne Taittinger
9, place Saint-Nicaise, 51100 Reims
Tél. : 03 26 85 84 33
taittinger.com
 Roger Coulon, une bulle familiale
Roger Coulon, une bulle familiale
À Vrigny, flanc nord de la montagne de Reims, depuis neuf générations, la famille Coulon taille, vendange, élève, dans le respect farouche de l’écosystème. Aujourd’hui, Isabelle et Éric sont épaulés par leurs enfants Edgar et Louise pour faire chanter en bio leurs six cépages (pinot noir, meunier, chardonnay, blanc, gris, petit meslier) sur 115 parcelles en premier cru, plus une pépite de chardonnay en grand cru à Chouilly. Ici, pas de dégustation lambda, mais une plongée sensible et personnalisée dans les caves monumentales : pressoir, chai, vinothèque, cathédrale souterraine et découverte des cuvées phares comme L’Hommée et Esprit de Vrigny. Le vin se met aussi à table lors de visites privées avec accords mets-champagnes. L’été, la « Table des vignes » s’installe en plein coteau. Pour ceux qui veulent aller droit à l’essentiel, la dégustation « Au cœur des bulles » donne en quarante-cinq minutes et quatre champagnes premier cru les clefs de l’esprit Coulon. À deux pas, Le Clos des Terres Soudées, manoir XIXe rénové avec chic, peut accueillir douze hôtes entre chambres cosy, salons de lecture, jardin. « Un patrimoine flamboyant sur une terre d’exception pour une escale de charme authentique », dixit Isabelle.
Le + : Près du vignoble, escapade nature dans les forêts domaniales de Verzy, connues pour leur biodiversité et les mystérieux faux de Verzy.
Champagne Roger Coulon
12, rue de la Vigne du Roy, 51390 Vrigny
Tél. : 03 26 03 61 65
champagne-coulon.com
 Besserat de Bellefon, la french touch
Besserat de Bellefon, la french touch
Après avoir aménagé son nouveau siège il y a un an dans une demeure classée du XVIIIe, Besserat de Bellefon, B.B. pour les intimes, met les petits plats dans les grands pour ceux qui veulent vivre son univers 24 heures sur 24. Depuis plus de 180 ans, la maison cisèle un champagne aux bulles de dentelle, 30 % plus fines que la moyenne. Elle peaufine aujourd’hui son sens de l’accueil. Dans l’ambiance feutrée du bar, on vient s’initier aux mythiques cuvées des Moines, escortées de caviar, puis flâner entre objets d’art de la table. Nathalie Doucet, la présidente, souhaite que chaque verre soit « un moment inoubliable ». Cette parenthèse enchantée se prolonge à huis clos, dans trois suites au luxe discret : « Brigitte Bardot », clin d’œil à l’égérie dont elle partage les initiales, « Victor » qui salue le créateur de la cuvée des Moines, et « French Touch », modulable. Bois nobles, tissus précieux, kitchenette et accès sécurisé, tout est pensé pour se sentir « comme chez soi ».
Le + : Cinq expériences de dégustation dont la Gourmande, trois champagnes (2018, 2013 et Cuvée des Moines 2012) assortis de foie gras et pata negra. Boutique, bar avec terrasse.
Champagne Besserat de Bellefon
5, rue Jean Chandon-Moët, 51200 Épernay
Tél. : 03 26 78 52 11
besseratdebellefon.com
 Ruinart, un océan sous la craie
Ruinart, un océan sous la craie
Il y a un an, la doyenne des maisons champenoises (1729) révélait la métamorphose de son site historique. Face aux façades XIXe, le pavillon de Sou Fujimoto se dresse comme une bulle de pierre et de verre, baignée de lumière. Gwenaël Nicolas y a imaginé une atmosphère feutrée, entre lin poudré et flacons en apesanteur. Tout autour, un jardin de 7 000 m² libre d’accès trace un chemin entre sculptures contemporaines et biodiversité. Les enjeux climatiques se racontent aussi en sous-sol. À vingt mètres de profondeur, pour les dix ans d’inscription des crayères à l’Unesco, Julian Charrière a créé Chorals. Un bassin scintille, les sons d’océans disparus résonnent dans la craie, la Champagne retrouve son lointain passé marin. L’art est aussi ici celui du savoir-faire, dévoilé pas à pas : remuage manuel, assemblages ciselés, millésimes rares (du 1926 à la cuvée Blanc Singulier, témoin d’un climat en mutation). De retour à la surface, cap sur le bar by Ruinart où Valérie Radou et Arnaud Donckele orchestrent accords mets-champagnes, cocktails au shiso, brunchs dominicaux, dîners d’exception, déjeuners du week-end, braseros des vendanges, etc.
Le + : À partir de fin novembre, tea-time de Noël au champagne et apéritif de collectionneurs. Prochain dîner signé Arnaud Donckele le 5 décembre, sur réservation uniquement.
Champagne Ruinart
4, rue des Crayères, 51100 Reims
Tél. : 03 26 77 51 51
ruinart.com
 Moët et Chandon, halte impériale
Moët et Chandon, halte impériale
Sous la craie d’Épernay, vingt-huit kilomètres de caves à dix degrés abritent des trésors. On y découvre secrets d’élaboration et anecdotes historiques tout en savourant le brut et le rosé Impérial, étendards d’un style inimitable. Pour le grand frisson, on décline des millésimes de la cuvée Grand Vintage (depuis 1842, il y a eu 77 éditions, et 46 encore en version rosé). On admire aussi le fascinant dégorgement « à la volée » avant d’aborder quelques nectars de plus de quatorze ans. Aujourd’hui, Moët s’appuie sur 1 300 hectares, le plus vaste des vignobles champenois façonné par près de 500 vignerons. Après l’ombre des caves, cap vers la lumière du bar Moët, situé face à l’avenue, puis celle de l’exposition Memories of Tomorrow, où l’héritage de la maison se retisse en œuvres brodées contemporaines. Une fresque de Daniel Arsham mêle aussi hier et demain avec sa résine évoquant la craie et l’usure.
Le + : Collection éphémère de fin d’année au bar et au centre de visite. « Habits de Lumière » d’Épernay du 12 au 14 décembre avec spectacles lumineux, feux d’artifice et bars éphémères.
Champagne Moët et Chandon
20, avenue de Champagne, 51200 Épernay
Tél. : 03 26 51 20 20
moet.com
 De Venoge, dans l’intimité des princes
De Venoge, dans l’intimité des princes
Dans son hôtel particulier Belle Époque, classé à l’Unesco, De Venoge ne manque pas de panache : salons cossus, jardin à l’anglaise, vinothèque aux trésors. Dans la cour, Louis XV nous salue de sa flûte et de sa plume qui, en 1728, signa le décret autorisant le transport du champagne en bouteille, lançant son succès mondial. À l’intérieur, l’histoire reprend vie, celle d’Henri-Marc de Venoge – fondateur en 1837, pionnier de l’étiquette illustrée en Champagne – puis de ses successeurs, à qui l’on doit deux icônes, les cuvées Cordon Bleu et Princes, jadis réservées aux cours d’Europe. Dans l’ancienne écurie transformée en bar, nos papilles se lancent dans une course royale. On passe en revue les couleurs et styles de Cordon Bleu (brut, rosé ou blanc de noirs), on succombe au charme des quatre Princes, on s’émerveille d’un Louis XV 2014. Le tout en brillante compagnie : charcuteries fines, saumon fumé champenois d’artisan, caviar. Pour ceux qui veulent s’attarder, les « suites du 33 » sont l’ultime privilège avec des appartements privés sur la plus célèbre avenue du vin au monde.
Le + : Boutique avec la gamme De Venoge, dont la nouvelle cuvée Louis XV rosé et son parfum assorti, Louis XV 1722, signé Xerjoff. Du 12 au 14 décembre, bar éphémère dans la cour durant l’événement Habits de Lumière.
Champagne De Venoge
33, avenue de Champagne, 51200 Épernay
Tél. : 03 26 53 34 34
champagnedevenoge.com
 Bollinger, deux cents ans d’exception
Bollinger, deux cents ans d’exception
Cette icône restée familiale depuis 1829 s’entrouvre tel un carnet intime. Les visites, limitées à douze personnes et sur réservation, lèvent le voile deux heures durant sur un savoir-faire spécifique et une saga ayant défié modes et époques. Les milliers de vieux tonneaux, gardiens d’une vinification sous bois rare en Champagne, exhalent le parfum du temps long. Les millésimes patientent ici deux à trois fois plus longtemps que l’appellation ne l’exige. En dégustation finale, les millésimés R.D. (« récemment dégorgé » créé par Madame Bollinger) ou Grande Année, révèlent une élégance charpentée (le pinot noir est la colonne vertébrale du style Bollinger), écho d’une fascinante épopée. Celle d’Athanase de Villermont, Jacques Bollinger et Paul Renaudin, le trio fondateur, puis de Madame Bollinger, figure de l’après-guerre. Pour le bicentenaire, en 2029, un nouveau chapitre se prépare : rénovation du site, aménagement de la demeure Élisabeth (boutique, salles de dégustation) et transformation de la maison Dueil en hôtel, restaurant, piscine et spa.
Le + : À deux pas, Pressoria, très instructif centre d’interprétation sensorielle installé dans un ancien centre de pressurage de Pommery, où explorer l’univers du champagne, de la vigne à la flûte.
Champagne Bollinger
20, boulevard Maréchal de Lattre, 51160 Aÿ
Tél. : 03 26 53 33 66
champagne-bollinger.com
 Veuve Clicquot, deux siècles d’audace
Veuve Clicquot, deux siècles d’audace
Et toujours la même envie de casser les codes. Comme le fit Madame Clicquot, grande dame de la Champagne qui inventa le remuage et, en 1877, osa l’éclat tonique d’un jaune solaire, devenu signature. Depuis, la maison trace sa route, fidèle à la conception de sa fondatrice (« Une seule qualité, la toute première ») et surtout à son envie d’étonner. Chaque visite devient une aventure. On se promène des vignes de Verzy aux crayères cathédrales (vingt-quatre kilomètres de galeries), du pinot noir tutélaire aux dégustations qui racontent une histoire (Brut Carte Jaune, L’art du vieillissement, La Grande Dame). À deux pas, le café Clicquot réserve aussi son lot de surprises. Sunny Burgers, ravioles champagne-miso et camembert rôti au champagne bousculent les papilles et s’apprécient avec les cuvées servies en flights (trois verres à comparer). Au fil des saisons, l’expérience se décline : au printemps, Garden Gastronomy avec cueillette au potager en permaculture de Verzy et Grande Dame en magnum ; en été, pique-nique rosé sur les pelouses du manoir ; en automne, cochelet champenois ; en hiver, un dîner qui flamboie à la manière Clicquot.
Le + : Côté boutique, art de la table, coffrets et objets, certains personnalisables (Arrow, Ice Jackets, Cooler, porte-bouteille molletonné, etc.) et nouvelle édition limitée de La Grande Dame 2018 signée Simon Porte Jacquemus.
Champagne Veuve Clicquot
1, rue Albert Thomas, 51100 Reims
Tél. : 03 26 89 53 90
veuveclicquot.com
 Nicolas Feuillatte, le temps retrouvé
Nicolas Feuillatte, le temps retrouvé
On le repère de loin, ce vaisseau ondulant au toit qui imite les coteaux champenois, dont les parois vitrées ouvrent sur la vallée de la Marne, la montagne de Reims et la côte des Blancs. Ici bat le cœur d’une coopérative pas comme les autres et de ses 5 000 vignerons (un sur trois en Champagne). Incarnant un « luxe émotionnel », la nouvelle expérience Chronothèque, limitée à huit personnes, se tient chaque vendredi de 17h30 à 19h30 dans l’intimité de la cave privée. Au son du jazz, passion du fondateur, et guidé par Guillaume Roffiaen, le chef de cave, on effleure les bouteilles au design perlé, on touche la craie, on l’écoute même chanter. Puis on se prête au jeu d’identifier à l’aveugle fruits et épices, signatures olfactives des chardonnays et pinots noirs qui composent, à parts égales, le cuvée au cœur de l’expérience, Palme d’Or Chronothèque, vieillie dix ans minimum, vingt pour les magnums. Enfin, vient l’exercice ultime, déguster, décrypter et comparer quatre millésimes.
Le + : L’expérience Chronothèque peut inclure l’organisation d’un dîner gastronomique à la Briqueterie. Atelier Efferv’&Sens, boutique avec pour les fêtes (Chronothèque Palmes d’Or 2002 en magnum et coffret en édition limitée).
Champagne Nicolas Feuillatte
Plumecoq, CD 40A, 51530 Chouilly
Tél. : 03 26 59 64 61
nicolas-feuillatte.com
 Perrier-Jouët, la belle époque pour l’éternité
Perrier-Jouët, la belle époque pour l’éternité
Depuis 1811, Perrier-Jouët impose un style. Pierre-Nicolas Perrier et Rose-Adélaïde Jouët, botanistes accomplis, ont choisi le chardonnay pour signature, offrant à leurs cuvées une délicate harmonie florale. En 1902, Emile Gallé appose sa griffe avec ses fameuses anémones du Japon, encore présentes sur les flacons. Ce lien intime avec la nature irrigue chaque expérience proposée. Le Cellier Belle Époque, bar à champagne lumineux et entouré de verdure, donne carte blanche à Sébastien Morellon (croquetas au jambon des Ardennes, cavatelli à la courge rôtie, etc.). La Maison Belle Époque, pour sa part, abrite l’une des plus belles collections privées d’Art Nouveau d’Europe, signé Guimard, Majorelle, Rodin ou encore Toulouse-Lautrec. C’est aussi une scène gastronomique menée par Pierre Gagnaire et interprétée par Sébastien Morellon autour des cuvées Belle Époque. Chaque année, un artiste dialogue avec cet héritage. En 2025, Marcin Rusak, designer polonais, s’est inspiré des plantes axiophytes poussant dans les vignobles de Perrier-Jouët. Plant Pulses, son installation multisensorielle, permet d’entendre leur langage secret.
Le + : Boutique-jardin avec l’ensemble des cuvées, mais aussi des objets exclusifs, personnalisables en quelques minutes, et le coffret de Blanc de Blancs signé Marcin Rusak.
Champagne Perrier-Jouët
26, avenue de Champagne, 51200 Épernay
Tél. : 03 26 54 27 29
perrier-jouet.com







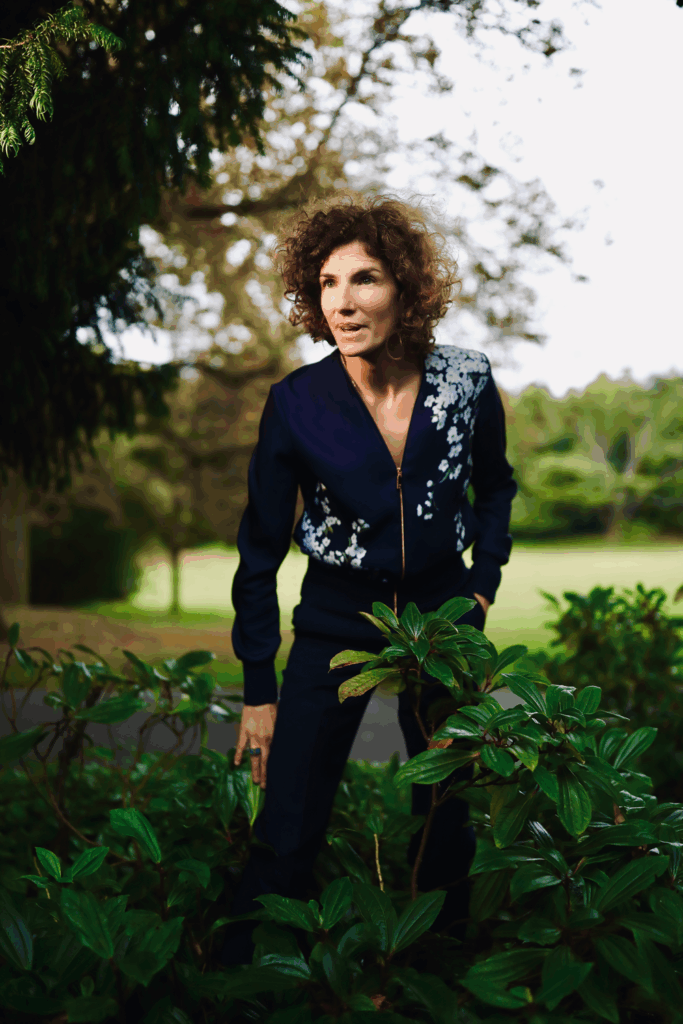










 Pommery, l’art de recevoir
Pommery, l’art de recevoir
 Taittinger, jeux de couleurs
Taittinger, jeux de couleurs Roger Coulon, une bulle familiale
Roger Coulon, une bulle familiale Besserat de Bellefon, la french touch
Besserat de Bellefon, la french touch Ruinart, un océan sous la craie
Ruinart, un océan sous la craie Moët et Chandon, halte impériale
Moët et Chandon, halte impériale De Venoge, dans l’intimité des princes
De Venoge, dans l’intimité des princes Bollinger, deux cents ans d’exception
Bollinger, deux cents ans d’exception Veuve Clicquot, deux siècles d’audace
Veuve Clicquot, deux siècles d’audace Nicolas Feuillatte, le temps retrouvé
Nicolas Feuillatte, le temps retrouvé Perrier-Jouët, la belle époque pour l’éternité
Perrier-Jouët, la belle époque pour l’éternité