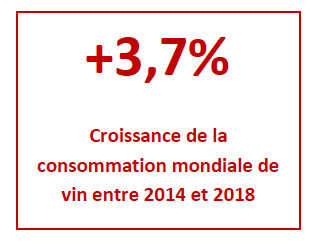Amalgaire, Claude Jobert, le docteur Marion,
Napoléon et les autres.
La grande et la petite histoire de ce cru d’exception…
L’histoire du cru
Je ne suis pas historien et ce qui suit dépend largement de sources livresques comme le livre du docteur Lavalle , écrit au milieu du 19e siècle mais surtout du livre indispensable de Jean-François Bazin (Le Grand Bernard des vins de France), lui-même descendant de propriétaires d’une partie du cru. Je n’ai ni sa verve ni sa profonde connaissance de la saga du village de Gevrey mais je pense réunir ici des faits de façon plus claire et plus organisée autour du concept de cru. Je ne souhaite qu’une seule chose c’est qu’un historien local, à partir d’une nouvelle lecture des textes le concernant, se serve du Chambertin, sans doute la vigne de Bourgogne la plus documentée, comme modèle historique de la notion de cru.
Un cru c’est à la fois une vigne, un vin, une réputation commerciale liée à sa qualité, et ensuite seulement une place dans une hiérarchie par rapport aux crus voisins.
Commençons par la vigne, qui en Bourgogne est à la fois un climat, c’est-à-dire une situation précise sur un coteau, dont la nature du sol, l’exposition modèle le vin, et un lieu-dit, c’est-à-dire un nom. L’histoire de la vigne et celle du nom sont souvent décalées. Commençons donc par la vigne.
Nous savons par des fouilles qui ont permis par exemple de retrouver à Gevrey (au lieu-dit Carougeot) des restes de bains de villa gallo romaine, que les Romains ont certainement planté de nombreuses vignes dans le secteur sud de Dijon. Au sixième siècle de notre ère Grégoire de Tours parle de nombreuses vignes de cette région et de leur nectar qu’il compare à celui de Falerne, modèle historique de tout grand vin dans l’antiquité romaine. Au même moment ou presque, en 640, nous savons qu’Amalgaire, duc de Bourgogne, cède une vigne à Gevrey à la toute jeune abbaye de Bèze. Bèze est une petite bourgade au nord-est de Dijon qui n’a sans doute jamais vu de vignes et les moines de l’abbaye ont certainement choisi ce coteau de Gevrey pour sa capacité à produire du bon vin. Bèze conservera le cru jusqu’en 1219, finissant après de longues querelles au chapitre de Langres, qui possédait déjà l’église de Gevrey. Lors de cette cession la vigne achetée est certainement ceinte de murs et possède même une chapelle construite en 1155.
Contrairement à une image bien ancrée dans le public, les moines et encore moins les chanoines, ne travaillent eux-mêmes leurs vignes mais les font cultiver à bail par des vignerons locaux. Les vicissitudes de l’histoire et certainement les changements climatiques (nous n’avons rien inventé) conduisent à des périodes de prospérité puis de déclin. C’est le cas au début du 17e siècle, avant le réchauffement intense du climat sous Louis XIII, où un bail de 1627 signale que la plupart des vignes d’un clos qui désormais couvre exactement sa surface actuelle (14 à 15 hectares) sont en friche. Ce bien ne rapportant rien, on assiste alors à une sécularisation progressive de ces vignes, par le moyen de baux à cens annuels et perpétuels, passés entre l’Église, propriétaire et des fermiers appartenant à la noblesse de robe. Ainsi, en 1627, Langres loue le clos à un certain Claude Jomard, avocat au Parlement de Bourgogne. Ce bail se transforme en 1651 en bail à cens perpétuel. Autant dire que le fermier devient inexpugnable malgré d’innombrables procès avec les propriétaires. Après Claude Jomard on retrouve comme fermier un Chevignard (le nom est encore bien connu aujourd’hui, porté par le grand chancelier des chevaliers du Tastevin), puis un Perreney de Vellemont, puis enfin le fameux Claude Jobert de Chambertin qui commence par être simplement Claude Jobert. C’est le premier à réunir sous le nom de Chambertin des vignes provenant du clos de Bèze et de vignes voisines. Le nom même de Chambertin n’est documenté qu’au 13e siècle, bien après celui du clos de Bèze, et désigne un ensemble de terres vignes et bois entre Gevrey et Morey sous l’appellation Campus Bertini, champ de Bertin. Bertin, comme le rappelle Jean-François Bazin, est un nom propre d’origine burgonde (Berht) signifiant « célèbre ». Des vignes de ce Champ Bertin, jouxtant les murs du clos de Bèze sont échangées en 1276 avec l’abbaye de Cluny (qui malgré ses ambitions n’a jamais pu acquérir le clos voisin), par Guillaume de Grancey, qui ne devait pas avoir des vignes sur des terroir de second ordre ! Un cadastre (terrier) de 1566 signale l’existence d’un Grand Chambertin (20 ouvrées, 8,56 ha) et d’un Petit-Chambertin (10 ouvrées) comme on distingue aujourd’hui dans le Musigny, le Grand et le Petit. L’addition des deux définit une superficie absolument identique à celle du cru actuel.

L’excellence du travail
Claude Jobert, nous y revenons, est à la fois marchand de vin (fournisseur de la cour palatine) mais surtout un grand notable, propriétaire de l’office de greffier en chef des Monnaies à Dijon et aussi conseiller – secrétaire du Roi, qui lui accorde la noblesse tout en lui permettant de commercer sans déroger. Il est certainement très fier de son vin et fait donc rajouter le nom de celui-ci au sien ! Corroborant cette fierté, liée à l’excellence du travail et surtout à une sélection stricte des cuvées, le prêtre Claude Arnoux, auteur d’un petit livre en 1728 sur les vins de Bourgogne, le premier à éditer une petite carte et à donner des jugements de valeur, écrit que le Chambertin (assimilant sous un même nom le clos et les vignes voisines) est le plus « considérable des vins de Bourgogne, celui qui renferme les qualités de tous les autres et n’en n’a pas les défauts », anticipant la fameuse définition de Gaston Roupnel « tout le grand bourgogne possible ! ». Il indique aussi que le prix de vente à Londres est le double des autres vins, ce qui est, on le sait, le signe d’une hiérarchisation par le public, créatrice de la notion même de grand cru. La côte de Nuits dépasse en notoriété la côte de Beaune et Louis XVI selon son inventaire de cave de 1783 boit en dehors des vins fortifiés de Madère, Tokay, Constance, du clos Vougeot, du Richebourg, de la Tâche, du Chambertin, de la Romanée Saint-Vivant. De même Thomas Jefferson fait envoyer à la Maison Blanche en 1803 cent douzaines de bouteilles de Chambertin. Napoléon Bonaparte, dont c’est le vin favori, donne enfin sa dimension impériale au cru, que je tiens à rappeler à notre cher Président Nicolas Abstême premier ! La sécularisation des deux vignes sera complète avec les ventes comme Biens Nationaux des propriétés de l’Église de 1791. Parmi les acheteurs plus ou moins directs, le célèbre banquier Ouvrard (qui sera à la tête d’un véritable empire viti-vinicole comprenant l’intégralité entre autres du clos Vougeot) et, Jean-François Bazin aime à le rappeler, un certain ancêtre à lui, Claude-Antoine Gelquin, limonadier de son état, ce qui montre un élargissement sociologique de la propriété !
crédits photo d’ouverture : www.vins-bourgognes.fr
Le cru Chambertin quant à lui naît d’une délimitation des tribunaux de 1931 et 1932, fondée sur des usages commerciaux loyaux et anciens, car beaucoup de producteurs de vignes voisines de deux précédentes auraient voulu se placer sous l’ombre tutélaire du mot magique Chambertin, et même le clos Saint-Jacques, remarquablement situé et producteur d’un vin de grande classe, mais sur un coteau quand même non contigu ! On tranchera à la normande en autorisant pour ces vignes voisines, le mot Chambertin (comme d’ailleurs le village de Gevrey l’avait fait avec beaucoup de sagacité et de malice) mais en seconde position, après le nom du lieu dit d’origine. Donc Charmes-Chambertin et pas Chambertin-Charmes ! Mais rien pour le clos Saint-Jacques, le comte de Moucheron, alors seul propriétaire ayant indisposé les juges. On ne peut leur en vouloir car cette réunion aurait été abusive. Le décret officiel de 1937 créant les grands crus d’appellation d’origine contrôlée reprend les principes de ces délimitations judiciaires, mais autorise, à la demande du président du syndicat de défense du Chambertin, le général Rebourseau, de vendre comme Chambertin, sans clos de Bèze, le vin du clos de Bèze mais pas l’inverse. Cela à vrai dire l’arrangeait car il n’avait pas assez de volume des deux pour réussir deux cuvées différentes. L’inverse n’est en revanche pas possible, non pas parce que le vin est moins bon, mais parce que l’histoire en avait, bien avant ce décret, décidé ainsi. La seule chose que crée le décret c’est de conférer la même valeur officielle à tous les vins issus de ces deux crus, les bons comme les moins bons, alors qu’auparavant c’était le producteur qui décidait de ce qui était le meilleur ou non et le vendait à son juste prix. Il n’est pas sûr que le public y ait gagné, car on imagine les réticences du vigneron à ne pas revendiquer pour un vin même moyen ce à quoi il a droit !
| À suivre | >Les fondements de la qualité… | > »Mes vins références » Michel Bettane… | >Les propriétaires… |