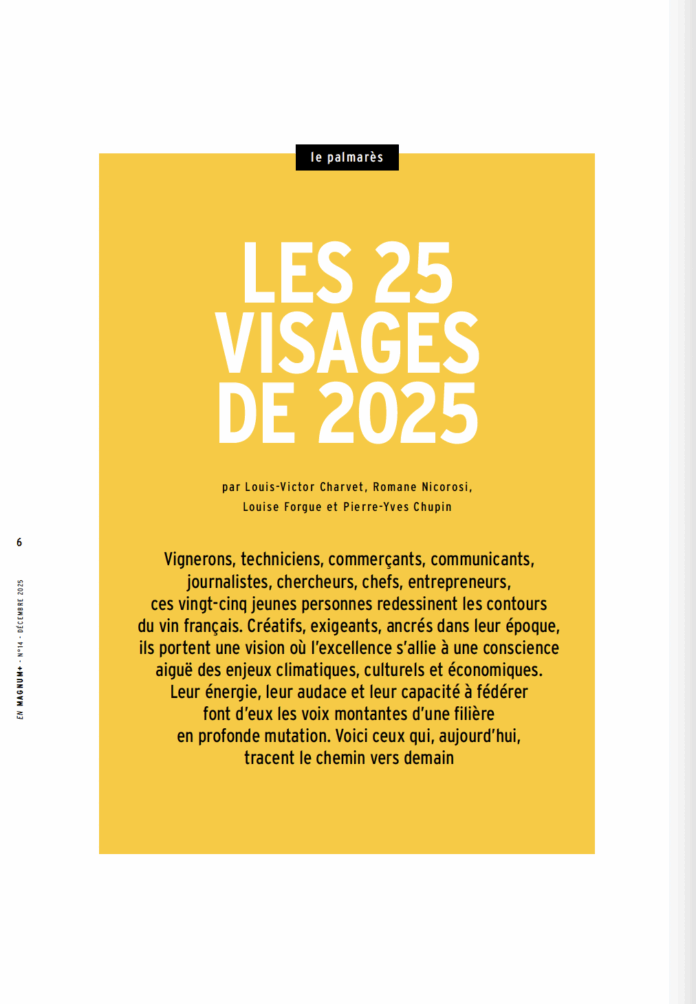Trois vins pour un Noël
Champagne Nicolas Feuillatte, Palmes d’Or – Chronothèque 2000
[Pourquoi lui]
C’est la plus importante coopérative de Champagne. Comprendre que Guillaume Roffiaen, à la tête du pôle vin, est le chef de cave qui dispose du plus grand choix de raisins pour élaborer ses cuvées. Et que, au passage, il est le gardien de la plus grande réserve de grands vins de toute la Champagne. Palmes d’Or, c’est la cuvée ++ de la marque. Et pour faire valoir l’immensité des choix qui s’offrent à lui, il sort de ses caves ombreuses et de temps en temps une cuvée, un millésime destiné à porter haut l’ambition de la marque.
Tout ceci sous l’appellation Chronothèque, histoire de faire valoir le temps qui passe et rappeler à chacun que le champagne est un champion du vieillissement.
[Avec qui, avec quoi]
Un millésime de 25 ans d’âge, c’est un vin de méditation, de ceux qu’on ouvre après le dîner, en petit comité et en poussant de légers soupirs de ravissement. Choisir des convives capables de comprendre ce qu’ils boivent. C’est aussi un vin au dosage retenu, plus faible que le 2000 originel.
[Combien]
570 euros le magnum.
[Ce qu’en dit le Guide B+D]
Un champagne incroyablement frais et vibrant, qui ne trahit pas son âge, avec des notes envoûtantes de fruits exotiques, d’ananas rôti, de miel d’acacia et de tabac blond.
95
Domaines Ott, Clos Mireille 2024, côtes-de-provence
[Pourquoi lui]
J’ai visité cet endroit que je tiens pour la plus belle propriété de toute la Côte d’Azur et je pèse mes mots. Nul doute qu’à sa première visite, Frédéric Rouzaud, propriétaire des domaines Ott, s’est dit la même chose. Des dizaines d’hectares de vignes au bord de la mer, un hameau de grand charme, Clos Mireille a tout pour faire craquer l’un des plus sérieux propriétaires de Champagne (Roederer). Là, la famille Ott élabore de grands blancs et des rosés de finesse. Les rouges viennent plutôt du château Romassan à Bandol et du château de Selle, les deux autres domaines Ott.
[Avec qui, avec quoi]
Tout le monde connaît la marque Ott, vous ne surprendrez pas vos invités. En revanche, personne n’a idée du niveau auquel ce domaine est parvenu avec l’appui des grands techniciens de Roederer, menés par Jean-Baptiste Lécaillon (lire son portrait, page 67). Et c’est même pas cher. Ce blanc très pur oblige une gastronomie en rapport.
[Combien]
72 euros le magnum.
[Ce qu’en dit le Guide B+D]
Blanc fin et précis qui joue la carte de l’épure et de la vivacité. En bouche, la texture est délicate, précise, avec une chair élancée et une finale aérienne. On aime ce blanc de terroir pour son goût pur.
94
Château Cos d’Estournel, Pagodes de Cos 2018, saint-estèphe
[Pourquoi lui]
Voilà une longue histoire médocaine. Sans revenir aux origines et aux fantasmes « retour des Indes » du premier propriétaire des lieux, le passage de témoin au tournant du siècle entre Bruno Prats et son acquéreur Michel Reybier montre à quel point la propriété a été respectée et valorisée. Michel Bettane dit même que Cos d’Estournel, sous l’autorité de Dominique Arangoïts, l’actuel directeur du domaine, n’a jamais été à un tel niveau d’excellence. L’endroit vaut tous les détours, mais on attendra le printemps. Et ce qui vaut pour le grand vin vaut aussi pour celui-ci, Les Pagodes de Cos, prêt à boire dans le millésime 2018.
[Avec qui, avec quoi]
Dans les vignobles qui ne se moquent pas du monde, les seconds vins ne sont pas moins bien traités que les premiers. Ils sont en général prêts plus vite, ils sont moins fermes, plus flatteurs, avantageux en somme. Si vous avez un convive qui en doute, faites-lui goûter ce joli nectar.
[Combien]
140 euros le magnum.
[Ce qu’en dit le Guide B+D]
Grande réussite, magnifique intensité aromatique, notes d’acacia rares jusqu’à ce jour, long, savoureux, et sans la moindre nuance aromatique technologique
ou variétale.
95
La nuit des étoiles
Alsace
Cave de Ribeauvillé,
Clos du Zahnacker 2019, alsace
Une cuvée issue d’un clos historique au sein du grand cru Osterberg. Trois cépages y sont plantés (riesling, pinot gris et gewurztraminer) et vendangés ensemble. Robe pâle, bouche ample aux amers nobles, légère douceur que l’acidité absorbera avec le temps, ce 2019 est un vin de garde harmonieux et racé.
60 euros
Domaine Gustave Lorentz,
riesling Altenberg de Bergheim Vieilles Vignes 2020, alsace grand cru
Riesling puissant et ample, porté par des amers nobles propre au terroir de l’Altenberg. La richesse du millésime apporte un léger moelleux en bouche que la minéralité finale équilibre avec justesse. Un vin solide, riche et structuré, à la personnalité affirmée.
30 euros
Domaine Valentin Zusslin, riesling Pfingstberg 2019, alsace grand cru
Superbe riesling alliant puissance et maturité du fruit. Sec, minéral et raffiné, il déploie des notes d’agrumes et d’épices. Des amers élégants structurent la bouche profonde et savoureuse de ce blanc réjouissant qui gagnera en harmonie et en puissance avec le temps.
70 euros
Beaujolais
Georges Duboeuf,
Château des Capitans 2023, juliénas
Franck et Adrien Dubœuf-Lacombe poursuivent l’œuvre familiale avec des cuvées identitaires alliant gouleyance et style charmeur. Tous les vins parcellaires de la maison expriment de mieux en mieux les grands terroirs, comme ce juliénas aux notes poivrées et à la bouche structurée par des tannins soyeux et précis.
Domaines Loron, Château Bellevue,
Côte du Py 2023, morgon
Cette maison historique exploite 222 hectares, dont les trois quarts en Beaujolais et le reste en Mâconnais. Assez floral pour un vin issu du terroir de la Côte du Py, ce 2023 charme par son toucher délicat et ses tannins finement extraits. La finale veloutée est très élégante.
19 euros
Château du Moulin-à-Vent,
Les Grands Savarins 2023, moulin-à-vent
Propriété de la famille Parinet depuis 2009, ce château emblématique de l’appellation illustre à lui seul le renouveau qualitatif et médiatique du Beaujolais. La mise en valeur des différents lieux-dits se traduit par des cuvées identitaires et précises. Un 2023 puissant et généreux, marqué par une belle ampleur et un tannin moelleux.
65 euros
Bordeaux
Château de La Dauphine 2022, fronsac
Avec sa soixantaine d’hectares cultivés en bio, cette propriété attachante affirme un style abouti. Jean-Claude Labrune en incarne la vision, tandis que Stéphanie Barrousse pilote la propriété avec rigueur et sensibilité. Vin soyeux, intense et tannique, alliant subtilité et finale magistrale, ce fronsac enchante par sa sensualité et son plaisir immédiat. Il atteindra son apogée dans la prochaine décennie.
26 euros
Château La Lagune 2015,
haut-médoc
Sous la direction de la famille Frey, ce cru classé a progressé grâce à la viticulture bio, des assemblages enrichis en cabernet-sauvignon et des extractions plus respectueuses. Né d’un millésime solaire, ce 2015 aujourd’hui prêt à boire, séduit par sa fraîcheur et sa profondeur, illustrant la belle évolution dans le temps de ce haut-médoc chic et élégant.
70 euros
Château Dauzac 2022,
margaux
Modernisation des bâtiments techniques, haut niveau de viticulture et de vinification, plantation de vignes franches de pied, développement d’une jolie marque de bordeaux, Dauzac s’impose comme un acteur incontournable des vins de Bordeaux. Le cru continue de signer des vins complets comme ce 2022 au corps impeccable, avec ses tannins fermes mais souples. Le caractère margalais se révèle et il va encore gagner encore en nuances.
52 euros
Château d’Issan 2021,
margaux
Ceint de murs, le magnifique vignoble de la famille Cruse repose sur un terroir de premier ordre, garant de la finesse aromatique et de la constance du vin malgré les caprices climatiques. Souvent à attendre quelques années, c’est l’un des margaux les plus fins et subtils. Belle surprise, ce 2021 salin et frais en bouche ne fait pas exception à la règle.
76 euros
Château Batailley 2022,
pauillac
Propriété de la famille Castéja, Batailley a retrouvé la plénitude de son style, entre puissance civilisée et pureté aromatique. Suivi par le talentueux consultant Axel Marchal, le grand vin s’inscrit désormais dans un registre de finesse assez magnifique. C’est le cas de cet élégant 2022 aux notes de cèdre et de fruits noirs. Corps complet et tannins finement extraits, c’est la classe.
70 euros
Château Pichon Baron 2022,
pauillac
Le grand vin du domaine possède la vigueur et la puissance des meilleurs pauillacs et ce 2022 s’impose par sa robe généreuse, son nez floral noble et sa texture veloutée. Intense, il réunit finesse et classe, confirmant la réussite d’un cru qui s’est imposé comme l’un des plus réguliers au sein du plus haut niveau de l’appellation.
200 euros
Château Pichon-Longueville Comtesse de Lalande 2022,
pauillac
Grand cru modèle, dirigé par Nicolas Glumineau, Comtesse a modernisé sa viticulture et son cuvier en accentuant la proportion de cabernet-sauvignon dans ses assemblages. Magnifique réussite dans ce millésime par sa texture et son équilibre parfait. Grande longueur, vigueur, charme et finesse, il a tout.
265 euros
Château Bouscaut 2023,
pessac-léognan
Cette propriété classée, sur des sols calcaires adaptés aux cépages blancs, bénéficie de l’arrivée d’une nouvelle génération exigeante. Ce 2023 séduit par son nez fumé, entre notes d’abricot, d’acacia et d’orange sanguine. La bouche, riche et aromatique, s’étire avec une belle texture et une finale vive.
40 euros
Château de Fieuzal 2022,
pessac-léognan
Le nouveau chai de Fieuzal ultra performant, avec de nombreuses petites cuves de contenances diverses, permet à Stephen Carrier, le directeur, de faire de la haute couture. Arômes fruités et floraux épanouis, ponctués de touches fumées, la texture de ce pessac-léognan rouge est superbe avec des tannins fins et très distingués.
40 euros
Château Pape Clément 2022,
pessac-léognan
Depuis son arrivée à la tête de cette propriété majeure de Pessac, Bernard Magrez maintient le cru au premier rang des grands bordelais. Superbe, ce 2022 révèle un nez complexe de fruits noirs et rouges mûrs, avec des notes de cuir noble. Matière dense et soyeuse, style puissant et truffé, on va l’attendre pour qu’il exprime tout son potentiel.
97 euros
Château Smith Haut Lafitte 2022,
pessac-léognan
Propriété phare de Martillac par la qualité de ses installations et son ouverture au tourisme viticole, Smith Haut Lafitte est aussi un vignoble pionnier pour sa philosophie de viticulture. Magnifique 2022 au nez noble et complexe, révélant notes de fruits noirs et rouges, tabac, poivre, fleurs et silex. Puissant, dense et savoureux, c’est un millésime culte de la famille Cathiard.
180 euros
Château Gazin 2022,
pomerol
Situé face à Petrus, avec 24 hectares d’un seul tenant, Gazin s’impose comme l’un des grands noms de Pomerol. La nouvelle génération, incarnée par Élise et Édouard de Bailliencourt, y mène une dynamique de travail exigeante. Superbe réussite avec ce 2022 énergique et droit, qui allie fruit éclatant, fraîcheur et tension. La finale florale sur la pivoine est vibrante.
98 euros
Clos Fourtet 2022,
saint-émilion grand cru
Situé près des murailles de Saint-Émilion, le vignoble de Clos Fourtet, propriété de la famille Cuvelier, a entamé une conversion en biodynamie qui lui permettra d’aller encore plus loin dans la recherche de qualité. Dense et velouté, ce 2022 tout en énergie et en verticalité brille par sa finale saline et pleine de nuances.
150 euros
Château Dassault 2022,
saint-émilion grand cru
Désormais dirigée par Valérie Befve qui a succédé à Romain Depons à la tête des propriétés du groupe Dassault, le cru peut s’appuyer sur son nouveau chai pour signer un vin offrant précision et structure. On aime ce 2022 au cœur de bouche généreux et à la finale montante, savoureuse et soyeuse. La progression est réelle et l’élevage maîtrisé.
52 euros
Château Fonroque 2022,
saint-émilion grand cru
Acquis en 2017 par la famille Guillard, ce cru certifié en biodynamie profite des conseils du consultant Alain Moueix. Il signe en 2022 un vin au tannin frais et élancé, avec la structure et la générosité propres au millésime. De jolies notes de menthe sauvage en finale lui donnent de la longueur et une fraîcheur raffinée.
52 euros
Château La Gaffelière 2021,
saint-émilion grand cru
Sous l’impulsion d’Alexandre de Malet-Roquefort, le vignoble de La Gaffelière a été magnifiquement restructuré. On retrouve dans ce 2021 un toucher soyeux et la marque du duo calcaire et grands cabernets francs qui structure le vin de bout en bout. Le souffle racé de la finale est saisissant.
76 euros
Château Grand Corbin-Despagne 2022,
saint-émilion grand cru
Sous l’impulsion de son propriétaire François Despagne, ce vin s’est imposé par son charme comme l’un des plus séduisants de l’appellation, exprimant une sensualité rare. Avec le temps, il gagne en profondeur et développe des accents de truffe noire irrésistibles. Ce que ne manquera pas de faire ce 2022 au charme absolu et à la texture soyeuse.
41 euros
Château de Pressac 2022,
saint-émilion grand cru
Depuis 1997, Jean-François Quenin façonne les 40 hectares de son cru qu’il a patiemment replantés sur un sol argilo-calcaire. Ce 2022, d’une profondeur vibrante, allie intensité et légèreté, avec une finale longue et aérienne, révélant des notes délicates de bulbe d’iris et de craie.
42 euros
Château La Marzelle 2022,
saint-émilion grand cru
Face à Figeac, La Marzelle étend ses 17 hectares certifiés bio sur des sols de graves, sables et argiles bleues. Depuis l’arrivée de Sébastien Desmoulin à la direction technique en 2016, la qualité s’affirme, comme en témoigne ce vin à la texture soyeuse, soutenu par une grande fraîcheur jusqu’en finale. Dense, précis et construit, il ne perd jamais le raffinement de vue.
55 euros
Château Léoville Poyferré 2022,
saint-julien
Capable de produire l’un des vins les plus puissants, complexes et harmonieux de Saint-Julien, Léoville Poyferré a franchi un cap ces derniers millésimes et rejoint l’élite de son appellation sous la vigilance de Sara Lecompte-Cuvelier. Élégant et soyeux, ce 2022 s’étire en bouche avec une finesse presque féline, alliant gourmandise et complexité.
138 euros
Bourgogne
Camille Giroud,
beaune 1er cru Aux Cras 2023
La petite maison Camille Giroud signe des vins purs, spontanés et soyeux, pleinement expressifs du plus modeste au grand cru, toujours gourmands et racés. Ce beaune frais à la texture ample et au corps généreux est promis à un grand avenir.
70 euros
Joseph Drouhin,
beaune 1er cru Clos des Mouches 2022
Fondée en 1880, cette maison iconique demeure une affaire de famille près de 140 ans plus tard. Son style, en blanc comme en rouge, privilégie finesse et expression pure du fruit, pour laisser chaque climat s’exprimer avec précision. Vin emblématique, ce clos-des-mouches s’appuie sur un pinot noir dense et généreux.
124 euros
Maison Louis Jadot,
beaune 1er cru Clos des Ursules 2022
Sous la conduite de Frédéric Barnier, les vinifications offrent une lecture précise des terroirs de la maison. Les appellations secondaires brillent par leur justesse et les grands crus restent au sommet, tout comme ce vin iconique, excellent en 2022, qui nécessitera quelques années pour pleinement s’exprimer.
99 euros
Domaine Laroche,
chablis grand cru Blanchots 2023
Une nouvelle ère s’ouvre pour le fleuron chablisien du groupe Advini, aujourd’hui dirigé par Jean-Baptiste Mouton et Romain Chevrolat. Les cuvées se distinguent par une belle pureté de fruit au nez et en bouche. L’élevage en fût est encore perceptible dans ce 2023, mais avec le temps, le soyeux propre au terroir des Blanchots s’affirmera.
82 euros
Domaine Faiveley,
gevrey-chambertin 1er cru Les Cazetiers 2023
Avec 120 hectares et un chai parmi les plus beaux de Bourgogne à Nuits-Saint-Georges, Faiveley s’impose comme un ambassadeur des grands vins bourguignons construits sur la droiture et la précision. Ce 2023, racé et tactile, se distingue par sa finesse et sa buvabilité immédiate, tout en restant fidèle à son terroir.
132 euros
Domaine Trapet,
gevrey-chambertin 1er cru Petite Chapelle 2023
Chez les Trapet, la viticulture biodynamique et des sols revitalisés révèlent les nuances du terroir. Les vins, portés par des tannins d’une rare élégance, sont de franches réussites, à l’image de ce gevrey-chambertin intense qui s’annonce particulièrement délicieux après quelques années de garde.
200 euros
Louis Latour,
marsannay 2023
Fondée en 1797 et solidement implantée sur la colline de Corton, cette maison familiale allie authenticité et agilité grâce à une équipe compétente à la vigne, en vinification et à la commercialisation. Un marsannay profond et structuré, au corps généreux et à la texture remarquable. Délicieux dès à présent.
31,50 euros
Vignerons des Terres Secrètes, Clos du Four 2023,
mâcon Milly-Lamartine
Cette cave regroupant 120 coopérateurs du sud de la Bourgogne produit des blancs de belle qualité tout en explorant les terroirs du Mâconnais. Joli chardonnay aux arômes de fruits frais, melon et poire.
11,70 euros
Domaine Vincent Dureuil-Janthial,
rully 1er cru Chapitre 2023
Vincent Dureuil, référence de la côte chalonnaise, conduit avec rigueur son vignoble de 21 hectares. Dans le millésime 2023, il signe de superbes blancs, comme ce premier cru salin, racé et très élégant, que nous recommandons pour sa finesse et sa pointe de fraîcheur délicieuse en finale.
41 euros
Jura
Domaine Rijckaert,
En Paradis 2023, arbois
Florent Rouve, ancien forestier reconverti, cultive sept hectares et vinifie à la bourguignonne, pour proposer exclusivement des vins ouillés. Ses chardonnays, élevés en fûts anciens, affichent gras et notes d’élevage, tout en charmant par leur fine salinité.
21 euros
Domaine de Savagny,
Vin jaune 2017, côtes-du-jura
Propriété des Grands Chais de France depuis 2002, ce domaine maîtrise parfaitement ses vinifications pour offrir des vins impeccables, aidé par un site impressionnant par sa taille et sa technologie. Ce vin jaune aux notes expressives de noix fraîches, est d’une grande pureté.
37 euros
Languedoc
Domaine de la Cendrillon, Inédite 2018,
corbières
Situé à Ornaisons, aux frontières de Boutenac, le domaine de la Cendrillon existe depuis cinq générations et est certifié bio depuis 2013. Hubert, fils du propriétaire, veille à vinifier des raisins soignés, privilégiant des extractions douces pour signer des vins raffinés et sincères. Ce 2018 aux tannins fondus accompagnera parfaitement les viandes en sauce.
22 euros
Domaine Gérard Bertrand, Château Villemajou, Grand vin 2022,
corbières-boutenac
Gérard Bertrand, vigneron méticuleux et exigeant, veille à l’excellence de ses dix-sept domaines, tous aujourd’hui certifiés en biodynamie, faisant de lui le plus important producteur dans cette catégorie. Le grand vin de Villemajou, avec son grand caractère, impose ses notes épicées et poivrées, ses tannins fins et serrés et son allonge généreuse.
33,50 euros
Domaines Paul Mas, Clos des Mûres 2023,
languedoc
En deux décennies, Jean-Claude Mas a bâti un patrimoine de plus de 800 hectares et créé des marques, dont le célèbre Arrogant Frog. Ses vins, très accessibles, sont fruités et plaisants, dans l’esprit de cette cuvée grenache-syrah aux notes de fraise et de mûre, portée par des tannins souples et une persistance aromatique brillante.
13,90 euros
Maison Lorgeril,
Les Anges 2023, vin de France
En vingt ans, Nicolas et Miren de Lorgeril ont restauré le vignoble et le château, y produisant des vins classiques et réguliers qui allient richesse aromatique, fraîcheur et équilibre. Celui-là séduit par ses notes de griottes et de mûre, son caractère fin et épanoui, ses tannins élégants et sa finale veloutée. On patiente encore un peu avant d’en profiter.
29 euros
Loire
Domaines Baudry-Dutour,
Château de la Grille 2021, chinon
Depuis le début du siècle, Christophe Baudry et Jean-Martin Dutour cultivent une synergie entre leurs domaines de Touraine, notamment autour du Chinonais, valorisant chaque écosystème. Grand vin de la maison, ce 2021 allie structure et sensualité, avec un joli rebond final et une verticalité parfaite, reflet fidèle du millésime.
26 euros
Domaine Hubert Brochard,
Les Trois Coteaux Terres de Caillottes 2023, sancerre
Au cœur de Sancerre, le domaine signe ce blanc d’une pureté exemplaire, qui a profité d’un élevage dans des contenants divers (barriques, amphores, cuves inox) pour préserver une belle fraîcheur et un caractère très fruité. Le nez est riche, marqué par les notes de coing et de fruits blancs, et la bouche déroule une trame calcaire qui donne à la finale une gourmandise précise et persistante.
22,50 euros
Domaine Henri Bourgeois,
La Côte des Monts Damnés 2023, sancerre
Arnaud, Lionel et Jean-Christophe Bourgeois cultivent l’esprit de famille, guidés par les conseils de leur père Jean-Marie. Le domaine produit des vins de plaisir et des cuvées parcellaires de grande qualité. Issu d’un terroir mythique de l’appellation, ce 2023 impressionne par son nez minéral et complexe, aux notes de pierre frottée, d’agrumes frais avec une délicate touche fumée.
34,50 euros
Domaine des Closiers,
Les Coudraies 2021, saumur-champigny
Au cœur de Saumur-Champigny, Anatole de la Brosse veille sur ses quinze hectares autour de Parnay, les conduisant en agriculture biologique. Cette cuvée, issue d’une parcelle située en haut du coteau, donne un vin aux notes florales et légèrement racinaires, avec un tannin soyeux qui structure la bouche dans un phrasé harmonieux.
46 euros
Provence
Domaine des Bergeries
de Haute Provence, Via Domitia 2023, IGP alpes-de-haute-provence
Jean-Luc Monteil veille avec exigence sur son domaine, le plus haut des Alpes-de-Haute-Provence, cultivé en bio et certifié biodynamie dès 2024. La cuvée Via Domitia, rare assemblage de nebbiolo et syrah, ravit par son fruit, sa fraîcheur et sa dimension savoureuse, offrant un équilibre original et réussi.
25 euros
Domaine de la Bégude,
bandol 2017
Assemblage de mourvèdre et de grenache, il exprime avec éclat la singularité des terroirs de cette propriété spectaculaire, suspendue au-dessus de la Méditerranée. La robe, profonde aux reflets violines, précède un nez complexe de fruits noirs et d’épices douces. En bouche, la chair ample s’allie à une structure élégante, avant une longue finale d’une rare distinction. Un grand bandol, impressionnant de style.
30 euros
Clos de Caille, Lucis 2023,
côtes-de-provence
À 200 mètres d’altitude, sur les hauteurs d’Entrecasteaux, la famille Mariotti signe avec l’aide de l’oenologue Mathieu Cosse des vins à la hauteur de ce terroir de premier ordre. Le domaine, qui s’illustre aussi bien dans les trois couleurs, avec des rosés superbes, propose ce blanc haute couture élevé en barriques neuves qui exprime avec justesse une ambition tournée vers l’excellence.
55 euros
Château Sainte-Roseline,
La Chapelle 2016, côtes-de-provence
La propriété allie excellence viticole et raffinement architectural. Sous la direction d’Aurélie Bertin, ses 300 hectares dont 110 de vignes produisent des vins constants et aboutis. Ce 2016, superbement élevé, mêle notes boisées, fruits noirs et grande fraîcheur, avec une finale voluptueuse, longue et racée.
43,40 euros
Rhône
Domaine Richaud,
L’Ébrescade 2022, cairanne
La jeune génération perpétue avec brio l’œuvre de Marcel Richaud, figure de Cairanne. Les vins gagnent en raffinement, alliant toujours profondeur et immédiateté. Assemblage de mourvèdre et syrah, ce 2022 séduit par sa complexité, son allure racée et déliée, ainsi que ses notes de poivre blanc et de cacao.
30 euros
Château de la Gardine, Générations – GastonPhilippe 2022,
châteauneuf-du-pape
Grand classique de Châteauneuf-du-Pape, La Gardine est un domaine d’un seul tenant qui s’étend principalement sur un socle calcaire qui confère aux vins structure et singularité. La cuvée des Générations, en rouge comme en blanc, allie puissance et densité. Très réussi ce 2022 nécessitera quelques années pour atteindre son plein équilibre.
70 euros
Domaine du Grand Tinel,
Les Roussannes de Charles 2023, châteauneuf-du-pape
Le domaine du Grand Tinel, fruit de l’union des familles Establet et Jeune, dispose d’un beau patrimoine de très vieilles vignes pour proposer des cuvées abouties dans les deux couleurs. Nous aimons beaucoup cette pure roussanne à la chair ronde et sphérique et aux notes exquises de miel et d’amande.
51 euros
Château Mont-Redon,
châteauneuf-du-pape 2022
Vaste propriété historique, Mont-Redon couvre près de cent hectares en châteauneuf-du-pape, majoritairement sur le plateau de galets roulés. Sans ostentation, ses vins imposent leur style par leur équilibre, mais aussi leur aptitude au vieillissement. Corsé et généreux en tannins, ce 2022 affiche une grande profondeur, parfaitement en phase avec le millésime.
51,50 euros
Domaine de la Solitude,
châteauneuf-du-pape 2022
Florent Lançon, propriétaire et viticulteur doué, affine la définition de ses vins grâce à un chai performant et une viticulture très respectueuse du terroir. On aime ce 2022 pour son intensité aromatique, sa richesse en bouche et son élevage très réussi. Tout est grand dans ce vin, comme le talent du vigneron.
35 euros
Dauvergne Ranvier,
condrieu 2023
La maison créée par François Dauvergne et Jean-François Ranvier est aujourd’hui une référence des vins du Rhône. Impliqués à toutes les étapes, ils sont vigilants quant à l’expression des terroirs, ce que l’on ressent avec ce condrieu aux notes florales et d’abricot mûr. Doté d’un corps svelte et sans lourdeur, avec une dimension apéritive, c’est excellent rapport qualité-prix.
30 euros
Cave de Tain,
Gambert de Loche 2015, hermitage
Les pratiques viticoles ont beaucoup progressé à la cave depuis la naissance de ce 2015. Il est pourtant très réussi, se distinguant par un tannin soyeux tout en conservant des saveurs concentrées de fruit noir et une vraie fraîcheur. Dans ce très beau millésime, le vin séduit par son équilibre, sa précision et sa remarquable élégance.
85 euros
Domaine Courbis,
Les Royes 2022, saint-joseph
Les frères Laurent et Dominique Courbis dirigent ce domaine situé à l’extrême sud de l’appellation saint-joseph. Ils signent sur le terroir singulier des Royes, amphithéâtre argilo-calcaire qui contraste avec les coteaux granitiques voisins, ce blanc au fruit expressif et à la bouche savoureuse, relevée d’une touche pierreuse finale.
38 euros
Roussillon
Domaine du Clos des Fées,
Le Clos des Fées 2022, côtes-du-roussillon villages
Depuis son premier millésime en 1998, Hervé Bizeul a fait de ce domaine une référence du Roussillon. La gamme, pensée avec cohérence, décline vins de fruits, vins de lieux et cuvées d’auteur. Ce vin, aux notes de fruits mûrs et d’épices douces, charme par sa gourmandise et sa finale fraîche. Un rouge de plaisir abouti.
50 euros
Sud-Ouest
Château Bouscassé 2020,
madiran
Depuis les années 1980, Alain Brumont s’impose par sa vision avant-gardiste et sa viticulture précise. Les vignobles des châteaux Montus et Bouscassé, plantés sur des terroirs variés, représentent le sommet du Sud-Ouest viticole. Archétype du grand madiran par son nez de fruits noirs, sa bouche dense, ses tannins francs et sa longue finale vigoureuse, pleine de caractère.
22 euros
Plaimont, Cirque Nord 2021,
saint-mont
L’appellation saint-mont doit beaucoup à Plaimont, union de vignerons de plusieurs coopératives qui valorise les meilleurs terroirs du Piémont pyrénéen sous l’impulsion d’Olivier Bourdet-Pees et d’équipes jeunes et talentueuses. Nous aimons toujours beaucoup ce grand blanc fidèle à son terroir, étonnant par sa fraîcheur, son équilibre et sa précision en bouche. Beau potentiel de garde.
34 euros
Champagne, les marches du succès
Anselme Selosse et la vérité des raisins
Le jeune journaliste idéaliste que j’étais à la fin des années 1970 se sentait effrayé par l’état de la viticulture champenoise. La vision des coteaux recouverts de déchets urbains était insupportable. J’avais donc demandé à Michel Dovaz, mon maître et ami, grand spécialiste de ce vignoble, s’il connaissait un jeune vigneron sérieux qui cultivait encore ses sols. Sans hésiter, il m’a donné le nom d’Anselme Selosse à Avize. Dès ma première visite, j’ai été séduit par son talent et son désir d’exprimer dans ses vins la vérité de ses raisins. Il venait de prendre la suite de son père Jacques et vinifiait encore dans les vieux foudres qui masquaient la pureté aromatique des vins tranquilles. Je lui ai suggéré d’acheter des barriques bourguignonnes, ce qui lui a valu de se voir refuser l’appellation pour excès de boisé. Véronique Hugel dirigeait alors la section Champagne de l’Inao. Il y a depuis prescription et nous pouvons lui dire qu’Anselme a désobéi et que son vin se dégustait splendidement dix ans plus tard. Entre temps, il était devenu la star montante des récoltants-manipulants et une solide amitié était née, partagée avec son épouse Corinne et Francis Égly, mon autre grande référence. Anselme a su transmettre à son fils Guillaume sa passion et son éthique et redonner sa fierté à toute une génération de vignerons, avec le respect des grandes maisons et de leurs chefs de cave.
Bollinger et le goût original du grand RD
J’ai découvert Bollinger lorsque j’étais élève à l’Académie du vin, l’école de dégustation créée par Steven Spurrier. Ce fut immédiatement un coup de cœur. On pouvait en 1979 acheter pour des sommes modestes dans les magasins Nicolas la magnifique cuvée RD 1959. L’étiquette précisait « dégorgé en 1975 » et je ne comprenais pas ce que cela voulait dire. Quatre ans depuis le dégorgement, ce n’était pas récent et tous les champagnes, par définition, sont récemment dégorgés. Lors de ma première visite à la maison Bollinger, je trouvais oxydés les RD dégustés. Je ne retrouvais pas la saveur magnifique de mon 1959. Lors de ma seconde visite, j’avais demandé à Guy Adam, le chef de cave de la maison, qui m’avait pris en amitié, de dégorger un 1959 pour le comparer avec ma bouteille de 1959 dégorgée en 1975, huit ans plus tôt. Il n’y eut pas d’hésitation sur la supériorité de ce vieux dégorgé, bien plus jeune et plus complexe en goût. Guy m’avait avoué que lui non plus ne comprenait pas le caractère toujours un peu oxydatif des vins juste après leur dégorgement. Ce fut pour moi le début d’une longue amitié avec les directeurs et les chefs de cave de la maison au cours de laquelle, durant de nombreuses années, j’ai tenté de les persuader de produire au cœur de leur vignoble d’Aÿ (le plus grand terroir de Champagne selon moi) un grand vin de caractère unique. Ils ont quand même mis plus de trente ans à le produire, c’est la cuvée spéciale La Côte aux Enfants. Mieux vaut tard que jamais.
Michel, Francis et ce garagiste que je n’oublierai pas
J’avais trouvé en Anselme Selosse le vigneron idéal pour suivre la qualité des chardonnays en Champagne. Mais j’avais besoin d’une autre référence pour mon suivi des pinots noirs. Cette fois, en 1985, j’ai eu recours à un renseignement donné par un garagiste de Tours-sur-Marne à qui j’avais demandé s’il connaissait un vigneron de ce secteur qui continuait à cultiver ses vignes. Il m’apprit qu’il en connaissait un, situé sur la route de Trépail, en bout de village, à Ambonnay. J’ai pu vérifier sur place le même jour, en rencontrant Michel Égly, qu’il disait vrai. Le couple de vignerons qu’il formait avec sa femme était modeste, sincère et travailleur. Les vins étaient excellents, avec ce caractère délicatement mielleux après six ou sept ans de vieillissement, véritable caractéristique de ce grand cru. Les dégustateurs du Guide Hachette n’étaient évidemment pas capables de comprendre ce niveau de qualité et très peu de spécialistes connaissaient ce producteur. Une amitié encore plus forte se noua avec la famille quand, trois ans plus tard, Francis, leur fils qui travaillait déjà avec eux, me fit déguster son millésime 1985. Je pris ensuite l’habitude de venir goûter les vins tranquilles à la propriété. Dans le remarquable millésime 1989, une cuve, qui se distinguait par sa force de caractère, marquait trop les assemblages. Je me souvenais de la création par Henri Krug de son fameux Clos du Mesnil, en 1979 et pour les mêmes raisons. La difficulté était que cette cuve provenait d’une vigne de pinot noir. Je réussis à convaincre facilement Francis Égly de la conserver à part et de la vendre comme un blanc de noirs. Le décret d’appellation le permettait, mais pratiquement personne n’en n’élaborait à l’époque. Michel, qui était opposé à la création de cette cuvée, pensait que personne ne comprendrait le sens de « blanc de noirs ». Heureusement, Francis ne l’écouta pas et la sortie de ce vin ne manqua pas de conquérir son importateur américain et le critique américain Robert Parker. Très vite, la cuvée devint culte et entraîna l’extraordinaire mode des blancs de noirs que tous les producteurs de champagne ou presque produisent désormais. Celui de Francis reste toujours une référence, au même titre que son génial coteaux-champenois, mais c’est une autre histoire.
Du repas le plus cher du monde à une merveille de coteaux-champenois
Remontons à la préhistoire. Au début des années 1970, j’étais un jeune adulte et le restaurant à la mode s’appelait Denis. L’endroit avait organisé, à grand renfort de publicité pour le magazine Gault & Millau, le repas le plus cher du monde. Nos duettistes reconnaissaient le génie du chef et dès que j’ai pu avoir un peu d’argent, je suis allé vérifier leur enthousiasme. Je me rappelle encore les deux vins rouges dégustés, un beaune premier cru Bressandes de chez Louis Jadot et un pinot noir de Bouzy de chez Paul Bara. Bouzy était le grand vin rouge à la mode à Paris et celui-ci était réellement délicieux, plus encore que le beaune. Hélas, tous les autres vins de Bouzy dégustés pendant les vingt ans qui ont suivi étaient désastreux, délavés, acidulés et parfois insipides. Je perdais l’espoir de retrouver un grand vin tranquille de Champagne. Un rouge des Riceys, millésime 1975, me le redonna. Aussi, dès le début de mon amitié avec la famille Égly, je n’eus de cesse d’essayer de réaliser ce rêve. Francis, le fils de Michel, le souhaitait aussi. Grâce à la qualité de sa viticulture et avec l’aide de notre ami et complice Dominique Laurent, après trois millésimes consécutifs de recherche et d’améliorations, Francis produisit le grand vin rouge que tous les observateurs considèrent comme un modèle pour la Champagne. Densité et élégance de la matière, beauté du parfum, grande possibilité de vieillissement. Aujourd’hui, tous les producteurs perfectionnistes essaient de retrouver le secret de l’élaboration de grands vins tranquilles de terroir.
Et Cristal devint cristal
Cristal est une cuvée de prestige très souvent désarmante, même pour ses élaborateurs. Quand ils la dégustaient jeune, à la fin des années 1990, Jean-Claude Rouzaud et Michel Pansu, son regretté chef de cave disparu cette année, ne la reconnaissaient pas et n’y trouvaient pas la finesse et la pureté de leur assemblage initial. Il leur fallait sept ou huit ans après dégorgement pour les retrouver. Jean-Claude Rouzaud, œnologue lui-même, et Michel Pansu divergeaient sur la façon de doser la cuvée. Jean-Claude préférait utiliser pour le dosage un vin de réserve longtemps vieilli sous foudre. Michel choisissait un vin plus jeune, souvent du même millésime, estimant qu’il s’intégrait immédiatement et avec plus de facilité. Très intelligemment, Jean-Claude eut l’idée de convoquer un petit groupe d’amis de la maison lors du dosage du cristal 1990. Il leur demanda de déguster différentes propositions à l’aveugle et d’indiquer leur préférence. J’ai eu l’honneur et le plaisir de participer à cette dégustation. Naturellement, Jean-Claude et une partie des dégustateurs eurent une légère préférence pour le dosage traditionnel. De mon côté, avec quelques autres, je préférais nettement le dosage proposé par Michel Pansu et son équipe, dont commençait à faire partie un certain Jean-Baptiste Lécaillon qui dirige aujourd’hui si brillamment toutes les propriétés de la maison. Jean-Claude s’inclina et accepta la proposition faite avec le vin du même millésime. Depuis, la cuvée a gagné un ou deux ans supplémentaires de vieillissement avant dégorgement. Le vignoble qui la produit est encore mieux défini, s’appuyant sur les sols les plus crayeux du domaine de la maison. Sa finesse, sa pureté et son caractère cristallin sont devenus encore plus évidents. Lui reste encore à gagner lors du dosage un ou deux grammes de sucre de moins comme les millésimes plus anciens désormais régulièrement remis sur le marché. Et je pourrai mourir heureux pour mes amis de la maison et tous les amateurs de ce vin incomparable.
Au nom de Saint-Thierry
Un 25 décembre, vers l’an 500. Un roi franc salien nommé Clovis se fait baptiser par l’évêque Rémi, suite à sa victoire sur les Alamans, dans l’ancienne cathédrale de Reims. On l’imagine debout dans ce qui ressemblerait à une cuve en bois de vinification remplie à moitié de liquide. Pourquoi pas du vin issu du vignoble le plus proche, à quelques kilomètres de distance, regardant un village nommé Saint-Thierry ? Quand on s’intéresse à la qualité historique des terroirs champenois, on ne comprend pas pourquoi les vignes de ce massif si réputé autrefois n’ont pas vu leur qualité reconnue par la classification commerciale officielle dont se réclament les premiers et grands crus. On se demande aussi pourquoi la légendaire veuve Clicquot avait acquis un superbe clos voisin de l’église de Saint-Thierry. Il y a plus de vingt ans, lors de mes dégustations intensives des champagnes de vignerons champenois, j’avais remarqué la qualité des vins du domaine Chartogne-Taillet, dont la propriétaire dirigeait le syndicat. Les trois beaux cépages chardonnay, pinot meunier, pinot noir, plantés sur les sols sableux de Merfy partageaient tous la même finesse. Alexandre, le fils d’Élisabeth Chartogne, considéré par Anselme Selosse comme son meilleur disciple, lui a brillamment succédé et a mis en valeur avec encore plus de précision la subtilité des différents lieux-dits de sa commune, au cœur du massif de Saint-Thierry, avec une reconnaissance internationale méritée. Restait le mystère du clos de Madame Clicquot. J’avais évoqué avec Dominique Demarville, quand il était chef de cave de la maison, la possibilité de le mettre en valeur et il était parfaitement d’accord pour le faire. J’espère qu’un jour son successeur persuadera sa direction de créer une cuvée spéciale qui serait une redécouverte d’un grand passé oublié, mais issu du patrimoine dont il a la charge.
Billecart-Salmon et le mur de barriques
Depuis les années 1980, trop de Champenois avaient abandonné la vinification en barrique, la remplaçant par des cuves en acier inoxydable. On y contrôlait plus facilement la température et l’hygiène mais, à mon sens, on y perdait en complexité. Il me semblait anormal de réserver à Krug ou Bollinger le monopole de la vinification traditionnelle. Et partout où je passais déguster les vins tranquilles, je faisais du lobbying pour convaincre les chefs de cave de revenir à la vinification sous bois. Sans grand succès, sauf chez quelques vignerons qui me confirmaient dans mes convictions. Quelques maisons avaient quand même conservé des foudres qu’elles destinaient au vieillissement des vins de réserve utilisés pour le dosage, une initiative qui m’a toujours semblé beaucoup plus discutable. L’infatigable Alexandre Bader, qui depuis si longtemps dirige commercialement la maison Billecart-Salmon, m’a heureusement pris au mot et me fit un jour, en souriant, découvrir un véritable mur de barriques dans l’impeccable chai de la maison. S’ajoute désormais une batterie superbe de foudres parfaitement entretenus qui contribuent à l’excellence et à la complexité des vins de la maison. Son exemple sera certainement imité un jour ou l’autre par toutes les grandes maisons, y compris Dom Pérignon, comme mon petit doigt me le suggère.
Renaissance de Cramant
Tout dégustateur voulant comprendre le vin de Champagne se doit de déguster quelques semaines après leur vinification les vins tranquilles qui seront la base des assemblages propres à leurs cuvées. À chaque fois que je dégustais les vins tranquilles des grandes maisons, j’étais impressionné par l’élégance, la délicatesse et la subtilité des vins du secteur de Cramant. Mais chaque fois que je dégustais un champagne issu de ce secteur, à l’exception des vins de Diebolt-Valois et de Lilbert, j’étais fort déçu par rapport à leurs pairs d’Avize, de Vertus ou du Mesnil-sur-Oger. J’avais aussi la chance de déguster très souvent les grands vins de mon ami Anselme Selosse. Un heureux hasard m’a permis il y a une dizaine d’années de rencontrer deux vignerons très motivés, habitant Cramant, Gilles Lancelot et Richard Fouquet (Champagne Guiborat). Richard fut le premier à reconsidérer sa viticulture et ses vinifications avec l’appui de Karine, son épouse, remarquable œnologue. En particulier en allongeant ses élevages sur pointe et en adoptant de mettre fin à la fermentation malolactique des vins tranquilles. Il obtient ainsi des vins d’une confondante cristallinité, en particulier sa sublime cuvée « De Caurés à Mont-Aigü ». Depuis quelques années, Gilles Lancelot a lui aussi magnifiquement affiné son étonnante cuvée Marie et sa bien nommée cuvée Table Ronde, son épouse cordon bleu étant née Perceval. Son fils l’ayant rejoint, ils ont créé un délicat champagne rosé astucieusement appelé La Dame du Lac. Les bulles sont légères, le goût exquis et ces vins font honneur à leur village.
La création des Cintres
Mes vingt-deux ans passés à la direction de La Revue du vin de France ont suivi le sillage tracé par son fondateur, Raymond Baudoin, qui avait persuadé un membre de la famille Collard, au début des années 1950, de commercialiser le vin qu’il produisait sur le magnifique coteau des Goisses sous le nom de Clos des Goisses, pour imiter les clos célèbres de Bourgogne et leur avantage commercial de monopole. J’ai évidemment suivi les différents millésimes de cette cuvée que Raymond Baudouin avait inscrite sur la carte des vins de grands restaurants étoilés, sous l’égide de l’Académie du vin de France dont il était l’un des fondateurs. Tout naturellement, lorsque Charles Philipponnat a repris la direction de la maison qui porte le nom de son grand-père, j’étais présent au moment des vendanges pour goûter les vins tranquilles. L’amitié immédiate qui est née entre nous me permit de discuter librement du style de cette cuvée Clos des Goisses et du caractère unique et magnifique de son vin. Une seule chose me gênait un peu. Sur ce coteau incomparable, pinot noir et chardonnay sont marqués par leur terroir, mais je pensais qu’une cuvée de pur pinot noir serait capable de rivaliser avec celle que mon ami Francis Égly produisait depuis quelques années à Ambonnay, avec peut-être encore plus de minéralité. La mode des grands blancs de noirs étant désormais bien installée en Champagne, Charles n’a pas eu trop de mal à sélectionner quelques barriques de pinot noir issu du secteur le plus éloquent du coteau pour ce cépage. Ainsi est née la merveilleuse et rare cuvée Les Cintres. J’espère que d’autres lieux-dits exceptionnels en tant que grands terroirs de pinot noir produiront eux aussi leur blanc de noirs. Je crois savoir que quelques-uns sont en préparation.
Les fêtes en grand format
Champagne Philipponnat, Clos des Goisses 2013
Installée à Aÿ et Mareuil-sur-Aÿ, la maison Philipponnat poursuit depuis cinq siècles une histoire familiale intimement liée à ces terroirs d’exception. Si toute sa gamme mérite l’attention, elle doit sa renommée au Clos des Goisses, acquis en 1935, et qui est le plus vaste clos de la Champagne (cinq hectares et demi en pente abrupte) dominant la Marne.
Sous l’impulsion de Charles Philipponnat depuis le début des années 2000, la maison n’a cessé de gagner en précision, en cave comme au vignoble, où les équipes veillent avec rigueur au respect des gestes essentiels pour préserver ce patrimoine unique. Les champagnes affichent un style reconnaissable entre tous : complexe, riche et d’une grande précision aromatique. Cette cuvée offre une magnifique expression du terroir, magnifiée par une fermentation sous bois parfaitement maîtrisée. On apprécie le charisme et l’intensité de ce millésime 2013, aux nobles notes de fruits jaunes mûrs et à la vinosité affirmée.
97/100 – 640 euros le magnum disponible ici
Château de Beaucastel 2021, châteauneuf-du-pape
Depuis 1909, cette propriété emblématique de Châteauneuf-du-Pape appartient à la famille Perrin, qui en a fait une référence incontournable et un vignoble d’excellence, produisant des vins grandioses et profondément identitaires dans les deux couleurs. Le domaine repose sur un encépagement complexe où le mourvèdre, présent sur près d’un tiers des surfaces, apporte structure et profondeur, tandis que le grenache confère finesse et fraîcheur, atouts précieux face au réchauffement climatique. Le nouveau chai, bioclimatique et construit avec des matériaux durables, témoigne de l’engagement de cette famille passionnée en faveur d’une viticulture d’avenir. Superbe nez, aux senteurs de poivre blanc et de tabac, déjà avenant et ouvert, la bouche de ce 2021 se révèle pleine, caressante, d’une grande tendreté de tannin. Un grand vin, vibrant de vigueur et de classe.
95/100 – 206 euros le magnum disponible ici
Domaine Faiveley, La Framboisière (monopole) 2022, mercurey
La famille Faiveley a bâti au fil des générations l’un des domaines majeurs de Bourgogne, devenu aujourd’hui un ambassadeur incontournable des grands pinots noirs et chardonnays dans le monde. Elle propose des vins remarquables à tous les niveaux de prix, sans jamais renoncer à une exigence de qualité et de style constamment réaffirmée. Sous l’impulsion d’Erwan et Eve Faiveley, l’équipe actuelle conduit le domaine avec une maîtrise qui permet à l’ensemble de la gamme d’afficher une régularité exemplaire. Ce pinot noir porte admirablement son nom : typé par son terroir, il dévoile des saveurs intenses de fruits rouges (framboise), relevées par de délicates notes de cuir noble. La bouche offre complexité, précision et une finale ciselée.
92/100 – 87 euros le magnum disponible ici
Château Haut-Bailly, Haut-Bailly·II 2021, pessac-léognan
Régulièrement citée parmi les pessac-léognan les plus remarquables de l’appellation, cette propriété, reprise en 1998 par la famille Wilmers, s’appuie sur un vignoble de 30 hectares qui demeuré inchangé depuis le XIXe siècle. Son patrimoine végétal exceptionnel (certains pieds atteignant 120 ans) est entretenu avec un soin exemplaire par une équipe technique performante, administrée avec passion par Véronique Sanders et dirigée sur le plan œnologique par Gabriel Vialard. Second vin de la propriété, Haut-Bailly II se distingue par une régularité sans faille et une élégance évidente. Cet assemblage classique séduit par sa précision et sa gourmandise, tout en conservant une finesse remarquable. Un 2021 accessible, déjà délicieux, mais promis à un bel avenir.
91/100 – 80 euros le magnum disponible ici
Domaine Antoine Sanzay, La Paterne 2022, saumur-champigny
Antoine Sanzay cultive ses 12 hectares en agriculture biologique certifiée et signe des vins qui brillent par leur finesse et leur fraîcheur. Ces derniers millésimes ont vu l’ensemble de la gamme gagner en élégance et en définition de texture, tout en affirmant un véritable caractère ligérien : fruit éclatant, tension et fraîcheur. Pur cabernet franc, la cuvée Paterne se déguste avec un plaisir immédiat et séduit par un fruit parfaitement exprimé, porté en bouche par un tanin juteux et sphérique, et par une belle gourmandise.
92/100 – 35 euros le magnum disponible ici
Château de Pressac 2022, saint-émilion grand cru
Depuis 1997, Jean-François Quenin consacre toute son énergie à ce cru qu’il a patiemment replanté. Implanté sur une veine argilo-calcaire à sol rouge, le vignoble de 40 hectares s’étend jusqu’à Saint-Étienne-de-Lisse, au cœur d’un secteur particulièrement intéressant de l’appellation saint-émilion. Les vins, d’une régularité exemplaire, se distinguent par une profondeur vibrante, un raffinement de texture remarquable et un caractère aromatique complexe et singulier. Une propriété à suivre de près, d’autant que les prix demeurent très sages. Grande réussite pour ce 2022 charmeur, qui allie complexité et profondeur en bouche, avec une finale intense et aérienne, marquée par des notes de bulbe d’iris et de craie. Un vin enthousiasmant.
96/100 – 69 euros le magnum disponible ici