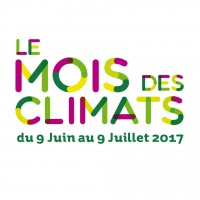Odilon de Varine n’a pas fait ces Gosset 83, 85, 86, car il vinifiait à l’époque dans la propriété familiale du Mâconnais. Mais le directeur général et chef de cave de Gosset poursuit avec finesse et talent le style maison !
La nouvelle vie de Laurent Ponsot
Laurent Ponsot, 63 ans, a quitté l’exploitation familiale de Morey-Saint-Denis pour créer une société de négoce. Il a laissé les rênes du domaine Ponsot « du jour au lendemain » a sa sœur Rose-Marie. Une évolution imprévue sur laquelle Laurent Ponsot n’a pas souhaité épiloguer préférant se consacrer à sa nouvelle activité créée avec son fils ainé Clément, 37 ans. Il a démenti au passage les rumeurs voyant dans cette actualité les prémices d’une vente du domaine.
Laurent Ponsot part avec les « contrats » de négoce qu’il avait développé (le domaine Ponsot est aussi négociant depuis 1989). Des vins issus d’achats de raisins et donc vinifiés sous sa férule. Dans certains cas les vignes sont cultivées directement par la maison. La maison Laurent Ponsot est basée à Gilly-lès Cîteaux, près de Vougeot.
Des très belles références figurent à la gamme et une production de 30 000 bouteilles est prévue à terme (millésime 2017).
La gamme de départ comprend notamment des grands crus chambertin, griotte-chambertin, clos saint-denis, mais aussi le premier cru chambolle-musigny Les Charmes. Elle sera également bien étoffée en blancs de la Côte de Beaune : grands crus montrachet et corton-charlemagne, mais aussi meursault premiers crus Genevrières, Charmes, Perrières et Blagny.
Laurent Ponsot reste propriétaire à 25% du Groupement foncier agricole du domaine Ponsot.
Laurent Gotti
Château Batailley 1881-2010, l’incroyable verticale
Un beau plateau graveleux entre Pauillac et Saint-Laurent-Médoc a sans doute été le théâtre d’affrontements entre Anglais et Français pendant la guerre de Cent Ans, sur des terres qui n’étaient probablement pas plantées de vignes connues, ce qui a naturellement donné son nom au lieu-dit. Les vignes furent plutôt plantées au XVIIe siècle et ont acquis progressivement après 1800 une notoriété telle que le vignoble fut classé cinquième cru en 1855. Depuis les années 1920, il est intimement lié à la famille Borie, d’origine corrézienne, unie par mariages successifs à une autre famille corrézienne, les Castéjà. Un important patrimoine foncier s’est ainsi ajouté à des activités prospères de négoce, avec en particulier les firmes Borie-Manoux, Joanne et, désormais, Mähler-Besse. Francis Borie achète Ducru-Beaucaillou en 1941, vingt ans après que son père Eugène et son oncle Émile ont acheté Batailley. Jean-Eugène, fils de Francis, achètera Grand-Puy-Lacoste en 1978. Une succession Borie-Castéja entraîne la division de Batailley en deux fractions. La plus grande revient à Émile Castéja et forme le château Batailley actuel et la plus petite, située autour d’une tour surmontée d’une Vierge foulant le diable, sous forme d’aspic, constitue Château Haut-Batailley. Il est dirigé par François-Xavier Borie, le neveu de la propriétaire, Madame des Brest-Borie. Philippe Castéja, président de l’association des crus classés de 1855, a pris le relais de son père Émile à la direction de Batailley et ne cesse de perfectionner une viticulture et une vinification qui étaient déjà de qualité. Notons le rôle majeur du regretté Denis Dubourdieu dans le renouveau de Batailley. Pour montrer la continuité du travail accompli par sa famille, Philippe Castéja (photo) a organisé au printemps, à l’ouverture des primeurs 2015, une dégustation remarquablement ordonnée où il a présenté douze millésimes allant de 2003 à 1881. Le plus ancien, on le verra, était loin d’être le moins éblouissant. Je ne note aucun vin, les millésimes anciens interdisant toute utilisation d’une échelle de notes commune avec les vins récents.
2010
Grande robe, vin complet, puissant, harmonieux, remarquablement vinifié et élevé, au tout début d’une glorieuse carrière. Mais, et c’est le propre des vins de notre temps, bien décanté comme il l’a été, il est loin d’être rugueux ou inapprochable, la maturité du raisin et la finesse de l’extraction donnant à la texture et aux sensations tactiles beaucoup d’attractivité immédiate.
2005
Vin net, certainement élégant et très classique dans ses proportions, mais sans la longueur et la distinction du 2010 ni l’ampleur de texture du 2003. Il renforce le sentiment de sa puissance à l’aération, mais il n’est certainement pas prêt à boire.
2003
Année de canicule, parmi les plus précoces depuis 1855, mais pas vraiment pour le cœur du Médoc qui a vendangé ses cabernets après la mi-septembre et des pluies ayant en partie rééquilibré la qualité des raisins. À Batailley, la chair du vin est celle d’un grand millésime, avec une onctuosité crémeuse vraiment rare, mais le nez, tout en puissance, trahit quand même les effets de la canicule de juillet et août, avec des notes de prune et une pointe de cacao. Mais il n’y a aucune trace de saveur ranciotée indiquant un vieillissement prématuré et la persistance très importante du vin en bouche laisse penser qu’il n’a pas fini de nous étonner.
2000
Un vin droit et strict, mais un peu simple en comparaison avec de nombreux autres millésimes. Quelques nuances rappelant le fer ou le cuivre durcissent le fruit et la fin de bouche. Il donne le sentiment d’une autre époque de vinification.
1982
Année célèbre par son abondance, sa qualité et son incroyable succès commercial, qui a définitivement installé les grands vins de Bordeaux au sommet du marché international tout en propulsant un critique américain jusqu’alors inconnu, Robert Parker, brillant défenseur du millésime, un peu isolé au sein de professionnels qui ont eu le tort mortel de ne pas y croire. La robe est acajou, très caractéristique de vin trentenaire, le nez se développe avec une rare ampleur et harmonie sur des notes très racées de fleur, surgissant d’un arrière-plan plus animal et musqué, très sensuel. Le retour de bouche est très frais, sur le menthol et les infinies nuances qui sont le propre des grands terroirs de graves.
1961
Nez très puissant, mais curieusement marqué « poivron » pour un millésime légendaire réputé mûr et concentré. Une matière certainement riche, mais en fin de bouche un sentiment de relative simplicité. Le bouchon n’est peut-être pas parfait, sans qu’on puisse vraiment définir le défaut. Cela arrive suffisamment souvent avec les vieilles bouteilles pour mettre en garde les amateurs devant les prix extravagants que ces 1961 atteignent aujourd’hui.
1949 (en magnum)
Toute la double magie d’une bouteille parfaite de grand millésime arrivé à glorieuse maturité et d’un grand pauillac : merveilleuse texture, saveur ample, racée, de tabac et de cèdre, parfums irradiant littéralement le verre, longueur incroyable, sentiment de plénitude et de suspension du temps. Le type d’émotion qui vous attache à jamais à ces grands terroirs.
1945
Le vin n’est pas épais ou ultra dense comme cela arrive parfois avec ce millésime (peut-être quand il a été « aidé » par quelques potions pas du tout magiques), avec un soupçon de senteurs de vieille cave (le mystérieux goût de presbytère) et une acidité encore assez pointue, à l’opposé de la divine harmonie du 1949. Mais il y a naturellement d’immenses qualités de complexité dans le soutien du tannin.
1929
Un peu de trouble dans la robe vieil acajou, acidité totale ou sentiment d’acidité bien supérieur à ce à quoi nous sommes habitués, mais qui n’est pas incompatible avec un sentiment de suavité et de moelleux, complètement absent du 1945, de la même famille que le 1949. Vin long, pas vraiment parfait, mais émouvant par ce qu’il nous dit, même de manière approximative, d’un très grand millésime.
1900
On passe volontiers sur quelques petits accrocs volatils au nez que nous ne permettons plus à nos millésimes modernes. Quelle splendeur de sève et quel raffinement de texture et de saveur. Un festival d’épices douces, de notes tertiaires s’enchaînant avec grâce l’une après l’autre, un tannin fondu, une finesse de saveur vraiment mémorable. Ce type de bouteille et d’émotion n’est pas oubliable et permet de comprendre la légende entourant le millésime.
1881
Le millésime n’a apparemment jamais eu de notoriété, appartenant aux années ravagées par le phylloxera. Michael Broadbent, qui a tout bu et tout noté dans son fameux livre de dégustation Vintage Wine, le juge vert, acide et de toute petite qualité. Mais Philippe Castéja, qui connaît la cave paternelle, a plus que bien fait de l’offrir en point d’orgue. La vérité étant dans le verre, le mien, et sans doute celui de mes voisins, ne pouvait que faire fondre de plaisir devant la délicatesse infinie du nez et ses notes florales qui pourraient donner des leçons au plus fin des pinots noirs et la grâce d’une bouche où alcool et tannin sont divinement harmonisés. On a le sentiment que le vin a perdu toute relation avec la terre pour danser dans les airs. Merveilleuse doyenne des Français, cette bouteille est d’autant plus attachante qu’elle se double d’une prodigieuse surprise.
Château Batailley 1881-2010, l'incroyable verticale
Un beau plateau graveleux entre Pauillac et Saint-Laurent-Médoc a sans doute été le théâtre d’affrontements entre Anglais et Français pendant la guerre de Cent Ans, sur des terres qui n’étaient probablement pas plantées de vignes connues, ce qui a naturellement donné son nom au lieu-dit. Les vignes furent plutôt plantées au XVIIe siècle et ont acquis progressivement après 1800 une notoriété telle que le vignoble fut classé cinquième cru en 1855. Depuis les années 1920, il est intimement lié à la famille Borie, d’origine corrézienne, unie par mariages successifs à une autre famille corrézienne, les Castéjà. Un important patrimoine foncier s’est ainsi ajouté à des activités prospères de négoce, avec en particulier les firmes Borie-Manoux, Joanne et, désormais, Mähler-Besse. Francis Borie achète Ducru-Beaucaillou en 1941, vingt ans après que son père Eugène et son oncle Émile ont acheté Batailley. Jean-Eugène, fils de Francis, achètera Grand-Puy-Lacoste en 1978. Une succession Borie-Castéja entraîne la division de Batailley en deux fractions. La plus grande revient à Émile Castéja et forme le château Batailley actuel et la plus petite, située autour d’une tour surmontée d’une Vierge foulant le diable, sous forme d’aspic, constitue Château Haut-Batailley. Il est dirigé par François-Xavier Borie, le neveu de la propriétaire, Madame des Brest-Borie. Philippe Castéja, président de l’association des crus classés de 1855, a pris le relais de son père Émile à la direction de Batailley et ne cesse de perfectionner une viticulture et une vinification qui étaient déjà de qualité. Notons le rôle majeur du regretté Denis Dubourdieu dans le renouveau de Batailley. Pour montrer la continuité du travail accompli par sa famille, Philippe Castéja (photo) a organisé au printemps, à l’ouverture des primeurs 2015, une dégustation remarquablement ordonnée où il a présenté douze millésimes allant de 2003 à 1881. Le plus ancien, on le verra, était loin d’être le moins éblouissant. Je ne note aucun vin, les millésimes anciens interdisant toute utilisation d’une échelle de notes commune avec les vins récents.
2010
Grande robe, vin complet, puissant, harmonieux, remarquablement vinifié et élevé, au tout début d’une glorieuse carrière. Mais, et c’est le propre des vins de notre temps, bien décanté comme il l’a été, il est loin d’être rugueux ou inapprochable, la maturité du raisin et la finesse de l’extraction donnant à la texture et aux sensations tactiles beaucoup d’attractivité immédiate.
2005
Vin net, certainement élégant et très classique dans ses proportions, mais sans la longueur et la distinction du 2010 ni l’ampleur de texture du 2003. Il renforce le sentiment de sa puissance à l’aération, mais il n’est certainement pas prêt à boire.
2003
Année de canicule, parmi les plus précoces depuis 1855, mais pas vraiment pour le cœur du Médoc qui a vendangé ses cabernets après la mi-septembre et des pluies ayant en partie rééquilibré la qualité des raisins. À Batailley, la chair du vin est celle d’un grand millésime, avec une onctuosité crémeuse vraiment rare, mais le nez, tout en puissance, trahit quand même les effets de la canicule de juillet et août, avec des notes de prune et une pointe de cacao. Mais il n’y a aucune trace de saveur ranciotée indiquant un vieillissement prématuré et la persistance très importante du vin en bouche laisse penser qu’il n’a pas fini de nous étonner.
2000
Un vin droit et strict, mais un peu simple en comparaison avec de nombreux autres millésimes. Quelques nuances rappelant le fer ou le cuivre durcissent le fruit et la fin de bouche. Il donne le sentiment d’une autre époque de vinification.
1982
Année célèbre par son abondance, sa qualité et son incroyable succès commercial, qui a définitivement installé les grands vins de Bordeaux au sommet du marché international tout en propulsant un critique américain jusqu’alors inconnu, Robert Parker, brillant défenseur du millésime, un peu isolé au sein de professionnels qui ont eu le tort mortel de ne pas y croire. La robe est acajou, très caractéristique de vin trentenaire, le nez se développe avec une rare ampleur et harmonie sur des notes très racées de fleur, surgissant d’un arrière-plan plus animal et musqué, très sensuel. Le retour de bouche est très frais, sur le menthol et les infinies nuances qui sont le propre des grands terroirs de graves.
1961
Nez très puissant, mais curieusement marqué « poivron » pour un millésime légendaire réputé mûr et concentré. Une matière certainement riche, mais en fin de bouche un sentiment de relative simplicité. Le bouchon n’est peut-être pas parfait, sans qu’on puisse vraiment définir le défaut. Cela arrive suffisamment souvent avec les vieilles bouteilles pour mettre en garde les amateurs devant les prix extravagants que ces 1961 atteignent aujourd’hui.
1949 (en magnum)
Toute la double magie d’une bouteille parfaite de grand millésime arrivé à glorieuse maturité et d’un grand pauillac : merveilleuse texture, saveur ample, racée, de tabac et de cèdre, parfums irradiant littéralement le verre, longueur incroyable, sentiment de plénitude et de suspension du temps. Le type d’émotion qui vous attache à jamais à ces grands terroirs.
1945
Le vin n’est pas épais ou ultra dense comme cela arrive parfois avec ce millésime (peut-être quand il a été « aidé » par quelques potions pas du tout magiques), avec un soupçon de senteurs de vieille cave (le mystérieux goût de presbytère) et une acidité encore assez pointue, à l’opposé de la divine harmonie du 1949. Mais il y a naturellement d’immenses qualités de complexité dans le soutien du tannin.
1929
Un peu de trouble dans la robe vieil acajou, acidité totale ou sentiment d’acidité bien supérieur à ce à quoi nous sommes habitués, mais qui n’est pas incompatible avec un sentiment de suavité et de moelleux, complètement absent du 1945, de la même famille que le 1949. Vin long, pas vraiment parfait, mais émouvant par ce qu’il nous dit, même de manière approximative, d’un très grand millésime.
1900
On passe volontiers sur quelques petits accrocs volatils au nez que nous ne permettons plus à nos millésimes modernes. Quelle splendeur de sève et quel raffinement de texture et de saveur. Un festival d’épices douces, de notes tertiaires s’enchaînant avec grâce l’une après l’autre, un tannin fondu, une finesse de saveur vraiment mémorable. Ce type de bouteille et d’émotion n’est pas oubliable et permet de comprendre la légende entourant le millésime.
1881
Le millésime n’a apparemment jamais eu de notoriété, appartenant aux années ravagées par le phylloxera. Michael Broadbent, qui a tout bu et tout noté dans son fameux livre de dégustation Vintage Wine, le juge vert, acide et de toute petite qualité. Mais Philippe Castéja, qui connaît la cave paternelle, a plus que bien fait de l’offrir en point d’orgue. La vérité étant dans le verre, le mien, et sans doute celui de mes voisins, ne pouvait que faire fondre de plaisir devant la délicatesse infinie du nez et ses notes florales qui pourraient donner des leçons au plus fin des pinots noirs et la grâce d’une bouche où alcool et tannin sont divinement harmonisés. On a le sentiment que le vin a perdu toute relation avec la terre pour danser dans les airs. Merveilleuse doyenne des Français, cette bouteille est d’autant plus attachante qu’elle se double d’une prodigieuse surprise.
Dix ans de bio à Lalande-de-Pomerol
Fruit d’une longue histoire, le vignoble du château des Annereaux est mené depuis des siècles par la même famille (son installation sur cette propriété date de la fin du XIVe siècle). Qu’il s’agisse de préserver ou d’améliorer le domaine, chaque génération « s’est investie avec passion dans son développement. » Aujourd’hui mené par Benjamin Hessel, qui a succédé à son père Dominique, le château des Annereaux célèbre avec le dernier millésime dix ans de pratique de l’agriculture biologique, une démarche entamée après une transition effectuée dans le cadre de l’agriculture raisonnée.
Cette propriété de 25 hectares a récemment bénéficié d’une rénovation de son cuvier, de son chai à barriques et de ses bâtiments techniques. « Tout en conservant leur âme à ces lieux (les cuves en béton plus que centenaires ont été conservées) », les améliorations ont permis d’intégrer les derniers progrès techniques. C’est ce que découvriront les professionnels du vin le 30 mars prochain lors de la dégustation verticale organisée par Dominique et Benjamin Hessel. Au programme, tous les millésimes produits depuis le début de la conversion au bio dont, évidemment, le millésime 2016 en primeur.
Plus de trente médailles en trois concours
Les artisans vignerons des caves de Vacqueyras et de Beaumes-de-Venise réunis sous la bannière Rhonéa (236 domaines, 2 000 hectares de vignes) ont reçu une pluie de récompenses pour leur travail lors de l’édition 2017 du concours des vins d’AOC ventoux (trois médailles d’or, deux d’argent), du concours des vins d’Orange (huit médailles d’or, neuf d’argent) et du concours général agricole de Paris (huit médailles d’or, cinq médailles d’argent). Toutes ces cuvées issues de la récolte 2016 et des terroirs situés au pied des Dentelles de Montmirail sont à découvrir sur le site de Rhonéa, c’est par là.
Appel à projets
Il reste un peu plus de deux semaines aux professionnels – de la filière viticole, du tourisme, de la culture, etc. – comme aux particuliers pour proposer un événement susceptible de s’inscrire dans le cadre du Mois des Climats qui se tiendra en Bourgogne du 9 juin au 9 juillet.
A l’occasion de la célébration des 80 ans de la route des grands crus de Bourgogne, l’édition 2017 du rendez-vous dédié à ce patrimoine viticole désormais inscrit sur la liste de l’Unesco sera organisée conjointement par l’association des climats du vignoble de Bourgogne, le conseil départemental de la Côte-d’Or et Côte-d’Or Tourisme et marquera l’un des temps forts de cette année-anniversaire.
Pour partager « votre vision des climats », il faut répondre aux critères de sélection listés ici et déposer votre dossier d’inscription avant le 31 mars. Parmi ces projets, certains bénéficieront de prix « coup de cœur » et d’autres d’un « coup de pouce », soit une aide financière pouvant aller jusqu’à 2 000 euros.
Bordeaux GCC quintessential – 1961 comparative tasting
Retour en image sur la dégustation comparative de six grands crus classés de Bordeaux millésime 1961. Cette masterclass s’est déroulée le dimanche 12 mars à 11 heures au Park Hyatt à l’occasion de la cinquième édition du Grand Tasting Shanghai. Un grand moment de dégustation.
Château Lafite Rothschild, pauillac, 1er grand cru classé
Château Latour, pauillac, 1er grand cru classé
Château Margaux, margaux, 1er grand cru classé
Château Haut-Brion, pessac-léognan, 1er grand cru classé
Château Mouton-Rothschild, pauillac, 2e grand cru classé
Château Ausone, saint-émilion, grand cru classé
Louis Latour, les cortons en bandoulière
Longue dynastie de tonneliers devenus négociants-vignerons, les Latour incarnent une certaine idée de la Bourgogne, celle où les changements de style sont imperceptibles, mais où la société évolue vers la modernité de façon spectaculaire. De la vigne à la bouteille, retour sur les moments importants en compagnie de Louis-Fabrice Latour, la dixième génération
L’automobiliste qui empreinte l’autoroute du Soleil en venant du Nord est toujours saisi du spectacle qui s’offre à lui lorsqu’il arrive à hauteur de Beaune : tous les premiers crus de la capitale du vin de Bourgogne, impeccablement alignés et, en sentinelle, la colline de Corton capte les derniers rayons de soleil de la fin de journée du fait de son avancée vers la plaine. Corton et Corton-Charlemagne, deux des plus fameux terroirs de la légendaire Bourgogne. Le seul secteur, aussi, à briller en blanc avec le chardonnay et en rouge avec le pinot noir, ce que les appellations contrôlées ont reconnu dès 1936 avec le classement en grand cru.
Si la colline impressionne par son implantation dans le paysage, elle occupe aussi une place de choix en raison des domaines qui la mettent en valeur, puisqu’ici certaines exploitations sont de taille plus que respectable pour une Bourgogne qui, depuis la suppression du droit d’aînesse, pratique un morcellement systématique de la moindre parcelle réputée, succession après succession. Ainsi de la maison Louis Latour, l’un des grands ambassadeurs de Bourgogne dans le monde, pilier de la place de Beaune comme en atteste les bureaux encore situés au cœur de la ville et ses vieilles caves en pierre, vestiges d’une présence et d’un rayonnement séculaires.
Latour. Louis Latour. Il faut préciser, c’est un patronyme assez répandu dans le vignoble, avec même d’illustres confrères au style de vin tout aussi recherché, mais différent. Une maison familiale, l’une des dernières de la Bourgogne. Une maison séculaire, fondée en 1797, mais dont les premières acquisitions de vignes remontent à 1731. Une maison intégrée, maîtrisant le processus de la vigne à la cave, évidemment, mais aussi les fûts, les Latour ayant progressivement basculé du métier de tonneliers à celui de négociants. D’ailleurs, l’adresse historique de la maison se situe au 18, rue des Tonneliers, à Beaune. Dixième génération de Latour à œuvrer pour la prospérité de la famille, et septième à se prénommer Louis, Louis-Fabrice Latour marche dans les pas de ses prédécesseurs et apporte lui aussi sa pierre à l’édifice.
48 hectares en propriété
À l’instar de ses consœurs de la place de Beaune, Louis Latour porte la double casquette de maison de négoce et de propriétaire viticole. Aujourd’hui, la maison produit au total quelques six millions de cols, tous vignobles et toutes régions confondues et les volumes achetés représentent plus de 60 %. En Côte d’Or, le patrimoine viticole Latour est de premier plan : 48 hectares de vignes, dont 28 en grand cru. Le fer de lance de ce vignoble se situe sur la colline de Corton, où la maison détient le principal domaine, et de loin. Là, elle possède 25 hectares, 14 en corton (rouge), 11 en corton-charlemagne (blanc). Les autres grands crus en exploitation sont le chambertin (0,8 hectare), la romanée-saint-
vivant (0,8 hectare), le chevalier-montrachet (0,5 hectare) et le bâtard-montrachet (0,5 hectare). À l’exception du bâtard-montrachet, toutes les vignes en grand cru sont en propriété, des chiffres qui font rêver au regard de la valeur du foncier dans le secteur.
Le vignoble ne se limite pas à la seule Côte d’Or, la maison Louis Latour en dépasse largement les frontières. Elle est également propriétaire du domaine de Valmoissine depuis 1989, de Simonnet-Febvre depuis 2003, d’Henry Fessy depuis 2008. Valmoissine, dans le Var, c’est 120 hectares de pinot noir. Outre de nombreux achats pour ses crémants de Bourgogne et ses vins tranquilles de l’Yonne, Simonnet-Febvre exploite cinq hectares à Chablis (en appellations chablis et chablis premier cru Mont de Milieu) et, depuis peu, 15 hectares dans le méconnu vignoble de l’Auxois, à mi-chemin entre Auxerre et Beaune. Enfin, Henry Fessy, célèbre maison du Beaujolais, est propriétaire de 70 hectares avec une présence dans neuf des dix crus de la région. Sans oublier l’Ardèche, où certes la maison ne possède pas de vignes, mais achète du raisin depuis 1979 pour réaliser une gamme de chardonnays impeccable par son rapport qualité-prix.
Ni désherbants, ni engrais chimiques, ni insecticides
Boris Champy, le directeur du vignoble, l’avoue sans détour : « Sur nos 48 hectares de vignes en Côte d’Or, nous ne sommes pas en bio, mais en lutte raisonnée. Nous avons cinq hectares que nous travaillons en bio, notamment la parcelle des Chaillots, qui entoure le château Corton-Grancey. Nous avons une certification environnementale ISO 14 001, ce qui nous permet de montrer aux marchés export que nous sommes audités sur ce sujet, mais la conversion n’est pas à l’ordre du jour. En revanche, depuis 2008, nous n’utilisons plus de désherbants sur l’ensemble de nos vignes. Ni d’engrais chimique, ni d’insecticide, ni d’anti-botrytis. Nous continuons toutefois à effectuer un ou deux traitements contre le mildiou, au moment de la fleur. Une année comme 2016 nous donne évidemment raison, être en bio dans des conditions aussi compliquées relève de la mission impossible, dans l’absolu et, à plus forte raison, sur une telle surface. En revanche, la maison n’a jamais arrêté le travail des sols. Même lorsque mes prédécesseurs avaient recours au désherbage, dans les années 80-90, comme tout le monde à l’époque, nos vignes étaient toujours labourées, si bien qu’on ne peut pas parler d’évolution radicale, mais plutôt d’un changement dans la durée. On essaie aussi de lutter intelligemment contre l’érosion, notamment en adaptant le travail du sol à la pente. Ainsi, on ne butte le pied que dans le bas du coteau. Si on le fait au cœur de la pente, l’eau peut alors prendre de la vitesse et le sol se dénude. En Bourgogne, peut-être plus encore que dans d’autres vignobles compte tenu de l’extrême morcellement des parcelles et du très grand nombre d’exploitants, il faut avoir une vision verticale de l’écoulement des eaux. Celui qui se situe en haut doit veiller à ne pas envoyer d’eau sur celui qui est en-dessous, il s’agit là de bon sens, mais aussi d’une approche collective du métier, c’est important. »
Sur la colline de Corton, une association regroupant soixante viticulteurs s’est créée, “Paysages de Corton”, avec l’idée de faire progresser les pratiques vigneronnes. L’une de ses mesures a été d’installer des ruches disséminées sur la colline. Le message est double. D’une part, les vignerons sont fiers d’offrir du miel issu de leurs vignes et, d’autre part, les abeilles étant particulièrement sensibles aux insecticides, les vignerons comprennent qu’ils ne doivent plus en répandre. Parmi les pratiques anciennes toujours en vigueur ici, la maison impose des repos de trois années à chaque parcelle avant replantation, dont deux années de jachère plantée (moutarde, avoine), les plantes semées apportant alors de la matière organique dans les sols que les vers de terre descendent en profondeur et les abeilles trouvent là une diversité de fleurs à butiner.
La quête de l’équilibre sucre-acide
Comme la plupart des maisons et vignerons de Bourgogne, Louis Latour a un vignoble où les sélections clonales de pinot noir sont nombreuses. Pour mettre au point des sélections plus fines de pinot noir et de chardonnay, une quarantaine de domaines et maisons prestigieuses de Bourgogne (dont Louis Latour, le domaine de la Romanée-Conti, le Clos de Tart, Bouchard Père et Fils, le domaine Dujac, etc.) ont uni leurs efforts pour sélectionner les meilleurs plants dans leurs parcelles, en éliminant tous les porteurs de virose. Une parcelle de comportement d’un hectare et demi a même été plantée et les premiers bois en seront tirés prochainement. Les attentes sont très fortes, certains de ces plants résistant naturellement au botrytis. Il est vrai que de nombreux clones actuels laissent à désirer. La plupart ont été sélectionnés dans les années 70, période où les raisins donnaient peu de sucre, ce qui eut pour conséquence une sur-représentation de plants offrant plus de sucre que la moyenne. Hélas, quand le climat s’est réchauffé, quelques décennies plus tard, cet atout est devenu un handicap. Ainsi, en 2015, année chaude en Bourgogne s’il en est, Boris Champy a relevé que là où les clones affichaient facilement 13°5 au mustimètre, les sélections fines récentes ne dépassaient pas 12,5-13°. Entre le vieillissement général du vignoble, les différents virus et maladies du bois qui prolifèrent, le travail des sols qui coupe les racines et élimine quelques pieds de plus, un vaste programme de replantation est en cours, débuté en 2009 sur les corton-bressandes.
Ces nouveaux plants devraient également permettre de faire évoluer les vins vers un style plus qualitatif et plus fin. Comme le souligne Boris Champy, « On parle beaucoup du réchauffement climatique et on l’accuse de faire monter trop haut les degrés en sucre, mais le matériel végétal participe aussi au fait qu’aujourd’hui on a des vins avec plus d’alcool et moins d’acidité que par le passé, et là les clones sont pointés du doigt. Avec nos sélections fines, on devrait être capables de revenir vers l’équilibre sucre-acide qu’on préfère. C’est beaucoup de travail, mais c’est un travail de vigneron. Observer nos parcelles, sélectionner nos vieilles vignes, c’est la base de notre métier. »
150 cuvées, six millions de bouteilles
En cave, une équipe s’affaire à produire quelques 150 cuvées. Articulée autour de Jean-Pierre Thomas, chef de caves, et de son œnologue Nathalie Bobard, elle a su accompagner l’essor des ventes des années 2000, consécutif à l’arrivée de Louis-Fabrice Latour à la tête de la maison, lorsque les volumes sont passés annuellement de 4 à 7,5 millions de bouteilles, pour redescendre depuis la crise à 6 millions environ, dans un contexte tarifaire en forte hausse. Le style de la maison a assez peu varié au fil des ans. Ici, le processus de vinification est le même, que le raisin provienne du domaine ou du négoce. Les vendanges sont manuelles, il en a toujours été ainsi (seul le vignoble ardéchois est vendangé à la machine). Sur le corton-charlemagne, les chardonnays sont ramassés dans de gros paniers en osier de 40 kg, comme autrefois. Tous les pinots noirs sont ramassés depuis 2012 dans de petites caisses grillagées de 12 kg, permettant aux jus non désirés de s’écouler avant l’arrivée au chai.
Les blancs ne sont jamais bâtonnés
Les blancs sont pressés en grappe entière dans un pressoir pneumatique. « Pas de débourbage », insiste Jean-Pierre Thomas, « il en a toujours été ainsi, et j’y tiens beaucoup. Quand la vendange est saine, les odeurs de réduction ne me dérangent pas lorsque le vin est sur ses lies avant la malo. Ces odeurs parfois désagréables partiront par la suite, mais ainsi le vin est-il protégé de l’oxydation, et les lies vont nourrir le vin durant la fermentation. » Afin de contrôler les températures, toutes les fermentations alcooliques démarrent en cuve inox puis, à mi-fermentation, les vins sont entonnés. La part de fût neuf va varier, de 25 % pour les appellations village à 50 % pour les premiers crus et jusqu’à 100 % pour les grands crus, les autres âges de barriques vont s’étalonner de un à trois vins (c’est-à-dire un à trois ans). Les vins ne sont jamais bâtonnés suite à la présence de dix centimètres de lies au fond du fût, une pratique traditionnelle pour la maison, mais plutôt inhabituelle pour la Bourgogne. Seuls les vins de Côte d’Or de qualité « village » et au-dessus sont vinifiés et élevés sous bois, les appellations régionales (mâcon blanc, bourgogne blanc) sont intégralement vinifiées en cuve inox, pour préserver le fruité destiné à une consommation plus immédiate. Après 10 à 12 mois d’élevage, une durée validée à la dégustation, les vins sont assemblés et remis en masse. La gestion des lies permet de travailler en réduction et donc d’abaisser les doses de sulfites depuis quelques années, mais on ne saurait s’en passer. De même, la teneur en CO2 à la mise est ajustée en fonction des millésimes, elle est relativement élevée dans les millésimes chauds afin de mieux protéger le vin.
Vers plus de puissance et de couleur
Cueillis à la main, les pinots noirs passent sur la table de tri avant un éraflage systématique. « On a bien fait un essai de vendange entière l’an dernier, sur les 2015 », concède Jean-Pierre Thomas, « mais je n’y ai pas vu un intérêt évident. Nous avons toujours eu ce style en vendange éraflée sur nos rouges, nous nous y tenons. Nous ne réintégrons pas de rafle. » Les cuvaisons durent de deux à trois semaines selon les millésimes, peut-être le changement le plus significatif par rapport au style en vigueur jusqu’au début des années 90, lorsque les cuvaisons ne dépassaient pas dix à douze jours. Les pigeages se sont réduits, remplacés par des remontages. Une évolution que reconnaît à juste titre Louis-Fabrice Latour : « Il y a 25 ans, on était plutôt critiqués pour nos rouges assez légers, y compris nos cortons. Aujourd’hui, c’est vrai que l’on a beaucoup gagné en puissance et en couleur, au contraire de certains vignerons qui ont été vers des vins plus clairs. On extrait un peu plus, on cuve un peu plus longtemps. C’est curieux cette évolution, légèrement à l’encontre d’un certain courant de vinification. » À l’issue du décuvage, les jus de presse et de goutte sont systématiquement assemblés, l’entonnage survient dans la foulée. Les malos se déroulent en fût, les vins sont alors sulfités pour un élevage qui va durer de huit à douze mois à l’issue duquel ils seront soutirés puis assemblés. La part de fût neuf varie de 100 % pour les grands crus à 50 % pour certains premiers crus et appellations village, jusqu’à 30 % pour les entrées de gamme, le reste étant complété de pièces de un à trois ans, comme pour les blancs. Si le pourcentage de bois neuf a toujours été le même, on note cependant depuis quelques années un rajeunissement de l’âge moyen des fûts.
Des barriques maison
Tonneliers avant d’être marchands de vin, les Latour ont perpétué la tradition en ne cessant jamais de produire leurs propres fûts. D’abord située en plein cœur de la ville, rue des Tonneliers, l’activité a par la suite migré place Madeleine, toujours dans Beaune, avant de suivre à la fin des années 1970 l’installation des nouveaux chais de vinification dans la zone industrielle de Savigny, au clos Chameroy, où elle se situe désormais. Les merrains sont séchés trois années avant d’être assemblés, tous les brûlages sont légers, à une chauffe moyenne. Les pièces, bourguignonnes évidemment, sont identiques, quelle que soit leur destination, vin blanc ou vin rouge. Depuis la fin des années 1980, la maison en commercialise une partie à l’export, jamais en France, vers les destinations les plus variées (Napa Valley, Australie, Afrique du Sud, Espagne, etc.) et toujours un modèle unique, la pièce Louis Latour. La production annuelle, qui s’échelonne entre 3 000 et 3 500 unités, couvre tous les besoins de la maison. Si l’activité est gourmande en trésorerie (il faut bien financer le temps de séchage du bois), elle permet d’intégrer en amont un élément clef dans la qualité finale du vin, l’élevage et notamment ses composants aromatiques.
assemblage à la bordelaise
S’il est un vin qui symbolise le savoir-faire de la maison, c’est bien le corton. Dans sa version chardonnay ou pinot noir, qu’il soit étiqueté corton-charlemagne (blanc) ou corton (rouge), il s’agit d’un grand cru. Et au sommet de cette hiérarchie, en rouge, trône le château-corton-grancey. À la fois marque commerciale et site de vinification, vin et lieu de réception, l’histoire de ce nom est singulière. Nous sommes là dans le village d’Aloxe qui, comme tant d’autres en Bourgogne au XIXe siècle, s’est adjoint le nom du climat le plus célèbre du finage, Corton, pour devenir Aloxe-Corton. L’histoire débute en 1749 lorsque le château est bâti à l’initiative du président du Parlement de Bourgogne, Gabriel Lebault. La cuverie fut ajoutée en 1830, de l’autre côté de la route, logée au cœur du coteau, dans la profondeur d’une carrière du climat Les Perrières. Elle sera achevée en 1834 par M. de Grancey, qui va par la suite rebaptiser la propriété de son nom. C’est en 1891 que la maison Louis Latour acquiert l’ensemble, ainsi que les 33 hectares de vignes de la famille Grancey, dont 15 hectares sur la fameuse colline de Corton. Aujourd’hui encore, les lieux ont conservé leur cachet d’origine. La cuverie a certes été modernisée dans certains aspects techniques (thermorégulation des cuves, etc.), mais toujours dans la même configuration. C’est là que sont vinifiés tous les vins rouges issus du domaine côte-d’orien (les blancs le sont sur le site de Savigny). Le château vient d’être rénové. Longtemps résidence d’été de la famille Latour, qui pouvait depuis ses fenêtres observer le bon avancement de la maturité, il a finalement été reconverti en espace de réception, avec une vue imprenable sur l’est de la colline.
Vin emblématique dans la gamme Louis Latour, le château-corton-grancey se distingue de ses pairs pour au moins deux raisons. La première, c’est qu’il s’agit d’un corton d’assemblage dans une Bourgogne où le parti-pris du parcellaire ne fait plus débat depuis des générations. Si les climats sont nombreux sur la colline (Renardes, Perrières, Clos du Roi, etc.), Grancey n’en fait pas partie. C’est donc bien un assemblage des meilleurs secteurs du domaine, à la bordelaise. Il est vrai que le patrimoine de vignes est tel qu’il permet aisément de séparer une part importante des meilleurs lots pour la réalisation de ce grand vin. Seconde particularité, qui découle de la première, c’est que Château Corton Grancey est une marque, et non pas un nom de terroir, dont la maison Louis Latour n’a que l’usage, en exclusivité, sans toutefois en être propriétaire. Cette singularité est due au système des appellations d’origine contrôlée : corton étant une AOC, on ne peut déposer une marque reprenant tout ou partie de ce patronyme. Toutefois, la maison Louis Latour ayant pu prouver que l’usage commercial de ce nom était bien antérieur à la création desdites appellations, elle en a conservé le privilège.
Retrouvez l’intégralité de l’article dans EN MAGNUM #06 (Déc-Jan-Fév) pages 64 à 71.
Photos : Mathieu Garçon
Les 28 ambassadeurs de Chablis
Vingt-huit vins issus du millésime 2015 ont été récompensé lors de la trente et unième édition du concours des vins de Chablis, compétition dont la particularité est de ne pas admettre de professionnels de ce vignoble parmi les dégustateurs.
Présidé cette année par le sommelier et blogueur Emmanuel Delmas (photo), le jury de cette session 2017 comptait 80 membres, professionnels (journalistes, restaurateurs, sommeliers, courtiers, œnologues) et amateurs éclairés, qui ont jugé en deux temps ces petits chablis, chablis, chablis 1er cru et chablis grand cru, seul le “super jury” étant habilité à décerner les médailles d’or, d’argent et de bronze.
Au total, 334 échantillons issus de 85 caves, maisons ou domaines chablisiens ont été passés en revue cette année. « Utilisés par l’antenne Chablis du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB) lors de ses opérations en France et à l’étranger », les vins médaillés, qui sont à découvrir ici, seront les ambassadeurs du vignoble durant toute cette année.