Entre le 28 juin et le 8 juillet, l’Unesco rendra son verdict quant à l’inscription des « Coteaux, maisons et caves de Champagne » et des « Climats de Bourgogne » au patrimoine de l’humanité. Si les premiers sont bien partis, les seconds le semblent un peu moins. Qui va rejoindre les vignobles déjà distingués par la prestigieuse organisation ?
« Il n’y a pas de grands vignobles prédestinés, il n’y a que des entêtements de civilisations », écrivait le journaliste Pierre Veilletet. En Champagne, on tire le meilleur de la vigne à la limite septentrionale de sa survie et on le sublime en un symbole universel depuis plus de 300 ans. En Bourgogne, on dessine depuis plus d’un millénaire une mosaïque pointilliste unique au monde. De cet entêtement naissent des savoir-faire, des paysages, des vins incomparables, irremplaçables. Pour être inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, les « Coteaux, maisons et caves de Champagne » et les « Climats de Bourgogne » devront justifier de leur valeur universelle exceptionnelle, c’est-à-dire d’une importance culturelle telle qu’elle dépasse les frontières, traverse les générations et mérite d’être reconnue à l’échelle mondiale. Si évident que cela paraisse, cela n’en a pas moins nécessité 800 pages de démonstration et 17 000 pages d’annexes pour la Bourgogne, 800 pages et 4 000 pages d’annexes pour la Champagne, et près de neuf ans de mobilisation. Dans le vignoble, dans le cuvier, au chai, tout est affaire de patience. Mais l’épilogue est proche. L’avant-dernière étape a été franchie le 15 mai avec le rendu d’avis de l’Icomos (Conseil international des monuments et des sites), l’organe consultatif de l’Unesco, sur les deux candidatures, basé sur le rapport d’enquête in situ de leurs experts et l’étude des dossiers.
Seulement six vignobles inscrits à ce jour
L’inscription des « Coteaux, maisons et caves de Champagne » est recommandée et la valeur universelle exceptionnelle des « Climats de Bourgogne » a été reconnue, tout en étant assortie d’une demande de renvoi sur deux points. L’avis favorable de l’Icomos est généralement suivi du classement. Très bientôt, les vingt et un membres du Comité du patrimoine mondial seront réunis à Bonn, en Allemagne, pour leur 39e session. Sur la base des indications de l’Icomos, ils décideront donc si ces deux entités viticoles méritent de figurer sur la Liste aux côtés du Taj Mahal, du mont Saint-Michel ou de l’Acropole d’Athènes. Parmi les biens inscrits à ce jour, six seulement correspondent à des vignobles : le paysage culturel historique de la région viticole de Tokaj en Hongrie, la région du Haut-Douro et le paysage viticole de l’île de Pico aux Açores au Portugal, le vignoble en terrasses de Lavaux en Suisse, les vignobles italiens Langhe-Roero et de Monferrato, dans le Piémont, et la juridiction de Saint-Emilion, seul bien français, inscrit dès 1999. D’autres régions aux vignobles fameux sont inscrites, par exemple le Val de Loire en France, les Cinque Terre en Italie ou Wachau en Autriche, mais elles ne le sont pas uniquement à ce titre.
L’œuvre conjugée de l’homme et de la nature
Les Coteaux, maisons et caves de Champagne concourent au titre de « paysage culturel évolutif vivant », les Climats de Bourgogne au titre de « site culturel ». Les deux sont bien sûr l’œuvre conjuguée de l’homme et de la nature. L’inscription de la Champagne porte sur trois critères de sélection (voir encadré) : « apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante », « offrir un exemple éminent d’un type de construction ou d’ensemble architectural ou technologique ou de paysages illustrant une ou des période(s) significative(s) de l’histoire humaine », « être directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions vivantes, des idées, des croyances ou des œuvres artistiques et littéraires ayant une signification universelle exceptionnelle ». La Bourgogne concourt également sur le premier de ces trois critères ainsi que sur celui-ci : « exemple éminent d’établissement humain traditionnel, de l’utilisation traditionnelle du territoire qui soit représentatif d’une culture ou de l’interaction humaine avec l’environnement ».
« Le champagne, pour moi, c’est la folie et la ténacité réunies, un peu comme Venise »
Trois sites témoignent sur 1 100 hectares de l’œuvre des vignerons et des négociants champenois : les coteaux historiques, face à la vallée de la Marne, les plus anciens et emblématiques du vignoble champenois, entre Hautvillers (où Dom Pérignon expérimenta l’assemblage des cépages) et Mareuil-sur-Aÿ ; la colline Saint-Nicaise à Reims avec les bâtiments élevés par les maisons de champagne et les cathédrales souterraines que sont les crayères (Claude Ruinart, au XVIIIe siècle, fut le premier à y installer sa Maison et à exploiter les crayères abandonnées pour conserver le vin) ; et enfin, l’avenue de Champagne, à Epernay, qui aligne les maisons de négociants (Jean-Rémy Moët fut pionnier), les sites de production et des kilomètres de réseaux de caves. « Le champagne, pour moi, c’est la folie et la ténacité réunies, un peu comme Venise », s’enflamme Pierre Cheval, le président de l’association Paysages du champagne qui porte cette candidature. Un paradoxe, des conditions contraires que l’on domine, un acharnement sublimé en grâce.
« En Bourgogne, quand on parle d’un climat, on ne lève pas les yeux au ciel, on les baisse sur la terre », selon la formule de Bernard Pivot, président du comité de soutien. Ces terroirs viticoles sont au nombre de 1247. Parmi les plus illustres : Chambertin, Romanée Conti, Clos de Vougeot, Montrachet, Corton, Musigny… Climat (terrain) et climat (conditions météorologiques) ont la même origine : le klima grec qui désigne l’inclinaison d’un lieu sur la terre. C’est aussi une unité romaine utilisée pour mesurer la surface des terrains à cultiver. En Bourgogne, on a conservé ce terme de climat pour désigner, au moins depuis le XVIe siècle, une parcelle de vignes très précisément délimitée et nommée, associée au vin qu’elle produit. Mais les climats, c’est la transmission, depuis près de deux millénaires, de pratiques de vinification élaborées et affinées par des générations de vignerons. C’est aussi mille ans d’histoire liés à la fondation des abbayes de Cluny et de Cîteaux et au pouvoir politique des ducs de Bourgogne. Mille ans pendant lesquels s’est établi la hiérarchisation des lieux et des vins fixée et protégée par l’AOC créée en 1936 (cent appellations régionales, village, premier cru, grand cru).
Une ode au monocépage, pinot noir ou chardonnay
Le terme climat pourrait être la traduction bourguignonne du mot terroir s’il n’était pas aussi spécifique à la région. « Il n’y a de climats qu’en Bourgogne », martèle-ton de la Côte de Nuits à la Côte de Beaune. Sur les 60 kilomètres du mince ruban (un kilomètre de large) de vignes qui court de Dijon à Santenay, les climats forment une mosaïque de crus uniques, une infinité de nuances de sols, d’expositions, de microclimats. Les noms disent tout. Les Cras à Marsannay-la-Côte ou les Crâs à Vougeot évoquent les coteaux pierreux. Les Cailles à Nuits-Saint-Georges, les Caillerets à Meursault, les sols caillouteux. Les Roichottes à Savigny-lès-Beaune, les Ruchottes du Bas, les Ruchottes du Dessus à Gevrey-Chambertin font référence aux petits éboulis à fleur de terre. Les Argillières à Chambolle-Musigny traduisent l’argile. Les climats, c’est une ode au monocépage, pinot noir ou chardonnay cultivés dans des mouchoirs de poche entourés de murets, parsemés de cabottes (abris des vignes) et ponctués de meurgers (tas de pierres). C’est la marque du travail de l’homme sur le sol et le paysage, de la modeste maison de village au palais des Ducs à Dijon et aux Hospices de Beaune, taillés dans la même pierre calcaire. Ce « décor » n’en est pas un, c’est une philosophie.
Pour Aubert de Vilaine, copropriétaire de la Romanée-Conti et président de l’association qui défend le dossier devant l’Unesco, les climats sont le modèle de la viticulture de terroir, son berceau et son archétype que l’urbanisation et la banalisation des pratiques et des goûts pourraient rendre vulnérable, alors que face à l’uniformisation du monde, la protection de la diversité est un enjeu pour l’humanité.
Béatrice Brasseur
Le patrimoine mondial
L’Unesco a été créé en 1945 et la notion de patrimoine mondial établie en 1978. Cette appellation est attribuée à des lieux ou des biens possédant une valeur universelle exceptionnelle, c’est-à-dire dignes d’intéresser l’humanité toute entière et sans équivalent dans le monde. La liste actuelle des sites universels et exceptionnels comporte 1 007 biens dans le monde, dont 39 en France, et 38 propositions d’inscription seront examinées à Bonn début juillet.
Pour figurer sur la liste, les biens proposés ont dû satisfaire à au moins un des dix critères de sélection définis par l’Unesco. Les 21 membres du Comité du patrimoine mondial de l’humanité décideront par vote l’inscription, le renvoi pour complément d’information (le dossier peut être représenté dans un délai de trois ans maximum), le différemment (le dossier repart pour un cycle de préparation et d’examen complet) ou la non inscription. Le comité suit en général les recommandations des experts Icomos (patrimoine culturel) et UINC (patrimoine naturel). Ces derniers se sont déplacés en Champagne et en Bourgogne fin 2014.
L’inscription au patrimoine mondial distingue mais n’entraîne pas de contraintes supplémentaires par rapport à la législation du pays, ni aux cahiers des charges des appellations. Pas question pour les élus cependant de se reposer sur leurs lauriers. Le dossier de candidature doit comporter un plan d’actions de sensibilisation des publics, de sauvegarde, protection et mise en valeur des patrimoines naturels et bâtis. Un bien peut toujours être déclassé. B.B.


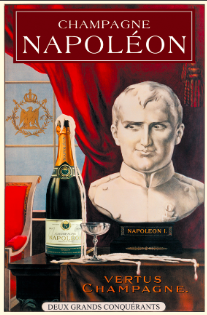

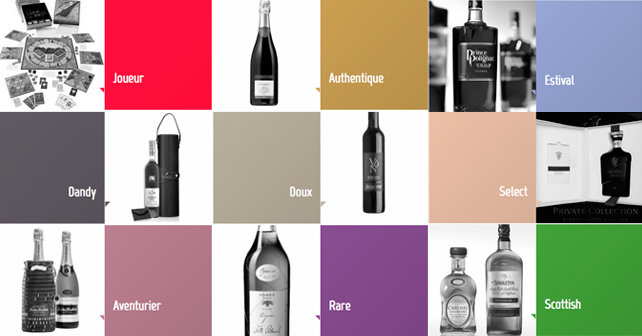

 « Le prosecco est un phénomène », constate avec tristesse Giancarlo Vettorello. Cet italien pure souche me quitte en cette matinée de mai avec ce cri du cœur. Il espère que je vais les aider, comme tous les journalistes qui grouillent dans la région, à changer l’image de ce monstre qui a trop grossi ces dernières années. Il en est malade, le monstre. Il crache des bulles, envahit les gondoles allemandes, australiennes, brésiliennes, américaines, des faux, des vrais, des secco, des progecco, des piusecco, des trisecco… Le nord de l’Italie s’est mis à genoux pour servir ce marché lucratif : plantation de vignes à gogo, ventes de propriétés aux Américains pour un sourcing (approvisionnement) assuré. En cinq ans, ce mousseux italien a doublé de volume pour atteindre 306 millions de bouteilles vendues, plus qu’en Champagne.
« Le prosecco est un phénomène », constate avec tristesse Giancarlo Vettorello. Cet italien pure souche me quitte en cette matinée de mai avec ce cri du cœur. Il espère que je vais les aider, comme tous les journalistes qui grouillent dans la région, à changer l’image de ce monstre qui a trop grossi ces dernières années. Il en est malade, le monstre. Il crache des bulles, envahit les gondoles allemandes, australiennes, brésiliennes, américaines, des faux, des vrais, des secco, des progecco, des piusecco, des trisecco… Le nord de l’Italie s’est mis à genoux pour servir ce marché lucratif : plantation de vignes à gogo, ventes de propriétés aux Américains pour un sourcing (approvisionnement) assuré. En cinq ans, ce mousseux italien a doublé de volume pour atteindre 306 millions de bouteilles vendues, plus qu’en Champagne.

 Parmi les deux options fondant cette certification basée sur des indicateurs de performance (on en apprendra plus dans cette vidéo-
Parmi les deux options fondant cette certification basée sur des indicateurs de performance (on en apprendra plus dans cette vidéo-



