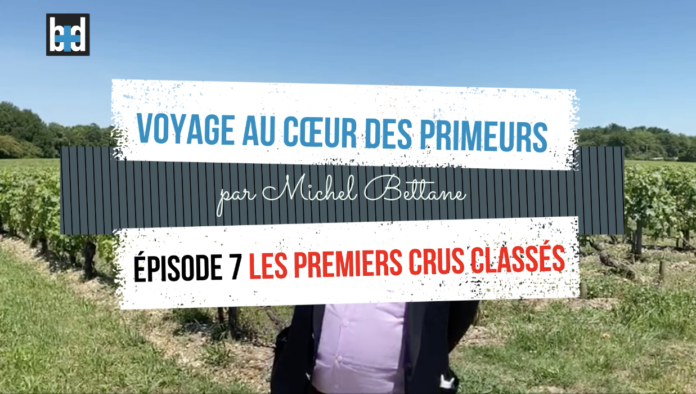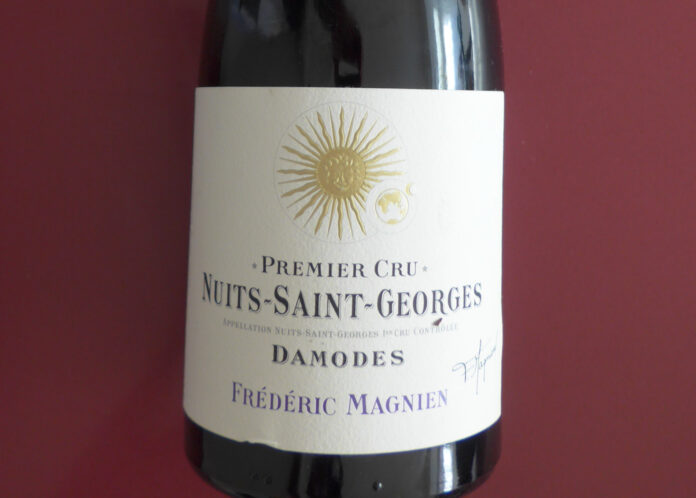Douze grandes familles du vin lancent un concours doté de 100 000 euros pour supporter une entreprise familiale
Primum Familiae Vini, association de douze familles européennes du vin, annonce ce matin le lancement du Prix PFV intitulé Family is Sustainability. Doté chaque année d’un montant de 100 000 euros, ce prix récompensera une entreprise familiale ayant démontré son excellence en matière de durabilité, d’innovation, d’artisanat et ayant réussi à transmettre d’une génération à l’autre. Le lauréat gagnera aussi la chance d’échanger avec les douze familles membres de PFV, toutes grandes spécialistes du family office et des spécificités liées à ce type d’organisation capitalistique. Pour Marc Perrin (château de Beaucastel), président de PFV, « Les entreprises familiales sont le fondement des économies régionales et nationales. Elles sont profondément attachées au développement durable et à l’environnement. Elles sont le visage humain de la libre entreprise à une époque où la mondialisation et une uniformité plutôt déprimante sont de plus en plus répandues. »
Surprise, cette initiative n’est pas réservée au seul monde du vin, ce prix est ouvert à toutes les entreprises familiales, tous secteurs confondus. Pour être complet, Marc Perrin précise « En annonçant ce Prix à un moment de crise internationale liée au Covid-19, nous soulignons la vision à long terme des entreprises familiales et notre optimisme inhérent à l’avenir à condition de défendre les bonnes valeurs. » Ce qui, bien sûr, n’est pas l’apanage de la viticulture, aussi vertueuse soit-elle.
Dépôt des candidatures entre le 1er juillet et le 30 octobre 2020. Annonce de la short-list (cinq candidats) en janvier 2021 et consécration du lauréat en mars 2021.
Le jury de sélection est composé d’un membre de chacune des douze familles qui composent Primum Familiae Vini, l’association créée en 1992 par les familles Torres et Drouhin. Qui sont-ils ? Douze parmi les plus fameux producteurs de grands vins d’Europe :
Priscilla Incisa Della Rochetta, Tenuta San Guido, ltalie, 1840
Albiera Antinori, Marchesi Antinori, ltalie, 1385
Egon Müller, Egon Müller Scharzhof, Allemagne, 1797
Prince Robert de Luxembourg, Domaine Clarence Dillon, France, 1935
Marc Perrin, Famille Perrin, France, 1909
Paul Symington, Symington Family Estates, Portugal, 1882
Frédéric Drouhin, Maison Joseph Drouhin, France, 1880
Miguel Torres Maczassek, Familia Torres, Espagne, 1870
Jean-Frédéric Hugel, Famille Hugel, France, 1639
Pablo Alvarez, Vega Sicilia, Espagne, 1864
Philippe Sereys de Rothschild, Baron Philippe de Rothschild, France, 1853
Hubert de Billy – Champagne Pol Roger, France, 1849
Il convient de s’inscrire sur le site www.thepfvprize.com