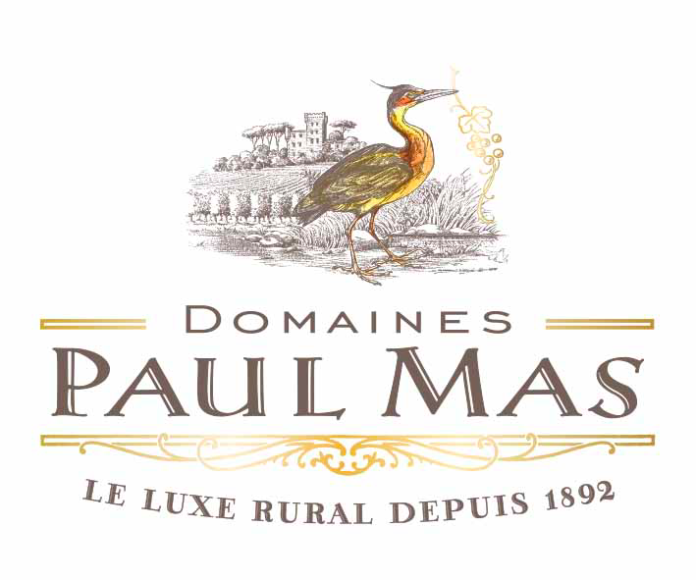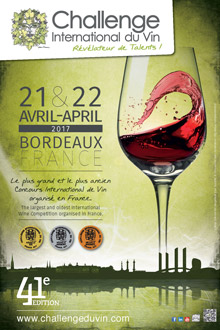Ce cépage est-il le roi du monde ? Sans doute, ou pas très loin. Cultivé partout où l’intention est de faire le mieux, voilà son histoire.
On connait la fameuse boutade de Tschelitschef : « Dieu a créé le cabernet-sauvignon et le diable, le pinot noir. » Il voulait sans doute dire par là que le premier est une vigne rationnelle, dont on peut saisir le comportement, le caractère gustatif et imaginer comment en vinifier le raisin, le second est un concentré de mystère, de caprice, d’imprévu et doit ses plus grandes expressions plus souvent à d’heureux hasards qu’aux connaissances ou au savoir-faire du vigneron ou de l’œnologue. Pour autant, ce cépage bienveillant n’a acquis que très récemment une position en apparence dominante grâce à la mondialisation de la viticulture. En France, avec seulement 53 000 hectares plantés (un peu plus que 6 % de la superficie totale de notre vignoble), le cépage est largement dépassé par le merlot (115 000 ha) et même par le grenache et la syrah. Dans le monde, on retrouve ces mêmes 6 à 6,5 % (près de 300 000 ha), mais plus inégalement répartis, avec des pôles majoritaires au Chili ou en Chine et plutôt des îlots minoritaires en Europe et même en Australie ou en Californie. C’est que le cépage mûrit plutôt tardivement, trois à quatre semaines après les cépages blancs les plus précoces, et donc difficilement quand il est en limite septentrionale de culture, en hémisphère nord, ou l’inverse en hémisphère sud. Et les gènes qu’il doit au sauvignon accentuent en cas de faible maturité les arômes végétaux de poivron vert déjà propres à son père, le cabernet franc, donnée par des molécules nommées pyrazines et qui sont devenue la bête noire des techniciens et des amateurs qui prétendent s’y connaître. Cultivé en zone trop chaude, le raisin devient trop riche en sucre et en degré alcoolique potentiel et perd toute distinction de saveur avec l’apparition de notes camphrées ou rappelant la menthe verte, souvent signes de manque d’alimentation en eau de la vigne. Par ailleurs, si les peaux du raisin sont épaisses, ce qui le protège du pourrissement des baies en fin de parcours, la vigne, elle, est fragile du côté de ses bois. De graves maladies comme l’eutypiose ou l’esca, qui conduisent à la mort foudroyante des pieds, déciment les vignobles, interdisent aux plants de devenir âgés et causent d’énormes tracas aux viticulteurs.
Alors, si ce plant en apparence solide dans la composition de son raisin pose autant de difficultés, à quoi doit-il son succès et sa cote d’amour dans le public international ? Tout d’abord au fait qu’il est plus stable sur le plan génétique que les pinots, avec de nombreux clones assez proches en qualité et en caractère mémorisable les uns des autres, si on sait greffer, tailler et palisser la vigne correctement. Son histoire et ses précédents sont prestigieux et les grands vins du Médoc, à dominante de ce cépage, ont marqué à jamais la mémoire des amateurs et leur sensibilité gustative, aussi bien en matière de saveur que de sensations tactiles. Les notes de cèdre, d’épices douces, de tabac, de poivron mûr (et même de tomate mûre dans les zones chaudes) sont entrées dans l’inconscient collectif, tout comme la solidité et la complexité du tannin au vieillissement, qui allonge la saveur, et la fraîcheur des fins de bouche, à l’opposé des caractères confiturés ou cuits de variétés plus adaptées aux climats chauds. Enfin, il transmet assez fidèlement les nuances de terroir et les types de sol, avec une préférence pour les graves ferrugineuses ou les laves volcaniques, tout en s’associant parfaitement avec le merlot, plus facile à vivre, ou les verdots plus capricieux mais parfois très complémentaires par leur chair et leurs épices. Le réchauffement global lui est plutôt favorable dans les zones où il s’exprime déjà avec le plus d’éloquence et qui sont comme toujours situées dans l’hémisphère nord, autour du 45e parallèle. Sur les graves du cœur du Médoc, il fallait souvent lui ajouter 30 à 50 % de merlot pour arrondir les angles dans les millésimes difficiles. Aujourd’hui, les plus beaux crus sont largement au-dessus de 80 % de cabernet-sauvignon presque tous les ans, pour le plus grand plaisir des amateurs.
Quel est le vrai problème avec cette minorité de snobinards ronchons qui l’accusent de tous les péchés de la mondialisation ? D’abord, leur bordeaux-bashing militant et leur ignorance. Ce cépage et ses ancêtres ne sont pas nés à Bordeaux. On s’accorde généralement à penser que le cabernet franc vient du Béarn, le fer servadou, qui par métissage donnera les carmenères, d’Espagne, via les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, les côts (dont le malbec) du Quercy, la madeleine noire, mère du merlot, des Charentes, et le sauvignon probablement de Loire, mais avec des cousins dans le bassin est du pays et peut être des relations avec le savagnin et le furmint. Les cépages ont toujours circulé et fini par trouver des secteurs où ils s’épanouissent avec plus de potentiel, ce fut le cas évidemment en Médoc. Mais aussi, dès les XVIIIe et XIXe siècles, en Piémont ou en Toscane, puis évidemment sur la côte ouest américaine, en Australie, en Afrique du Sud, en Chine, etc. Aucun n’appartient à aucune source, il faut simplement planter celui ou ceux qui porteront un sol et un microclimat au maximum de leur personnalité, mais aussi du plaisir que le vin peut donner. N’oublions pas que le consommateur est roi et qu’un vin pour être apprécié doit d’abord être vendu. Et pour la diversité, qu’on ne s’inquiète pas encore. La France est assez pauvre avec seulement 120 cépages en exercice, mais l’Italie veille avec ses 328 variétés, autochtones ou non.
Retrouvez l’intégralité de l’article dans EN MAGNUM #05 (septembre 2016).