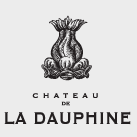Weingut Hiedler, à Langelois, DAC Kamptal
Ludwig Hiedler, 23 ans, poursuit le projet familial aux côtés de son père et de sa mère. C’est elle, d’origine catalane, qui a créé l’identité du domaine, fondé par le grand-père en 1856, et lancé les vins à l’export. Une cave en béton a été ajoutée en 2002 au bâtiment existant et déjà élargi. Les Hiedler possèdent des vignobles autour de Langelois, dont un demi-hectare sur le Heiligenstein. Ici, les vins font leur fermentation malolactique, car le père « ne supportait plus l’acidité ». Les vins sont vinifiés et élevés en cuve inox.
Grüner Veltliner Kamptal DAC Löss 2013
Grande fraîcheur, légèreté et juteux, vin excellent dans sa simplicité citronnée.7,50 €
Grüner Veltliner Kamptal DAC Thal 1er Cru 2012
Rondeur, fraîcheur, gourmandise et belle amertume finale. 12 €
Grüner Veltliner Kamptal DAC Kittmannsberg 1er Cru 2012
Une belle acidité malgré la malolactique et l’année. Du fruit plein la bouche. 12 €
Riesling Kamptal DAC Steinhaus 1er Cru 2012
Cette parcelle de 2,5 hectares de gneiss et de quartz donne le riesling le plus citrique des trois, d’une grande droiture. 16 €
Riesling Kamptal DAC Gaisberg 2012
Cette fois il s’agit de gneiss et de loess, plus bas sur la parcelle. Le vin est séduisant et gourmand. 16 €
Riesling Kamptal DAC Heilingenstein 2012
le sol est complexe, avec du granite, du gneiss, des conglomérats, du quartz. Une puissante minéralité pour ce vin éffilé, long, élégant, à la finale très expressive. Pas très cher en plus… 20 €
Weszeli, à Langelois, DAC Kamptal
Il est né dans le Burgenland, « la où on fait les meilleurs rouges autrichiens », habite dans la Thermenregion aux abords de Vienne, région viticole haute en couleur, mais Davis Weszeli a choisi Kamptal pour lancer sa production de vins après avoir vendu sa boîte de communication en 2006. Pourquoi Kamptal ? Pour sa variété de terroirs incroyable, son climat idéal pour le grüner veltliner et le riesling. Associé au vigneron Rupert Summerer depuis 2011, il développe une gamme basée sur la diversité biologique du vignoble et de longs élevages en foudre ou cuve inox. Les Reserve sont élevées sur lies pendant dix-huit mois et gardées deux ans en cave une fois embouteillées. Le domaine couvre 30 hectares aujourd’hui.
Grüner Veltliner Kamptal DAC Langelois 2013
Issu de soixante parcelles autour de Langelois, cet assemblage offre les accents typiques des grüner veltliner de Kamptal, intensité, poivré, fraîcheur, croquant et belle tenue en bouche. Bouché Vinolock (bouchon en verre). 8,80 €
Grüner Veltliner Kamptal DAC Steinhaus 2013
Les dépôts calcaires sur gneiss donne au grüner veltliner un côté minéral et complexe, une acidité tranchante sur une belle longueur. Bouché Vinolock (bouchon en verre).10,80 €
Grüner Veltliner Kamptal DAC Reserve Purus 2012
Issu du Kittmannsberg, au sud-ouest de Langelois, un vin élégant, longiligne et droit. Belle finesse. 19 €
Riesling Kremstal DAC Gebling 2013
Vin minéral à la belle acidité et au joli croquant. 11 €
Riesling Kremstal DAC Moosburgerin Reserve 2013
Joli vin au léger sucre résiduel. 19 €
Weingut Jurtschitsch, à Langelois, DAC Kamptal
Alwin, le fils Jurtschitsch (Weingut Jurtschitsch), 33 ans, m’emmènera voir de près le fameux terroir d’Heiligenstein, ses terrasses, et me montrer in situ l’effort général mené pour cultiver de façon la plus biologique possible l’environnement des vignes. Avec sa femme Stéfanie, Alwin a repris l’affaire familiale après quelques belles expériences très formatrices : Nouvelle-Zélande, Amérique du Sud, et un séjour dans des vignobles bio dans le Roussillon. Il a préféré réduire la surface du vignoble pour se concentrer sur 60 ha, ce qui est déjà beaucoup, dont 40 ha de grüner veltliner, 12 ha de riesling, le reste en zweigelt et pinot noir. Très belle gamme de vins au style épuré : pas de botrytis, pas de bois, pas d’enzyme ni levure, ni de bâtonnage. Des vins cristallins et droits, sans trop d’alcool.
Grüner Veltliner Kamptal DAC Dechant 1er Cru Alte Reben 2012
sol de loess profond sur des pentes orientées est, ce vin issu de vieilles vignes offre un nez séduisant, une bouche fruitée, acidulée, gourmande et croquante ainsi qu’une finale épicée. 17,30 €
Grüner Veltliner Senftenberger Piri 2013
Issu de roches primaires, il présente un beau nez aromatique, une attaque ample, une belle longueur minérale et salée. Un très beau vin structuré.
Grüner Veltliner Kamptal DAC Lamm 1er Cru Reserve 2012
Alwin avoue que c’est un challenge d’obtenir de la minéralité à partir de loess. Ce vin vinifié en foudre de 10 hl est fin et élégant, avec des notes de pêche et d’épices. 29 €
Riesling Hochäcker 1er Cru 2012
On change de registre avec les riesling. Ramassés mi-novembre, les raisins mûrs sont perceptibles dans ce vin riche et intense, presque un peu chaud en finale. 23,80 €
Riesling Rehberger Goldberg 2012
Bouche riche, longue, pleine de fruit (coing, pêche) et de minéralité, vraiment superbe. Le côté anguleux et linéaire est très séduisant. Quant au prix 15 €
Riesling Kamptal DAC Reserve Quelle 2012
C’est un peu la cerise sur le plateau : Quelle veut dire source. Issu d’une centaine de plants récoltés autour d’un puits, ce riesling offre une robe doré foncé, une bouche pleine et gourmande, sans fin. Il remplit la bouche. Filtration et souffre minimum. 33 €
Willi Bründlmayer, à Langelois, DAC Kamptal
Le charismatique Willi Bründlmayer a construit une cuverie pratique et de grande capacité pour passer à 500 000 bouteilles annuelles dont désormais 100 000 de mousseux, brut, extra brut et brut rosé en méthode traditionnelle. Ce vigneron emblématique a contribué à tisser la réputation des vins autrichiens et sa réputation l’amène à être sollicité régulièrement pour faire du conseil hors Autriche, mais il préfère se concentrer sur la production maison. D’une touchante modestie, ce gentleman me fait visiter les nouveaux lieux et me montre des innovations dignes de Géo Trouvetout, comme cette machine à laver les cagettes pendant les vendanges. Ses riesling méritent d’être longuement attendus.
Les conditions de dégustation étaient particulières puisque Willi m’a présenté les vins dans son restaurant de Langelois, Heurigenhof Bründlmayer. Les mets (melon, filet de truite bio, biche, fromages de Bernard Antony, poire pochée…) étaient excellents mais les effluves aussi. C’était pour le coup l’occasion de découvrir ses vins à table.
Sekt Brut 2010 (9 gr)
issu de pinot blanc et gris, de chardonnay et 15 % de grüner veltliner, c’est un joli brut élégant et simple, bien fait.21,90 €
Sekt Brut 2010 (9 gr)
Etant donné que de plus en plus de pinot noir se retrouve dans le rosé, m’explique Willi, le brut rosé a de plus en plus de chardonnay, le reste est partagé entre un tiers de zweigelt, un tiers de saint-laurent, un tiers de pinot noir. Touche de couleur et de l’élégance, avec une petite pointe d’amertume. 21,90 €
Grüner Veltliner Kamptal DAC Kamptaler Terrassen 2013
les raisins proviennent de jeunes vignes de différentes terrasses (Lamm, Käferberg…). Vinifiés séparément, les parcelles sont assemblées pour donner un vin typique du coin, et du cépage, facile d’accès. Agréable et droit, un Groovy sans chichi. 10,90 €
Grüner Veltliner Kamptal DAC Käferberg 1er Cru Reserve 2012
Le terroir est très spécial, roches primaires (gneiss), mais aussi de l’argile et du calcaire. Vendangé tard, il est gras, mûr, expressif, puissant, sur la rondeur. 34,90 €
Grüner Veltliner Kamptal DAC Lamm 1er Cru Reserve 2012
Willi a voulu, dans les années 80, prouver que le grüner veltliner est un grand vin. Pour cela, estime-t-il, il faut des vins pleins et ronds. Ce Lamm est ample et s’impose à table, long et gras. 39,90 €
Riesling Kamptal DAC Kamptaler Terrassen 2013
jeunes vignes de Heiligenstein et Steinmassel, un vin plein et gourmand, facile d’accès. 11,70 €
Riesling Kamptal DAC Zöbinger Heiligenstein 1er Cru Lyra Reserve 2012
Issu de vignes en lyre plantées sur les terrasses du Heiligenstein, ce beau riesling offre des arômes d’ananas et de pêche. On note de l’exubérance, une intensité du fruit qui se prolonge sur une belle longeur bien équilibrée. A ouvrir en 2020, pas avant. 34,50 €
Riesling Kamptal DAC Zöbinger Heiligenstein 1er Cru Alte Reben Reserve 2012
Arômes de pêche, de menthe, de fumée discret. C’est à la fois riche et vif, avec cette longueur élégante et éffilée, salée et minérale. A déboucher dans une dizaine d’années. 39,90 €
Pinot noir Dechant 2011
Matière ronde et tannins souples, un joli pinot noir. 14,80 €
Schloss Gobelsburg, à Langelois, DAC Kamptal
Jusqu’en 1995, les moines cisterciens de Stift Zwettl dirigeaient ce magnifique domaine (leur présence remonte à 1171), l’un des plus vieux d’Europe. En 1996, Michael Moosbrugger en a repris les rênes avec sa femme Eva. Le vignoble s’étend sur une centaine d’hectares, planté de grüner veltliner pour la moitié, de riesling (25%), de zweigelt (8%), de blauburgunder (5%), saint-laurent (7 %) et merlot (5 %). Gobelsburg est l’une des valeurs sûres de Kamptal avec des vins somptueux, fort bien vinifiés et d’une grande capacité de garde.
Grüner Veltliner Kamptal DAC 2013
Attaque subtile, fraîcheur, notes de pommes et de poire et d’épices pour cet entrée de gamme déjà très bien fait. 10 €
Grüner Veltliner Kamptal DAC Steinsetz Reserve 2013
De cette parcelle est issu le vin de glace, c’est donc un lieu plutôt froid. Nez très épicé, très aromatique, belle structure longue et subtile. NC
Grüner Veltliner Kamptal DAC Renner 1er Cru 2012
Issu des pentes du Gaisberg, le vin reste 11 mois en foudres. Nez très aromatique, belle tenue et gras en finale.NC
Grüner Veltliner Minimal 2011
Parcelle située à côté du Renner, superbes fraîcheur et allonge. 32 €
Riesling Kamptal DAC Reserve Gaisberg 1er Cru 2012
Nez floral et délicat, équilibre cristallin en bouche, très grande classe.NC
Riesling Kamptal DAC Zöbinger Heiligenstein 1er Cru 2012
Nez délicat et minéral, de l’attaque à la finale, le vin est d’un équilibre magnifique, d’une délicatesse incroyable. Grand vin. 32 €
Loimer, à Langelois, DAC Kamptal
Etiquette épurée pour ce vigneron au caractère bien trempé. Il exploite 70 hectares répartis entre autres sur les crus Seeberg, Steinmassl, Spiegel, Dechant, Heilingenstein et Käferberg. Il cultive du grüner veltliner essentiellement, pour plus de la moitié, 25 % de riesling et le reste dans d’autres variétés dont le pinot noir. Voici deux exemples d’un domaine converti à la biodynamie dès 2006 (premier millésime certifié en 2011).
Grüner Veltliner Kamptal DAC Loiserberg Reserve 2013
Un grüner veltliner croquant à souhait, plein de finesse. Un très bel exemple de ce cépage aux arômes de poivre, d’herbe coupée, de foin, de fleurs blanches.
Riesling Kamptal DAC Seeberg 1er Cru Reserve 2012
Il faut retourner la bouteille pour voir le cépage riesling sur la contre-étiquette, sur l’étiquette seul « 2012 Langelois Seeberg 1er cru Kamptal Reserve » est indiqué. Le vin est svelte, sur l’élégance.