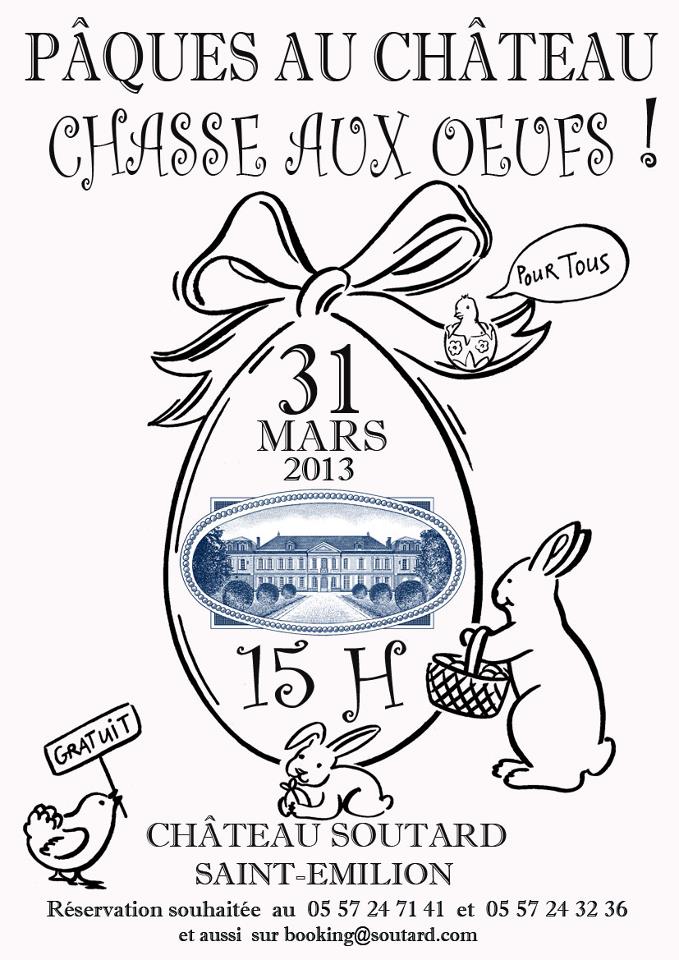Au cœur du plan Amplitude 2015 de l’interprofession des vins de Bourgogne (BIVB) se trouve l’ambition de devenir une référence mondiale en terme de développement durable et la certitude que bien du travail a déjà été accompli avant même que l’expression de développement durable ne s’impose dans le vocabulaire de chacun. Question d’histoire, de sensibilité et de fierté bourguignonne autour de la notion de sol et de terroirs… Préservation de l’environnement et du territoire, pérennité économique et qualité des vins ont été et sont toujours les fils rouges des actions menées. Sur le terrain, la mobilisation est forte et ces derniers mois, les initiatives se sont multipliées. Deux aires de lavage collectives des pulvérisateurs ont ainsi vu le jour à Chassagne-Montrachet et Vosne-Romanée.
Au total, seize installations de ces dispositifs permettant un traitement spécifique des eaux de lavage ont vu le jour en Bourgogne. Trois vignobles (Irancy, la colline de Corton et Pouilly-Fuissé) participent au projet LIFE BioDiVine, une initiative européenne comprenant sept sites de démonstration qui a pour but de mieux connaître et d’améliorer la biodiversité dans les vignobles et de faire progresser la qualité de l’environnement (limitation de l’érosion et du ruissellement, du transfert des produits phytosanitaires, etc.). Pour encourager toutes ces initiatives, le BIVB a mis
en place une commission. Dotée d’un budget de 200 000 euros, ses membres ont pour mission d’encourager et
de lancer des passerelles entre les différentes actions sur le terrain.
Ces différentes actions, parmi d’autres, seront à découvrir lors de cette onzième semaine du développement durable, en partenariat avec l’Association pour l’inscription des Climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco, la Coordination des recherches sur chardonnay et pinot noir en Bourgogne (CRECEP), AgroSup Dijon et la Chambre régionale d’agriculture de Bourgogne. Du 2 au 5 avril, de nombreuses conférences et ateliers techniques permettront aux professionnels de la filière des vins de Bourgogne de s’informer des dernières nouveautés sur des sujets aussi variés que la transmission du patrimoine viticole, la pulvérisation de précision, la gestion de l’énergie dans les chais, etc. et de se voir expliquer des réalisations concrètes et applicables au sein de leurs exploitations. Le BIVB et ses partenaires souhaitent démontrer que le développement durable,
loin d’être un concept, est un objectif réaliste et applicable au quotidien. Les ateliers, comme la lecture de paysage ou les visites sur le terrain auront lieu l’après-midi. Les conférences techniques se dérouleront en matinée à Beaune, Davayé (lancement de Vinipôle Sud Bourgogne) ou Chablis. La thématique de la transmission du patrimoine viticole sera abordée en soirée au Château de Gilly. Programme détaillé et inscription ici.