Benoît Gouez, chef de cave de Moët et Chandon, décrypte les travaux et les savoirs exercés pour créer des champagnes à la hauteur de l’immense aura de la « Grande Maison ». Une leçon de maître où le moindre détail compte
Cet article est paru dans En Magnum #30. Vous pouvez l’acheter sur notre site ici. Ou sur cafeyn.co.
Une année comme 2022, extrême dans sa météo, rebat quelques cartes pour la Champagne. C’est inquiétant ?
Je ne suis pas inquiet, mais la situation m’interroge. Je pense qu’il faut se préparer à une évolution stylistique fondamentale du champagne. Jusqu’à présent, c’est plutôt favorable. On a des outils œnologiques pour gérer ça. Moët est là depuis 1743, on en a vu d’autres. C’est vrai, il va falloir accepter que le profil de nos vins évolue. On ne peut pas s’entêter dans cette idée qu’ils restent avec les mêmes équilibres que ceux du passé.
Sur ce point, la maison est en avance.
Même si l’on a les capacités de s’adapter, ça n’empêche pas de se poser des questions. C’est important d’expérimenter. C’est dans la culture de Moët & Chandon. Par notre taille, par notre activité, nous pouvons voir la Champagne dans sa globalité. Chaque année, nous nous sommes habitués à faire des essais. On est avance sur des sujets techniques, comme le pilotage des fermentations, la gestion de l’oxygène, etc. Le vignoble n’est pas immobile, même s’il progresse peut-être moins vite d’un point de vue œnologique que d’un point de vue viticole.
L’année 2003 avait déjà été un millésime charnière.
C’est l’année où l’on a commencé à faire du sulfitage différé. L’idée était de se dire que si l’on a une charge oxydable dans nos vins, celle-ci va inexorablement s’oxyder, à un moment ou à un autre. Pour nous, plus tôt ce moment intervient, mieux c’est. Il vaut donc mieux que ces oxydations se passent sur jus. Le processus d’élaboration champenois oblige à baisser la garde, à un moment, dans la protection des vins. Ce n’est pas le cas pour les vins tranquilles. On peut avoir l’assurance qu’ils sont bien protégés jusqu’au consommateur.
À cause de la prise de mousse ?
Pour avoir lieu, la seconde fermentation nécessite d’avoir un vin qui ne soit pas protégé. Le risque, c’est que celui-ci s’oxyde pendant la prise de mousse. Notre processus permet de se débarrasser de ces éléments fragiles le plus tôt possible. C’est certes une perte sur le moment, mais cela permet d’avoir des vins nets. Bien sûr, c’est plus simple à faire avec des vendanges saines.
Cette variabilité du climat risque aussi de modifier le style du brut sans année. Comment limiter son impact ?
La réponse est dans les vins de réserve. Entre 40 % et 50 % de ces réserves entrent désormais dans l’assemblage de Moët Impérial. Cette gestion est notre priorité, au même titre que la vendange du millésime. En 2021, par exemple, j’ai décidé de ne pas faire de millésime parce que je n’avais pas le volume pour renouveler nos réserves. C’est ce qui nous permet d’avoir plus de constance.
C’est nouveau pour la maison ?
Cela s’inscrit finalement dans l’histoire de la Champagne. La région n’est pas assez résistante. De tout temps, il a fallu trouver des solutions d’adaptation, comme les vins de réserve ou l’assemblage. Il y a vingt-cinq ans, seuls 15 à 20 % de vins de réserve entrait dans l’assemblage de notre impérial. C’est un changement positif, qui nous permet de tamponner les épisodes. Mais ça nous oblige aussi à être encore plus rigoureux dans la sélection et la construction de ces réserves.
L’autre élément d’adaptation, c’est le dosage.
Quand j’ai été nommé chef de cave en 2005, la cuvée Impérial affichait un dosage entre 13 et 14 grammes par litre. Aujourd’hui, c’est 7 grammes, voire 5. Même constat pour Grand Vintage, passé d’un dosage autour des 11 grammes à 5 maximum. Un champagne n’est pas meilleur lorsqu’il est moins dosé. C’est juste une manière de s’adapter à des vins qui sont plus riches riche et moins acides. Les équilibres changent.
Tout commence à la vigne. Pour Moët & Chandon aussi ?
Le changement de viticulture est un défi que la Champagne a pris à bras le corps. Pour nous, cela passe dans la recherche de leviers pour motiver nos partenaires à être plus vigilants dans leurs pratiques, dans le choix des dates de vendanges, dans le tri des raisins. Ce nouvel état d’esprit est quelque chose de récent. Le système champenois repose sur l’achat de raisins au kilo. Ce n’est pas une relation contractualisée en fonction de la qualité. Notre démarche doit convaincre l’ensemble des partenaires. La Champagne n’a pas le monopole de la qualité. Sa réputation historique ne doit pas inviter à nous reposer sur nos lauriers. La recherche de cette qualité n’est pas compliquée à mettre en place. Ce sont les détails et leur accumulation qui font la différence.
Après le millésime 2013, vous lancez Grand Vintage 2015. Deux années aux profils très différents.
Avec ses vendanges d’octobre, 2013 est vraiment atypique. En 25 ans, c’est la seule fois où nous avons vendangé aussi tard. 2015 n’a rien à voir. Un hiver classique, des gelées appuyées en début de printemps et un été de chaleur et de sécheresse – le plus chaud après 1969 – qui conduit à un déficit hydrique de près de 30 %. Bref, une année extrême avec quelques pluies fin août, un peu comme en 2022, qui ont permis d’éviter les blocages de maturité.
Pourtant ce 2015 affiche une fraîcheur certaine. Quel est le secret ?
J’ai le sentiment qu’on s’en est bien sorti dans une année qui aurait pu donner un profil aromatique lourd et manquer de légèreté. Le nez est assez floral et fruité entre fruits blancs et jaunes, sans tomber dans le fruité trop coloré et marqué. Pourtant, c’est un profil construit autour des cépages noirs. Cette fraîcheur est d’autant plus inattendue dans ce type d’année un peu chaude. Les chardonnays sont assez réguliers en Champagne. C’est un cépage résistant. Pinot noir et meunier sont plus sensibles et donneront, à l’avenir, plus de variations qualitatives. Quand ils sont sains et équilibrés, on a naturellement envie de les mettre en valeur.
On a l’impression que l’acidité n’est plus la seule clé de voûte de l’équilibre.
Il y a un jeu sur les amers qui est assez récent à l’échelle de la Champagne. C’est un sujet d’avenir. Le seul instrument de mesure dont nous disposons, c’est la dégustation. Avec l’expérience, c’est un paramètre auquel je suis de plus en plus sensible. Les amers peuvent compenser des acidités en baisse. Mais il faut bien les extraire, ni trop, ni trop peu, les affiner pour qu’ils ne soient pas grossier et asséchants. La sélection de vins de base dans ce registre est le seul moyen de le retrouver dans nos champagnes. La fraîcheur sera un enjeu pour 2022. Mais elle n’est pas monofactorielle.
Ces questions de style sont les mêmes pour la construction du brut Impérial ?
Pour le non millésimé, l’enjeu est différent. Les vins sont plus faciles d’accès et pensés pour des rotations rapides. Il y a un côté plus libre sur le millésime. On recherche la complexité, la longévité et l’identité. Impérial est une figure imposée, c’est comme ça depuis 1869. Il faut le faire avec une identité définie à l’avance, pour répondre à une attente précise. Il n’y a pas de vignobles dédiés au millésime, ni de vinifications spécifiques. On a une vendange par cépage, par secteur, par villages, différente selon nos vignobles ou ceux de nos partenaires. L’idée est de faire le mieux possible partout.
On parle souvent du style Moët.
C’est un profil de champagne autour d’un fruit juste mûr et croquant, avec une forme de tendreté en bouche, où l’attaque contraste avec la finale. Je revendique ce confort d’attaque, ce charnu, tout en essayant de travailler la finale sur une forme de fraîcheur jamais agressive. Ce caractère est moins appuyé sur Imperial dans la mesure où c’est un champagne d’apéritif par excellence. Il doit être accessible. La cuvée Grand Vintage s’adresse à un public de consommateurs avertis, qui ont une certaine attente vis-à-vis de la catégorie.
Comment expliquer les progrès spectaculaires de la maison sur ce point ?
On recherche beaucoup plus l’individualité au sein même de notre vendange. On a aussi gagné en précision. Chaque lot est analysé, dégusté, fiché et identifié en fonction de son potentiel initial. Nos grands principes de pilotage des fermentations sont ajustés en fonction des équilibres sucre-acidité-azote. Ce qui nous permet de mieux adapter nos températures, nos apports en oxygène, etc. On enregistre beaucoup de données afin d’affiner, d’une année sur l’autre, notre manière d’approcher chaque cuve selon sa propre singularité.
Moët & Chandon, c’est les trois cépages. C’est aussi le socle de l’universalité de cette marque.
Oui, parce que Moët & Chandon, c’est la Champagne. Et la Champagne, c’est les trois cépages. Je revendique toujours cette universalité. Nous représentons, en raison de notre taille, ce vignoble dans son ensemble partout dans le monde. Si je pouvais avoir accès à l’ensemble des villages de la Champagne, j’en serais ravi. Le cœur du champagne, c’est l’assemblage. Pour le réussir, il faut de la diversité. Plus j’ai de diversité entre les mains, plus je suis confiant dans ma capacité à créer des choses solides, équilibrés et complètes.
Sans confondre universalité et simplicité, c’est la difficulté.
Il y a un degré d’exigence dans la maison qui nous permet de gagner en sophistication, en étant plus vigilant quant aux détails. Cette idée de précision dans les détails, c’est ce qui différencie l’artisan et l’industriel. Je n’ai pas de problème à la dire, malgré notre taille. On ne peut pas se cacher, nous sommes le leader en Champagne. Mais cette taille est une richesse si elle permet de générer de la diversité. Si on travaille avec une seule et même recette, on tombe dans la banalité. Un travail sur mesure permet d’accueillir cette diversité, de la créer avant de la réconcilier dans nos bouteilles. C’est cette vision que j’essaye d’apporter depuis le début.
Photo : Benoit Gouez est chef de cave de la maison depuis presque vingt ans. Dix années séparent cette photo de cet entretien. L’homme n’a pas changé. Son enthousiasme est intact. (crédit : Mathieu Garçon)

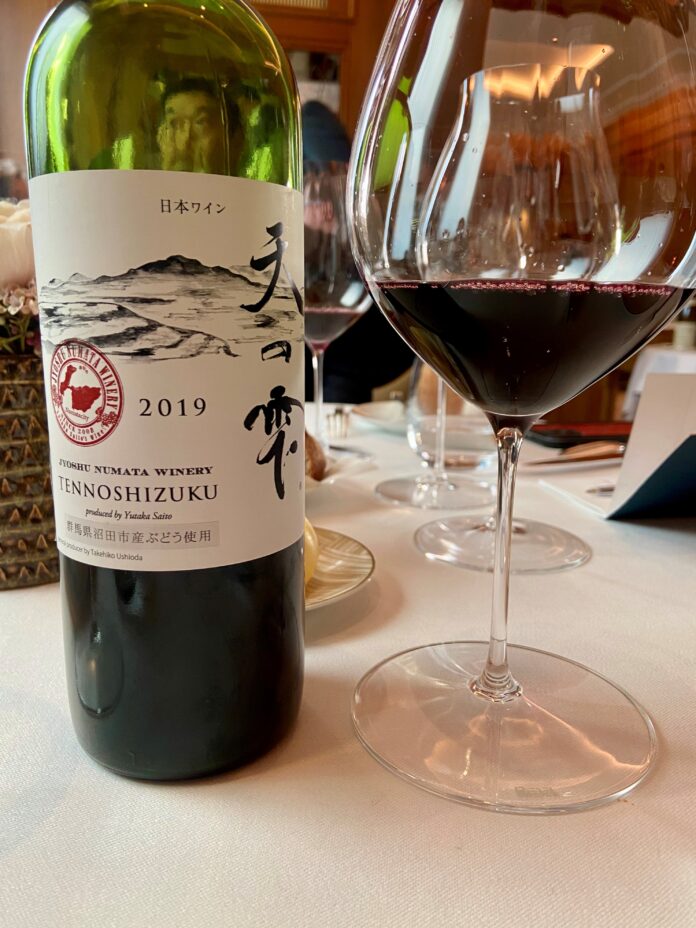


 Le luxe est aussi dans le flacon. Comme l’explique Benoît Gindraud, directeur qualité et vieillissement des eaux-de-vie et membre du comité de dégustation, pour obtenir sa cuvée Paradis, c’est un long voyage où la patience est reine. Ce cognac d’exception assemble des eaux-de-vie dont la plus jeune à au minimum 20 ans et le plus vieille autour de 70. Parmi les 4 000 lots dégustés chaque année, le travail consiste à sélectionner celles qui ont le potentiel d’y entrer. « Ce sont des eaux-de-vie qui nous marquent par une extrême finesse, une belle élégance, une structure tout en légèreté, mais très présente. Pour protéger cela, on doit les faire vieillir dans des fûts anciens pour éviter que l’on apporte trop de bois qui viendrait atténuer cette finesse et cette élégance, afin qu’elles évoluent d’elles-mêmes ».
Le luxe est aussi dans le flacon. Comme l’explique Benoît Gindraud, directeur qualité et vieillissement des eaux-de-vie et membre du comité de dégustation, pour obtenir sa cuvée Paradis, c’est un long voyage où la patience est reine. Ce cognac d’exception assemble des eaux-de-vie dont la plus jeune à au minimum 20 ans et le plus vieille autour de 70. Parmi les 4 000 lots dégustés chaque année, le travail consiste à sélectionner celles qui ont le potentiel d’y entrer. « Ce sont des eaux-de-vie qui nous marquent par une extrême finesse, une belle élégance, une structure tout en légèreté, mais très présente. Pour protéger cela, on doit les faire vieillir dans des fûts anciens pour éviter que l’on apporte trop de bois qui viendrait atténuer cette finesse et cette élégance, afin qu’elles évoluent d’elles-mêmes ».
























