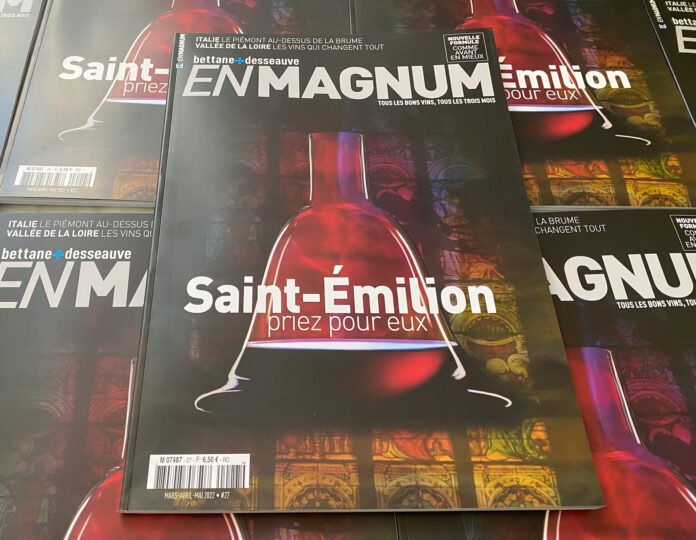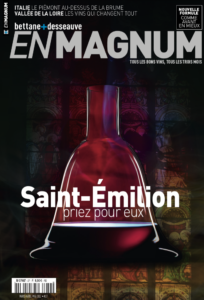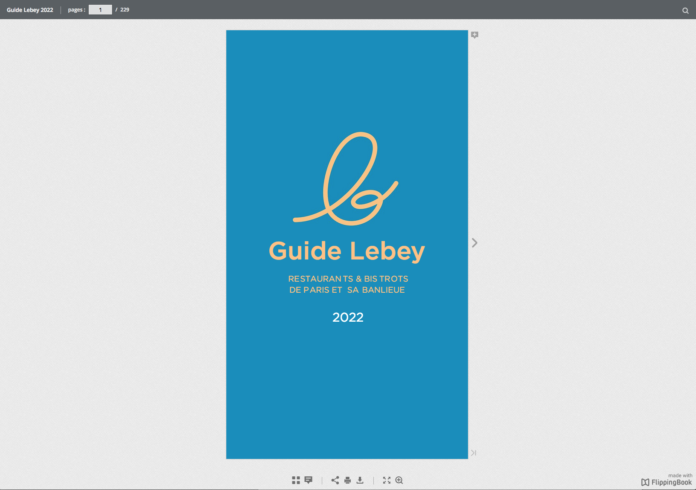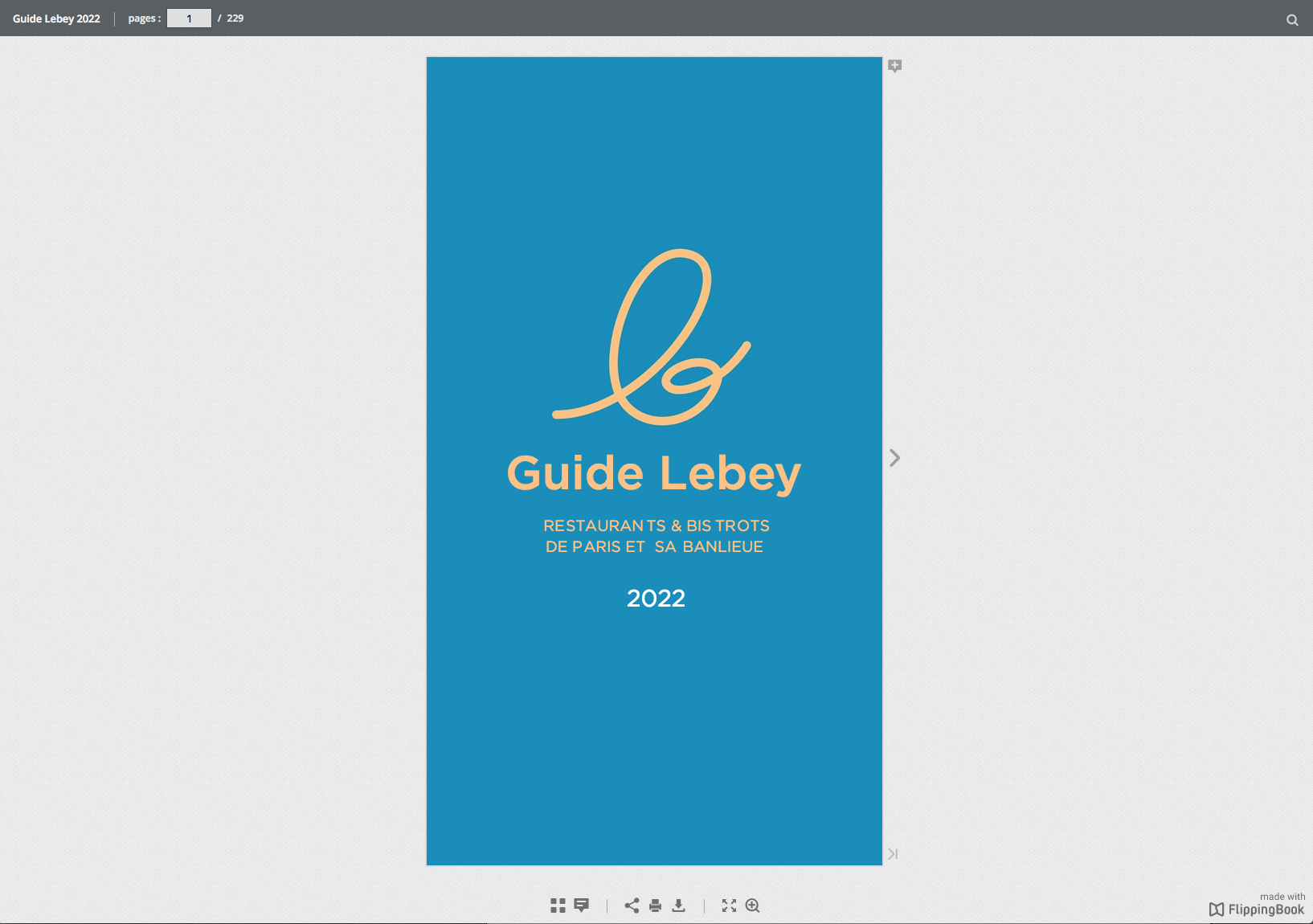Les Grands Jours ont enfin eu lieu. La dernière réunion datait de 2018, celle de 2020 avait été annulée. Producteurs, importateurs, distributeurs, se retrouvent pour goûter et faire le point sur les derniers millésimes. Notre envoyé spécial nous en parle
La Bourgogne du sud et du haut
La troisième journée des Grands Jours regroupe à Beaune le mâconnais et les hautes-côtes. Une Bourgogne « alternative » qui est un repère d’excellents rapports qualité-prix. Au sud, pouilly-fuissé est fier d’afficher ses 22 premiers crus depuis le millésime 2020. Ils représentent 193 hectares sur les 750 plantés de l’appellation. Une bonne façon de renforcer cette identité « terroirs » de la Bourgogne. La jeune présidente de l’AOC, Aurélie Cheveau, explique que tout le travail effectué par son prédécesseur a fait évoluer les mentalités dans l’appellation. Le désherbage chimique est désormais interdit dans les premiers crus. Elle présentait la gamme de l’Atrium, le caveau collectif des vignerons de Pouilly, qui embouteillent chaque année un vin de chacun des cinq villages qui composent l’appellation. Les petits voisins de pouilly-fuissé, soit les 32 hectares de Pouilly-Loché et les 52 hectares de Pouilly-Vinzelles sont eux aussi rentrés dans des démarches qualitatives.
Les hautes-côtes, de Beaune et de Nuits, sont des parcelles situées dans les petites vallées en haut du coteau. Elles regorgent d’excellents terroirs que leur altitude préserve des excès de chaleur. Avec l’augmentation des prix du foncier des gros villages de deux côtes, ces parcelles attirent d’excellents viticulteurs. Si Claire Naudin a été la première à revendiquer de faire des hautes-côtes d’excellentes qualité, avec des prix qui dépassent facilement les vingt Euros, d’autres lui emboîtent le pas. Boris Champy notamment avec des cuvées d’excellent niveau pour vingt à trente euros. Pas dit qu’à l’aveugle elles ne passent pas pour de très bons vins des villages d’en bas. D’autres s’inscrivent dans cette dynamique qualitative comme Agnès Paquet, Lucien Rocault ou Manuel Olivier. Son dernier projet c’est de planter 7 hectares dans les hauts de Dijon pour proposer du Bourgogne Dijon. Une future appellation à suivre…
Ses recommandations
Pouilly-Loché En Chambre 2017 Domaine Thibert
Un terroir plutôt argileux qui donne un vin tout en tension avec un côté pierreux.
Pouilly-vinzelles Les Quarts 2020 Domaine de la Soufrandière
Les frères Bret sont une valeur sûre. Le vin est très aromatique, mais reste nerveux et vif.
Bourgogne hautes-côtes de Beaune 2020 Le Clou 377 Boris Champy
Parcelle de pinot noir située à Nantoux sur des sols très pauvres. Nez très complet. Bouche vive, petits tanins, jolis arômes. Servez-le en carafe, tout le monde prendra ça pour un cru.
Bourgogne hautes-côtes de Beaune (chardonnay) 2020 Agnès Paquet
Deux parcelles situées à Meloisey et Baubigny. Le nez est très fin. La bouche est vive et saline.
La côte chalonnaise tire son épingle du jeu
Les côtes de nuits et de Beaune voyant leurs prix irrémédiablement monter, les amateurs vont souvent chercher leur bonheur ailleurs. La côte chalonnaise en profite beaucoup avec des villages comme Rully et Givry qui deviennent les nouveaux bons plans bourguignons. Quelques domaines de ces appellations ont vu leur notoriété exploser comme Vincent Dureuil-Janthial, Bruno Lorenzon ou Paul et Marie Jacqueson. Les prix ont monté, sans être dissuasifs.
Derrière ces têtes qui dépassent, des domaines moins médiatiques délivrent aussi des pinots noirs et des chardonnays de qualité à prix accessibles. C’est le cas de Claudie Jobart installée depuis 2005 à Demigny. Son père pépiniériste avait planté quelques vignes. Elle en a également récupéré du côté de sa mère à Pommard. Bien formée (diplôme d’oenologue à Dijon et master de l’OIV) elle vinifie aussi pour la maison Remoissenet. Quentin Joussier travaille lui avec son père Vincent. Ils possèdent quatorze hectares en côte chalonnaise et à Mercurey. Une partie des vignes est celle du Domaine de l’Évêché qui existe depuis le XVIIème siècle. Quentin a été élu Trophée des Jeunes Talents 2021. Signalons enfin le couple Baptiste et Clémence Dubrule-Bouton. Elle représente la cinquième génération. Extrêmement volubile, elle explique qu’ils sont revenus sur le domaine en 2010 pour en assumer pleinement la charge en 2016. Les 2020 sont très séduisants.
Les Grands Jours de Bourgogne sont aussi l’occasion de rendre visite à des domaines. Un crochet par le château de Mercurey nous a permis d’apprécier les très belles installations du domaine pour recevoir et faire déguster les vins. Aurore et Amaury Devillard, sœur et frère, recevaient leurs clients et importateurs à la fois sur le salon et sur place. En plus du Château et de leur domaine de côte de Nuits, la famille possède le Domaine de la Garenne à Mâcon.
Ses recommandations
Montagny premier cru Madeleine 2020 Claudie Jobart
Claudie garde bourbes et lies en fûts, ce qui donne du gras à ses vins. Si les arômes sont citronnés, le vin se distingue par son gras et sa complexité.
Mercurey Les Murgers 2020 Quentin et Vincent Joussier
Une belle gamme dans ce domaine. Ce mercurey est complet, avec de l’acidité et du gras, tout en restant fin.
Rully Clos de la Folie 2020 (chardonnay) Domaine de la Folie
Un rully qui ne voit que de la cuve. Ça donne un vin très vif, salin, agrume, très rafraichissant.
Mercurey En Pierrelet 2020 Château de Chamirey
Si le mercurey classique est assez riche, celui-ci apporte une vivacité supplémentaire très appréciable.
Côte de Beaune, la revanche des vins blancs
Ils étaient moins considérés que les rouges, mais ça n’est plus vraiment le cas. Les producteurs des deux grands crus corton (100 hectares) et corton-charlemagne (52 hectares) présentent leurs vins sous la bannière « Terroirs de Corton » depuis 1995. Sous des élevages parfois un peu amples, les corton-charlemagne 2020 ont du nerf. Mention spéciale au domaine Bonneau du Martray, repris en 2017 par un américain fortuné, Stanley Kroenke. Du coup, le jeune directeur général Thibault Jacquet « a les clefs de la voiture » comme il dit et les moyens de ses ambitions. Les prix ont beaucoup monté. La qualité aussi, et ça n’est pas fini. Les grandes maisons sont bien implantées sur cette colline. Jadot présentait un corton-charlemagne issu d’une belle parcelle de 1,8 hectares, mais encore marqué par son élevage. Le domaine Marguerite Carillon, qui appartient à Moillard, a limité le fût neuf. Son charlemagne est beaucoup plus vif. Celui de Drouhin aussi, même si les notes de boisé sont bien là. Enfin tirons notre chapeau à Faiveley, représenté par son directeur technique Jérôme Flous, qui tire de ses deux parcelles en propriété, en blanc comme en rouge, deux excellents vins vifs et structurés.
On file à Meursault où quelques stars de l’appellation ont fait le déplacement. Le Domaine des Comtes Lafon n’est pas réputé pour rien. Il présentait ses 2019, en blanc comme en rouge, qui ne font pas mentir la réputation de qualité du millésime. Dans un style plus fin et floral, les blancs 2018 du domaine Pierre Morey ne faisaient pas mentir l’excellente réputation du domaine. Au rayon nouveauté, on a pioché le domaine Buisson-Charles et le domaine Sylvain Dussort. Les premiers ont dit adieu aux anciens car Michel et Andrée Buisson sont décédés en 2020. Leur petit-fils Louis Essa travaille avec ses parents depuis 2019. Jolie gamme de 2020 dont les prix ne sont pas encore dissuasifs. Mais là comme ailleurs, la Bourgogne continue à appuyer sur l’accélérateur tarifaire. Quant à Sylvain Dussort, il a été rejoint par sa fille Anne-Caroline qui bouscule les habitudes de papa. Si elle a roulé sa bosse dans le commerce à Londres et à New-York, elle met aussi le nez dans la cuverie avec dans l’idée d’être un peu plus interventionniste pour gagner en précision.
Ses recommandations
Corton-Charlemagne 2018 Bonneau du Martray
Sans doute le plus cher (avant que celui du DRC ne vienne exploser les prix), mais une vraie référence. Très vif et droit pour le millésime.
Corton-charlemagne 2020 Faiveley
85 ares sur un terroir froid côté Ladoix. Très salin, très fin, très tendu, et pas délirant en prix. Leur monopole Clos des Cortons Faiveley en rouge est aussi une référence.
Meursault Les Tessons 2020 Buisson-Charles
Le meursault vieilles vignes est excellent. Celui-là est encore meilleur. Très aromatique et très long. Évidemment trop rare.
Bourgogne Côte d’Or Cuvées Les Ormes 2020 Sylvain Dussort
Si vous répugnez à mettre plus de 50 Euros dans un meursault, voilà une excellente alternative. 3 hectares dans le bas de meursault qui donnent un vin citronné, gras et long.