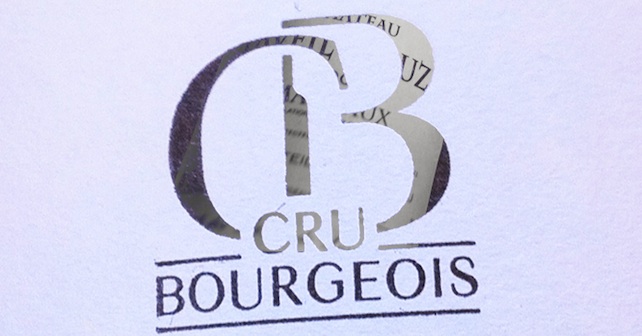C’est l’histoire d’une renaissance. Cinq ans après avoir perdu le droit de créer leur propre palmarès, les Crus bourgeois reviennent avec un diplôme unique, sans mention ni classement, dont la promotion 2013 vient tout juste d’être publiée. Tout a commencé le 26 février 2007. Ce jour là, la cour administrative d’appel de Bordeaux annulait le classement des crus bourgeois du Médoc, établi quatre ans plus tôt. Ébranlés par une décision qui semblait ainsi mettre fin à un statut né au XIXème siècle et pérennisé par trois mises à jours successives, en 1932, 1966 puis 1978, les « bourgeois » se sont pourtant remis courageusement remis au travail. En acceptant de renoncer au principe de classement, lequel est plus en plus contesté par ceux qui en sont exclus-le calssement des vins de Saint-Émilion ne cesse d’ailleurs d’être remis en cause. Au lieu de cela, les crus bourgeois ont choisi de n’être plus qu’un label, moins sujet à contestation. « Notre système est unique au monde », s’enthousiasme Olivier Cuvelier, propriétaire du Château le Crock et vice-président de l’Alliance des Crus bourgeois. Chaque propriétaire passe un examen annuel qui détermine l’attribution de la mention Cru bourgeois. Cette nouvelle démarche est, en effet, originale : elle ne s’adresse qu’à des propriétés qui en ont fait la demande et après un agrément délivré par des experts indépendants. Le château présente alors son vin à la dégustation qui est jugé à l’aveugle par un jury de six professionnels. Ceux-ci fondent leur jugement sur la dégustation préalable de plusieurs autres crus candidats et choisis de manière aléatoire comme référents. Si la note du candidat est supérieure ou égale à la moyenne de ces référents, celui-ci reçoit le label pour le nouveau millésime.
Ce mode de sélection, contrôlé par un bureau de vérification agréé, aide incontestablement à faire le tri dans une offre médocaine importante. Cette pointe de terre qui s’étend entre océan, Landes et estuaire en formant une longue bande d’une centaine de kilomètres, est d’abord connue par ses crus classés, cette aristocratie gravée dans le marbre en 1855. Mais ceux-ci ne représentent qu’une petite minorité des surfaces plantées. Soit qu’ils fussent jugés trop lointains à l’époque, comme l’ensemble de l’appellation Médoc et la partie nord de l’appellation du Haut-Médoc, situés au-delà de Saint-Estèphe, à 60 kilomètres de Bordeaux, soit qu’on les considérât comme secondaires à l’époque faute d’appartenir à un domaine réputé, de nombreux excellents terroirs méritent d’être reconnus. Lors de la sélection du millésime 2011 qui vient d’être rendue publique, les 256 crus bourgeois agréés représentent 28 millions de bouteilles correspondant à une surface cumulée de 4 400 hectares environ, soit 25 % de la surface viticole du Médoc. La renaissance du label est d’autant plus justifiée que sa crédibilité reste forte sur le marché français, comme le souligne Jean-luc Houdayer, directeur de magasin Système U à Bordeaux : « La mention a plus d’effet aujourd’hui car la clientèle a besoin de plus de repères dans un secteur où l’offre est de plus en plus nombreuse et diversifiée. Le client a aujourd’hui un regard différent des crus bourgeois qu’il perçoit désormais comme un produit de qualité. Qualité de production, mais aussi qualité gustative. »
Quatre ans après leur redémarrage, l’opération semble donc d’autant plus réussie qu’elle évite toute polémique. Mais le principal de ces nouveaux Crus bourgeois tient dans une homogénéité retrouvée en termes de prix, de style et de qualité : vers le bas, grâce à la dégustation annuelle mais aussi vers le haut, en se séparant de crus qui de par leur standing et leur prix élevé, se rapprochent des classés. Ce nouveau système a ainsi supprimé la mention « crus bourgeois exceptionnels » qui réunissait neuf crus dont pas un n’a souhaité revenir dans la nouvelle alliance :
« C’était certes un moteur, un fer de lance incroyable pour tous les crus bourgeois, témoigne ainsi Véronique Dausse, directrice générale de l’un d’entre eux, Phélan-Ségur. Mais nous demeurons solidaires de l’ensemble des crus, ce qui reste un signe de reconnaissance très important. »
Michel Bettane et Thierry Desseauve