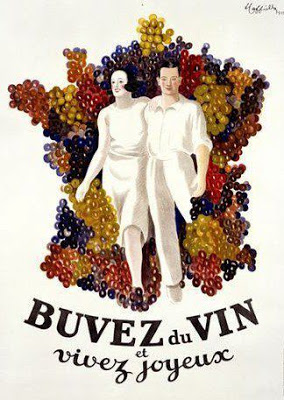C’est une première que le réseau de cavistes Nicolas propose, dans toute la France et en exclusivité, aux amateurs de portos. Il s’agit de réserver dès à présent chez son caviste les vintages 2011, un millésime tout juste mis en bouteille et agréé par l’Institut du vin de Porto, issus des quintas les plus réputées. Proposés par caisse de trois bouteille de 75 cl ou en magnum, ces vins de longue garde, à boire dans vingt ans, voire même dans quarante, seront disponibles à partir du 6 décembre 2013, jour de la Saint-Nicolas.
Portos en primeur
Beaune, visite du château.
Pour la cinquième année, la Maison Bouchard Père et Fils (destination labellisée Vignobles & Découvertes en 2012) permet au public de découvrir les secrets cachés dans les caves du Château de Beaune, au travers de visites guidées exclusives. Bénéficiant d’une longue expertise des climats de l’appellation beaune, Bouchard Père et Fils possède, dans les caves historiques de ce château acquis en 1820, une collection inégalée de 2 000 bouteilles du siècle dernier. Pendant une heure, et par groupe restreint à douze personnes maximum, les visiteurs sont accompagnés par un guide-conférencier à près de 10 mètres sous terre. Dans ces caves qui font partie des plus vastes de Beaune (4 000 m2 de galeries) plusieurs millions de bouteilles reposent dans des conditions idéales d’élevage et de vieillissement, loin de toute vibration et protégées des écarts de température par des murs dont l’épaisseur atteint sept mètres par endroits.
Si cette visite est l’occasion de prendre la mesure des siècles écoulés et du travail accompli par neuf générations de la famille Bouchard, succédées par la famille Henriot, également propriétaire en Champagne, à Chablis (William Fèvre) et en Beaujolais (Villa Ponciago à Fleurie), cette plongée au cœur de l’ancienne forteresse royale est aussi un voyage émouvant dans l’histoire du vin. Il y a là plusieurs milliers de bouteilles anciennes, dont une collection rare de grands vins mythiques antérieurs au phylloxéra, contemporains du règne de Napoléon III. Une dégustation commentée de six vins de la Maison clôture cette visite proposée dans deux langues, en français à 11 h et 15 h et en anglais à 10 h et 16 h, d’avril à novembre, du lundi au samedi. Réservation conseillée.
Bouchard Père & Fils, 15 rue du Château, 21 200 Beaune. Tél.: 03 80 24 80 45
Etes-vous œnographile ?
Si oui, vous serez sans aucun doute demain et/ou après-demain au château d’Aine à Azé (71) pour assister
aux Rencontres œnographiles européennes en Mâconnais. Si pas encore, apprenez que ces collectionneurs d’étiquettes de vins considèrent qu’elles font tout autant partie que le reste, contenant et contenu, de l’histoire
du vignoble et des hommes qui le travaillent depuis des siècles. Le site de l’association bourguignonne créée
en 1999 qui est à l’origine de ces rencontres (on peut y lire une petite histoire de l’étiquette joliment illustrée
par quelques images anciennes de maisons réputées), précise que les placomusophiles sont également les bienvenus ce week-end. Renseignements pris, ce sont les collectionneurs de plaques de muselet, plus connues sous le nom de capsules de champagne.
Quand le consommateur juge

Selon le baromètre sowine / SSI 2013, les consommateurs de vins ont besoin d’être rassurés avant d’acheter.
63 % se déclarent néophytes en matière de vin, 35 % amateurs éclairés et 2 % connaisseurs confirmés. Et la
très grande majorité des interrogés (80 %) estime qu’il est important de s’informer avant d’acheter du vin.
Au premier rang des critères privilégiés pour bien acheter, on trouve les conseils de l’entourage. C’est-à-dire
de consommateurs satisfaits.
C’est tout l’intérêt du Challenge prix+plaisir créé il y a trois ans que cette formule unique consistant à faire valider par des professionnels les choix d’un jury de consommateurs. Pour l’édition 2013, près de 200 consommateurs ont dégusté à l’aveugle les près de 700 vins inscrits au Challenge, par équipe de trois ou quatre, le temps d’une journée. Chaque équipe était encadrée par un référent, expert dégustateur. L’idée étant de mesurer le plaisir tiré de la dégustation de vins qui ne coûtent pas plus de dix euros, prix public, limite portée à vingt pour les champagnes.
Le palmarès complet (or, argent et bronze) sera publié sur MyBettaneDesseauve à partir du 21 mai.
Taillevent à Beyrouth

Thierry, Stéphane et Laurent Gardinier, les propriétaires de la Maison Taillevent (mais aussi du Château Phélan Ségur à Bordeaux et du Domaine des Crayères en Champagne) se sont associés avec la famille Fattal* pour ouvrir à Beyrouth, dans le quartier d’Achrafieh, une nouvelle boutique Les Caves de Taillevent. Six cents références extraites du livre de cave de Taillevent, complétées par le meilleur de la viticulture libanaise, y sont proposées et une place particulière est accordée à la dégustation, ainsi qu’à l’initiation aux secrets du vin. Pensé comme un bar
à vin intimiste, dont l’aménagement a été confié à l’architecte d’intérieur français Pierre-Yves Rochon, cet endroit permet de déguster au verre une sélection de vins du jour. C’est l’oenologue Paul Choueiry, diplômé de l’Université de Bourgogne, qui gère l’établissement avec une équipe d’experts présente pour sélectionner les vins en fonction d’un menu, aider l’amateur à se constituer une cave ou encore donner des cours de dégustation.
* Fondé en 1897, Le Groupe Fattal est agent-distributeur de produits de marque dans différents secteurs.
Pour ce qui concerne les alcools et spiritueux, le groupe représente depuis de nombreuses années Bacardi Martini, Rémy Cointreau, Evian, Badoit, Brown Forman et les vins libanais de Château Kefraya.
Les vins de la Ve République
L’Elysée met aux enchères une partie de sa cave. La vente, confiée à la maison Kapandji Morhange, aura
lieu à l’Hôtel Drouot à la fin du mois de mai. La sélection des 12 000 bouteilles concernées (soit un dixième de
la cave) a été effectuée par Virginie Routis, chef sommelière des lieux, et porte essentiellement sur Bordeaux
et la Bourgogne, même si la Loire, le Rhône ou encore la Champagne sont représentées. Créée en 1947, sous
la présidence de Vincent Auriol, la cave du Palais de l’Elysée a été réaménagée en 1995 afin de permettre une conservation optimale des vins. Il est question de renouvellement des vins avec une volonté de réinvestir le produit de la vente dans des vins « plus modestes » et d’attribuer le reste au budget de l’Etat. Les estimations s’échelonnent de 15 euros la bouteille à 2 200 euros (Petrus 1990) avec de nombreuses bouteilles à moins de 100 euros.
Ici, l’article du Monde, là le communiqué de Drouot.
Saint-Émilion, la polémique inutile vue par Michel Bettane

La dernière tentative de renouvellement du classement des vins de Saint-Emilion a donné à nouveau naissance à une procédure d’annulation pour manquement aux règles fixées, sans parler d’une plainte contre X pour prise illégale d’intérêt, déposée par trois châteaux déclassés, Croque-Michotte, Corbin-Michotte et La Tour du Pin-Figeac (Bélivier). Une plainte contre X, par définition, ne vise personne en particulier, mais très vite l’avocat des plaignants a laissé entendre que deux personnalités du vignoble, membres de l’I.N.A.O et propriétaires de crus soumis à ce classement, Hubert de Boüard (Château Angélus) et Philippe Castéja (Château Trottevieille) seraient au cœur de ce recours contre X. Leurs crus et d’autres crus, relevant de leurs activités de conseil ou de négoce, auraient été privilégiés lors du reclassement avec tous les gains financiers imaginables, inversement proportionnels aux pertes financières des trois crus déclassés. Bien entendu, des journalistes sont allés de leurs commentaires mêlant, hélas, l’allusion, la délation et l’idéologie aux faits.
Pour ma part, je tiens à séparer les deux actions.
Un recours contre le non-respect du règlement lié à la révision du classement est possible dans un état de droit et c’est à la justice de vérifier si ce règlement a été respecté à la lettre, conformément aux engagements pris par la commission de révision à la suite des déboires nés de la précédente révision et pour les mêmes raisons.
Une procédure contre X, c’est bien différent et bien plus grave. La première raison invoquée par les trois propriétés, à savoir la défense de leur patrimoine, ne tient absolument pas. Je rappelle ici qu’aucun centimètre carré de leur propriété ne leur a été ôté et que la qualité de leur terroir n’a été altérée par aucune action malveillante. Un classement révisable, même officialisé par la nation, n’est rien d’autre qu’un jugement provisoire sur une qualité et certainement pas une atteinte à la pérennité des crus relevant de ce classement. Il ne diminue en rien la qualité agronomique des terres et le potentiel de qualité du vin de ces trois crus. La seule motivation véritable est l’appât du gain lié à une spéculation possible sur le prix de vente de leur vignoble à condition de prouver que ce prix serait en baisse par rapport au cours d’avant la révision. Ou de dire ouvertement qu’il ne pourrait pas augmenter en cas de revente. Arrêtons net l’hypocrisie en la matière. Un cru non classé, qui n’a pas demandé à l’être, comme Tertre-Roteboeuf, mais dont la qualité et la réputation ont fait le tour de la planète, vaudrait à l’hectare largement celui de ces trois crus réunis même s’ils conservaient leur classement.
La meilleure manière de défendre la valeur d’un patrimoine viticole est de faire de la qualité et de la faire connaître. Des trois propriétés en question, l’une (Croque-Michotte) a soigneusement évité de présenter à la presse ses vingt derniers millésimes, ne les mettant pas en confrontation avec ses pairs du classement. J’ai beau consulter mes notes de dégustation depuis 1985, je n’ai aucune note concernant ce cru. La seconde (La Tour-du-Pin-Figeac) ne les pas souvent présentés, mais à chaque fois les vins ne brillaient pas par une personnalité ou un style digne de l’attente d’un vin produit sur un terroir aussi bien situé. Enfin, la troisième (Corbin-Michotte), de petite taille, mais d’une viticulture et d’une vinification suivies attentivement par une famille compétente peut montrer des vins de vingt ans d’âge au moins aussi bons que des crus ayant conservé leur classement, malgré quelques vins marqués par des goûts de réduction peu aimables, et qui ont d’ailleurs disparu dans les tout derniers millésimes. Je gage que la dégustation plus fréquente de ces derniers millésimes fera plus de bien à la réputation du cru que la procédure intentée.
Enfin, la seconde cause qui porte sur le soupçon de prise illégale d’intérêt de quelques voisins plus connus (je devrais dire plus « reconnus ») me semble indigne d’une communauté de vignerons civilisée. Deux des personnalités soupçonnables et, en tout cas, assez vite identifiées par les avocats et les journalistes, ne sont coupables que d’avoir donné de leur temps et de leur énergie au service de la réputation des crus de l’appellation. Cette procédure vraiment excessive va certainement décourager tous les bons viticulteurs de s’intéresser à leurs appellations et de prendre part à la gestion et à la défense de celles-ci.
Si j’étais le large sous-ensemble des crus ayant conservé leur classement ou conscients de l’avoir obtenu par leur travail, je porterai plainte nominalement contre les crus cherchant à faire croire au public que ce classement est l’œuvre d’un grand complot destiné à enrichir quelques notables du secteur.
Maintenant et sur le fond, faut-il classer des marques (un « château » n’est rien d’autre qu’une marque) ou des terroirs pour que ce classement ait valeur d’exemple ? La réponse est moins simple qu’on ne le croit. Aucun modèle théorique de définition agronomique d’un grand terroir n’existe. Les terroirs reconnus « grands crus » en Bourgogne ou en Alsace ont été l’objet de querelles constantes, relevant souvent des tribunaux et auxquelles seule a mis fin la puissance publique en officialisant des états de faits commerciaux. Et les géologues qui travaillent à la création de crus à la demande de l’I.N.A.O en ce moment dans la vallée du Rhône ou ailleurs sont en train de faire plus de mal que de bien, mais c’est une autre histoire. Je crois fermement que dans l’état de nos connaissances actuelles, c’est le vin qui prouve le grand terroir et non l’inverse.
Les prix des primeurs 2012, trois bonnes affaires

Après un premier tir nourri et précoce, les sorties des prix des primeurs 2012 marque une pause. Profitons-en pour nous intéresser à trois bonnes affaires.
Climens, 46,90 euros.
Pourquoi ? Parce que, jeune ou vénérable, c’est très bon (tout le temps) et pas cher du tout (cette année).
La Dauphine, 11,50 euros.
Pourquoi ? Parce qu’un fronsac, c’est une grande appellation méconnue et qu’à ce prix-là, La Dauphine va chercher des noises à nombre…lire la suite
« J’avoue que j’ai vécu »

Ce mot de Pablo Neruda est le titre d’un chapitre du dernier bouquin de Jacques Dupont que je viens de finir. Une charge contre la loi Évin argumentée et très documentée, du beau travail. Il rappelle tout, l’historique des ligues anti-alcooliques, l’histoire du vin en France, l’exemple américain et celui de l’Europe du nord, l’hégémonie médicaliste. Il pourfend les faux discours, dénonce les menteries pseudo-scientifiques, détricote les statistiques manipulées, les faiblesses d’État, le jmenfoutisme gauche-droite mélangées, les confusions soigneusement entretenues entre les alcools durs et le vin. Il démontre l’inefficacité de la loi Évin et de ses coûteux…lire la suite