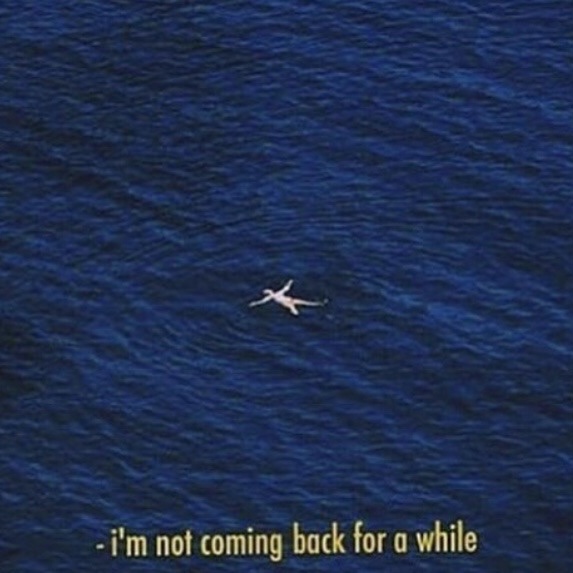Cet article est paru dans Le Nouveau Bettane+Desseauve 2023. Vous pouvez l’acheter sur notre site ici. Ou en librairie
Entre Gevrey-Chambertin et Chambolle-Musigny, Morey-Saint-Denis accusait un léger déficit de « fashion ». Tout s’arrange
Vignoble de la côte de Nuits situé entre les villages réputés de Gevrey-Chambertin et de Chambolle-Musigny, on pourrait imaginer que le village de Morey-Saint-Denis assemble les qualités de ces deux prestigieuses appellations. Il n’en est rien. Le style spécifique de ses vins est assez différent de ceux des crus voisins. Les gevrey-chambertin proposent souvent des expressions aromatiques intenses autour des fruits plutôt rouges. Les morey-saint-denis, davantage orientés vers les fruits noirs, sont un peu plus terriens et puissants que les chambolle-musigny. Bien sûr, cette généralité comporte mille exceptions en fonction des expositions, des pratiques culturales et de vinification. Difficile donc de définir en quelques mots ces vins d’appellations aussi complexes et passionnantes.
Dans l’ombre des voisins
L’appellation morey-saint-denis n’a pas la même notoriété que gevrey ou chambolle. Cette réputation moindre ne s’explique pas seulement par la taille du vignoble : 147 hectares contre 520 à Gevrey, mais Chambolle n’en compte que 170. Certes, Gevrey compte neuf grands crus, Morey peut s’appuyer sur cinq et Chambolle n’en compte que deux (dont les bonnes mares, partagées avec Morey). Réputés depuis des siècles, les noms de chambertin et musigny sont simplement ancrés avec davantage de force dans l’imaginaire collectif des amateurs que ne le sont les grands crus de Morey. L’histoire explique en partie cette relative méconnaissance. Avant la reconnaissance des appellations d’origine, la commercialisation des vins de Bourgogne se faisait essentiellement par le négoce. Celui-ci repliait assez systématiquement les vins de Morey sous l’une ou l’autre des appellations voisines, ce qui n’a pas œuvré à la notoriété du cru auprès du public. Et puis la célébrité ne se décrète pas en un jour. Malgré la reconnaissance officielle en tant qu’AOC en 1936, un morey se vendait encore à un prix inférieur de moitié à celui d’un gevrey il y a une cinquantaine d’années. Ce différentiel s’est aujourd’hui considérablement réduit.
Morey devient Morey-Saint-Denis
Sous Louis-Philippe, au début du XIXe siècle, le maire de Gevrey rebaptise sa commune, accolant le nom du célèbre grand cru de Chambertin à celui du village. D’autres adoptent l’idée. Aloxe avec le cru corton, Vosne avec romanée, Chambolle avec musigny, Puligny et Chassagne avec montrachet. Ce n’est qu’en 1927, après de longues délibérations du conseil de la commune, que Morey devient Morey-Saint-Denis. Le projet “Morey-Chambertin” avait essuyé le refus des voisins de Gevrey et les propositions “Morey-Tart” et “Morey-Lambrays” n’avaient pas convaincu les vignerons. Ces deux clos, en monopole ou quasi-monopole, ne les représentaient pas. Le grand cru bonnes mares, essentiellement situé à Chambolle, ne convenait pas non plus. Restait La Roche ou Saint-Denis. Ce dernier s’imposa finalement malgré l’opposition des anticléricaux.
Quel terroir, quel vignoble
Face au soleil levant, l’implantation du vignoble est très favorable à la culture de la vigne. L’exposition plein est le protège des vents d’ouest et permet un réchauffement rapide dès le petit matin. Le village de Morey-Saint-Denis se situe à l’entrée de deux vallées sèches qui génèrent des entrées d’air frais, la combe Grisard et la combe de Morey. Le climat est de type océanique tempéré avec des influences continentales et méridionales via le canal Rhône-Saône. Les températures sont plutôt fraîches avec une moyenne annuelle de 10,5 degrés. L’organisation des climats et des parcelles, aussi bien en appellation communale que pour les premiers et grands crus, peut être considérée comme un modèle du genre, faites de bandes assez uniformes nord-sud. En pied de coteau, on trouve les vignobles en appellation régionale bourgogne, entre 225 et 240 mètres d’altitude, plantés sur de faibles pentes. Dès que le coteau suit une pente de 3 à 5 %, entre 240 et 260 mètres d’altitude, l’appellation communale s’impose sur une large bande de vignes. Viennent ensuite les premiers crus, situés entre 260 et 275 mètres. Les grands crus sont implantés entre 270 et 320 mètres d’altitude, là où la pente augmente entre 5 et 25 %. Une nouvelle bande de premiers crus et d’appellation communale les surplombe entre 300 et 375 mètres, avec des pentes qui approchent parfois 20 %. Ce découpage en bandes assez homogènes pourrait impliquer une uniformité de goût dans les vins en fonction de l’implantation des vignes sur le coteau. La réalité est plus complexe. Les deux combes perpendiculaires au vignoble font varier l’exposition des vignes du nord-est au sud-est et génèrent des entrées d’air frais qui modifient le caractère de chaque parcelle et de leurs raisins.
Droit du sol
Le sol dominant de l’appellation communale morey-saint-denis est calcaire et argilo-calcaire, issus du Jurassique moyen. On retrouve au nord, en bas du coteau, des sols de marnes assez profonds. Plus au centre de cette zone, sur un cône de déjection, les sols très caillouteux permettent un drainage naturel bien adapté à la vigne. La partie la plus au sud est constituée de débris caillouteux et de marnes plus jeunes d’un point de vue géologique que celles de la partie nord. Les vignes en appellation communale, au-dessus des grands et premiers crus, sont plantées sur des sols peu profonds, calcaires et très pierreux. Les premiers crus de la partie nord de l’appellation (Charmes, Cheseaux ou Clos des Ormes) reposent sur des sols peu épais, argileux et caillouteux. Au centre (La Riotte, Les Blanchards), on retrouve les mêmes débris caillouteux qu’en appellation communale. Au sud (Les Ruchots, La Bussière), on trouve des calcaires mêlés avec des oolithes ferrugineux. La bande de terre nord-sud qui porte les grands crus repose sur des marnes et des calcaires qui donnent aux vins de la complexité, de la puissance et de l’intensité. Au-dessus des grands crus, la pente est marquée et le coteau monte plus haut qu’à Gevrey-Chambertin, jusqu’à 350 mètres. Le sol est constitué de calcaires et d’éboulis qui proviennent de l’érosion pendant l’ère quaternaire. Les premiers crus y sont moins puissants qu’en partie basse du coteau mais peuvent afficher une réelle élégance.
Les meilleurs premiers crus
On peut les caractériser selon leur situation dans le village. Au nord, en haut de coteau, Les Chaffots, Les Genavrières et Monts Luisants culminent à 330 mètres. La proximité de la combe de Morey apporte de la fraîcheur et donne aux vins des capacités de garde très importantes. Par dérogation, les blancs des Monts Luisants du domaine Ponsot sont issus de vignes d’aligoté. En pied de coteau, Chenevery, La Riotte, Les Blanchards, Clos Sorbé et Les Sorbès sont autant de climats donnant des vins gourmands, fruités et colorés et, probablement, l’expression la plus singulière de Morey. Au sud du village, Les Ruchots et La Bussière sont posés sur des terres plus profondes, sableuses, et s’apparentent aux chambolles qu’ils jouxtent. Les premiers crus perçus comme les plus qualitatifs lors de nos dégustations sont Les Charrières, La Bussière, Monts Luisants, Les Sorbès, La Riotte, Aux Cheseaux et Les Chaffots. Les Faconnières, Clos des Ormes, Les Millandes, Les Ruchots, Les Blanchards et Les Chenevery sont également de très bon niveau. À noter que le climat Très Girard, proche de l’hôtel du même nom, n’est classé qu’en appellation communale, mais Cécile Tremblay en propose une cuvée qui n’a rien à envier aux premiers crus installés.
Les grands crus
Avec le clos de la Roche, le clos Saint-Denis, le clos des Lambrays et le clos de Tart, le village compte le plus grand nombre de clos classés en grand cru parmi toutes les communes viticoles de Bourgogne.
Clos de la Roche (16,90 hectares)
Il est exploité par une vingtaine de producteurs. C’est aujourd’hui le plus important en surface des grands crus du village. Il ne couvrait que 4,67 hectares au XIXe siècle avant des ajouts successifs qui ont permis son agrandissement, non classés en première cuvée par le docteur Lavalle dans son fameux Classement des vins de Bourgogne de 1855, ouvrage toujours brillant et pertinent. Le clos-de-la-roche se remarque par ses caractéristiques minérales affirmées, sa sensation très terrienne et une ampleur supérieure à celle du clos-saint-denis voisin, avec cependant moins de longueur absolue.
Meilleurs producteurs : Arlaud ; Armand Rousseau ; Castagnier ; Chantal Rémy ; David Duband ; Domaine de la Pousse d’Or ; Domaines Albert Bichot ; Dominique Laurent ; Hubert et Laurent Lignier ; Jean-Claude Boisset ; Leroy ; Louis Jadot ; Michel Magnien ; Philippe et Vincent Lecheneaut ; Ponsot ; Virgile Lignier-Michelot.
Clos Saint-Denis (6,62 hectares)
Il a commencé à être planté au XIe siècle par les moines du chapitre de Vergy. Le plus petit des grands crus de Morey-Saint-Denis ne comptait que 2,12 hectares au milieu du XIXe siècle avant d’être agrandi avec des lieux-dits périphériques. Il donne un vin plus tonique que le clos-de-la-roche, plus en longueur qu’en épaisseur, toujours très raffiné et de grande garde.
Meilleurs producteurs : Amiot-Servelle ; Arlaud ; Bertagna ; Castagnier ; Dujac ; Heresztyn-Mazzini ; Laurent Ponsot ; Louis Jadot ; Marchand-Tawse ; Philippe Charlopin-Parizot ; Ponsot, Stéphane Magnien.
Clos des Lambrays (8,84 hectares)
Si son origine remonte à 1365, il n’a été classé grand cru qu’en 1981 en raison du désintérêt de sa propriétaire de l’époque lors des décisions de classement de l’Inao au milieu du XXe siècle. Il appartient aujourd’hui au groupe LVMH à l’exception d’une micro-parcelle. Elle est la propriété du domaine Taupenot-Merme qui en tire un peu plus d’une pièce chaque année. Le clos-des-lambrays est un vin d’une grande noblesse et d’une complexité rare au vieillissement. L’arrivée en 2019 du régisseur Jacques Devauges (ex-Clos de Tart) devrait encore faire progresser ce cru magique.
Clos de Tart (7,53 hectares)
Les moniales de Notre-Dame de Tart ont acquis une petite vigne au XIIe siècle. Passé de 6,17 hectares à sa surface actuelle, ce clos a la particularité d’avoir été planté dans un axe nord-sud selon les courbes de niveau et non en descendant la pente, ce qui le rend compliqué à travailler à cause des dévers, mais ce qui permet une maturation optimale des raisins. À son meilleur, il peut cumuler finesse superlative et puissance et c’est un vin de grande garde. Il a été racheté par la famille Pinault en 2017. Depuis cette reprise, ce domaine ne souhaite pas participer à nos dégustations comparatives. Nous ne pouvons donc pas faire un point précis sur son évolution récente.
Les Bonnes Mares (15,06 hectares)
Ce grand cru est à cheval sur Morey-Saint-Denis (1,52 hectares) et Chambolle-Musigny pour sa plus grande partie. Son nom pourrait venir des bonnes mères, les religieuses de Notre-Dame de Tart. Il est exploité par plus d’une vingtaine de producteurs. Le style terrien des vins diverge beaucoup d’un vigneron à l’autre. Celui de Bruno Clair, qui exploite toute la partie de Morey-Saint-Denis, peut atteindre une très grande complexité avec l’accent aérien du chambolle qu’il n’est pas.
Meilleurs producteurs (y compris ceux de la partie Chambolle-Musigny) : Bouchard Père et Fils ; Arlaud ; Bart ; Bruno Clair ; Castagnier ; Comte Georges de Vogüé ; Domaine d’Auvenay ; La Pousse d’Or ; La Vougeraie ; Denis Mortet ; Drouhin-Laroze, Georges Roumier ; Jacques-Frédéric Mugnier ; Philippe Charlopin-Parizot ; Robert Groffier Père et Fils ; Frédéric Magnien ; Jean-Luc & Paul Aegerter ; Joseph Drouhin ; Dominique Laurent ; Louis Jadot.
La sélection
Domaine Pierre Amiot et Fils, clos de la roche GC 2020
92
Une petite pointe acide le met au niveau des premiers crus du domaine pour l’instant. Il faudra le revoir.
2024>30
NC
Domaine Amiot et Fils, Les Ruchots, morey-saint-denis 1er cru 2020
92
De bonne constitution, il finit velouté.
2022>30
NC
Domaine Amiot-Servelle, clos saint-denis GC 2020
94
Coloré, racé, avec la note de ronce sauvage, épicé, très long en bouche, il finit salivant et sapide.
2025>35
NC
Domaine Arlaud, clos de la roche GC 2020
97
Ce clos est à la fois délicat et minéral, en prise avec la roche mère, le sol est peu profond ici. La sensation terrienne de l’attaque finit aérienne en fin de bouche. Remarquable expression du cru.
2025>35
NC
Domaine Arlaud, clos saint-denis GC 2020
96
La vigne vient du cœur original du clos. La finesse pure l’emporte sur la densité dans le millésime, la bouche légèrement saline termine aérienne.
2024>32
NC
Domaine Arlaud, Les Millandes, morey-saint-denis 1er cru 2020
94
Nez raffiné, bouche à l’unisson, dans le grand style de Morey avec cette profondeur terrienne sur les fruits noirs. Bouche racée.
2024>30
68 euros
Domaine Bertagna, clos saint-denis GC 2020
96
Racé, large, il est subtil, de grand style. Belle réussite. Avec un rien d’emphase en plus, il aurait dominé l’appellation dans le millésime.
2024>35
142 euros
Domaines Albert Bichot, Les Sorbès, morey-saint-denis 1er cru 2020
89
Beau nez de prune et réglisse, définissant une maturité encore plus poussée du raisin, très agréable en bouche.
2024>30
74 euros
Jean-Claude Boisset, clos de la roche GC 2020
91
Plus sévère dans son tannin que le Charmes Chambertin et un peu plus marqué par son boisé, encore trop jeune pour se dévoiler pleinement, attendre encore huit à dix ans.
2030>35
256 euros
Domaine René Bouvier, En la rue de Vergy, morey-saint-denis 2020
92
La vigne, plantée sur un sol peu épais, nous donne un 2020 bien parfumée, fumé avec un charme tactile impressionnant. Tannin en douceur.
2022>30
86 euros
Domaine Castagnier, clos de la roche GC 2020
96
Minéral, puissant, salin, épicé, on ne peut qu’admirer sa race indéniable.
2024>35
114 euros
Domaine Castagnier, clos saint-denis GC 2020
97
A ce stade plus long que large, à l’inverse du clos de la roche, salin, très racé, il finit explosif en fin de bouche. Une grande bouteille en perspective.
2024>35
114 euros
Domaine Philippe Charlopin-Parizot, clos saint-denis GC 2020
97
Superbe nez distingué autour des épices les plus nobles, du cassis, du fumé, bouche d’une immense délicatesse. Il finit sur les fleurs mauves à la manière d’un clos vougeot.
2025>35
NC
Domaine Bruno Clair, bonnes-mares GC 2020
97
Le fruit est profond mais le tannin est très élégant. Il joue le type chambolle qu’il n’est pas puisqu’il est récolté sur Morey. Il finit terrien et aérien, ce qui n’est pas un mince paradoxe.
2025>35
NC
Édouard Delaunay, Les Millandes, morey-saint-denis 1er cru 2020
92
Très joli arôme floral, avec une touche moka fumé bien présente sur certains secteurs du village, superbes sensations tactiles, un vin remarquablement séducteur, sans maquillage.
2024>30
95 euros
Domaine David Duband et François Feuillet, morey-saint-denis 2020
90
Légèrement orangé dans sa teinte, frais, une pointe végétale va s’affiner avec une petite garde.
2024>28
50 euros
Domaine David Duband et François Feuillet, Les Sorbès, morey-saint-denis 1er cru 2020
93
Racé, long, dynamique, on apprécie sa grande finesse de texture.
2022>30
74 euros
Camille Giroud, clos de la roche GC 2020
94
Très beau nez floral et minéral, corps plein, grande texture, grand soutien tannique, définition précise de ce grand terroir, une réussite mais il faudra savoir attendre. Apogée vers 2035.
2030>40
230 euros
Camille Giroud, Clos des Godelles, morey-saint-denis 1er cru 2020
93
On est ici au-dessus des Blanchards, la particularité de cette bouteille est de porter l’ancien nom du cru Le Village. Bouche ronde, suave, équilibrée, très morey dans son approche terrienne et raffinée.
2024>30
80 euros
Domaine Heresztyn – Mazzini, Les Millandes, morey-saint-denis 1er cru 2020
93
Situé sous le clos saint-denis, les millandes donnent en 2020 un vin tendu, sans concession, racé aux tannins puissants mais onctueux. Une belle garde est prévisible.
2025>32
72 euros
Maison Louis Jadot, clos saint-denis GC 2020
93
Le vin de dentelle, complètement individuel, subtil, salin, pas trop corpulent mais très long. Hélas la production est infime.
2025>35
NC
Domaine des Lambrays, clos des lambrays GC 2020
99
C’est un vin lent à se mettre en place. Dégusté lors des grands jours de Bourgogne 2020, il montrait une fougue juvénile qui s’est assagi en quelques mois. Il dévoile aujourd’hui son intensité et on perçoit de splendides notes florales, les épices les plus délicates. C’est une très grande bouteille en construction.
2024>35
600 euros
Domaine des Lambrays, Les Loups, morey-saint-denis 1er cru 2020
94
Dans le même esprit que le morey en appellaton communale avec la même gracilité de texture avec un peu plus de fond et de densité.
2024>32
110 euros
Domaine François Legros, Clos Sorbe, morey-saint-denis 1er cru 2020
94
Noir, profond, long et vineux, il est tout en nuances.
2024>30
39 euros
Domaine Michel Magnien, clos de la roche GC 2020
96
Remarquable bouteille aux tannins bien enrobés, aux accents terriens avec un fond superbe, somptueux comme peuvent l’être les meilleurs clos de la roche en grand millésime.
2025>35
230 euros
Domaine Michel Magnien, clos saint-denis GC 2020
97
Il y a match cette année au domaine entre le clos de la Roche et le clos Saint-Denis, chacun dans les archétypes de son climat en année faste. Ce clos Saint-Denis est un peu plus long que le clos de la Roche, plus large. Nous avouons une petite préférence pour le raffinement ultime du clos Saint-Denis 2020, mais de si peu.
2025>35
250 euros
Frédéric Magnien, Les Ruchots, morey-saint-denis 1er cru 2020
92
Bien que très proche de Chambolle-Musigny, ces Ruchots ont un caractère morey marqué, profond, terrien avec du fond. Les tannins bien enrobés sont de belle facture.
2025>32
75 euros
Nuiton-Beaunoy – Cave des Hautes-Côtes, Les Sionnières, morey-saint-denis 2018
89
En demi-corps dans le millésime, il sera vite prêt à boire. Il exprime déjà le style morey avec sa profondeur terrienne.
2022>27
NC
Domaine Odoul-Cocquard, Aux Cheseaux, morey-saint-denis 2020
91
Derrière sa profondeur et son expression intense des fruits noirs, nous avons apprécié le fond dont il dispose.
2022>30
NC
Manuel Olivier, morey-saint-denis 2020
91
Sur le graphite et la réglisse, ce morey est bien enrobé dans le style profond en texture et en arômes qu’affectionne le domaine. A garder un peu.
2024>30
NC
Domaine Christophe Perrot-Minot, En la Rue de Vergy, morey-saint-denis 2020
93
Superbe cuvée de Morey avec la profondeur attendue et un tannin enveloppé, caressant, sur les fruits rouges macérés avec cette sensation terrienne que l’on retrouve souvent dans les vins de l’appellation.
2022>32
NC
Domaine Chantal Rémy, clos de la roche GC 2019
96
Racé et plein, nous avons apprécié sa grande longueur minérale, sa finesse et sa représentativité du cru.
2024>35
132 euros
Domaine Chantal Rémy, Clos des Rosiers, morey-saint-denis 2019
94
Très plein, onctueux, racé, de grande finesse, la fin de l’élevage lui a été bénéfique.
2022>30
55 euros
Domaine Anne et Hervé Sigaut, Les Millandes, morey-saint-denis 1er cru 2020
94
Climat au centre de l’appellation qui en possède le type classique mais avec une élégance de texture particulière. Très raffiné.
2024>30
NC