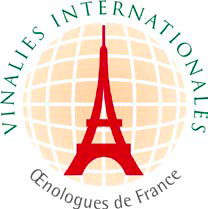Château Guiraud, grand cru classé en 1855, Sauternes
« Carnet de vendanges, lundi 10 septembre : début des vendanges pour le vin blanc sec. Cent vendangeurs arrivent au château et s’équipent de paniers et de sécateurs. A 12h30, toute l’équipe se retrouve dans la cour d’exploitation pour partager le déjeuner et repartir plein d’énergie. Les vendanges du G de Château Guiraud dureront deux semaines, la dernière presse est prévue pour le lundi 24 septembre. Mercredi 19 septembre : inquiets ! C’est la période nous direz-vous, mais vraiment le botrytis ne veut pas sortir et se mettre au boulot. Trop de sécheresse qui passerille certaines grappes et trop de froid la nuit. Nous n’avons eu que deux nuits tièdes et un peu de brouillard le matin pour enclencher le phénomène, du jamais vu depuis 1985. La nuit de mardi à mercredi pourtant réunissait les conditions idéales. Le thermomètre, fixé au-dessus des 10°C, attesta d’une accalmie dans une suite de nuits trop fraîches pour cette parfaite alchimie. Une pluie fine avait aussi préparé les rangs, que le soleil est venu assécher généreusement avec l’appui du vent. La nuit du botrytis semblait arrivée. Jeudi 20 septembre : le réveil est frais, trop frais. Le thermomètre à nouveau semble nous jouer des tours, mettant en péril les effets d’une nuit bienfaitrice. Le champignon cendré exige une parfaite trinité entre les éléments, eau, vent et soleil. 2012 nous rappelle que c’est cet équilibre si précieux qui fait le caractère exceptionnel de nos vins d’or. Nous patientons donc, et en attendant nous vendangeons des sémillons magnifiques pour de grands vins blancs secs. Vendredi 21 septembre : la nuit de l’espoir. Le thermomètre a fait preuve de clémence en restant au-dessus des 15°C. S’ensuivit une petite pluie matinale laissant place à un beau soleil l’après-midi… Bientôt les premiers coups de ciseaux pour le Sauternes ? Dimanche 23 septembre : deux nuits de suite à 15°C, avec un peu de pluie et du brouillard hier matin mais pas aujourd’hui dimanche… C’est compliqué, il semble que le raisin change. Va arriver le trou noir, c’est-à-dire le moment où l’on ne peut plus faire de sec et pas encore de grands Sauternes. J’espère qu’il va être court. Mardi 25 septembre : dernière matinée de vendanges pour les secs. Au total, neuf jours et demi de vendanges pour le G de Château Guiraud 2012. Dans le chai, les barriques gazouillent gentiment, quelle douce musique. Lundi 1er octobre : pleine lune hier soir. Il fait frais, on a rallumé le feu dans la cheminée du château cette nuit pour notre deuxième Fête de la Lune. Heureusement la météo prévoit un redoux, les sécateurs sont prêts, l’ami Botrytis pointe le bout de son nez. Encore quelques jours et on y va. Jeudi 4 octobre : retour dans les rangs de vignes, pour le sauternes cette fois. Un premier passage pour “nettoyer” la vigne. Les maternelles de Sauternes nous donnent un petit coup de mains dans la matinée. Mardi 9 octobre : on continue cette première phase de nettoyage et enfin les tout premiers lots de sauternes rentrent dans le chai. C’est délicat cette année, nous n’étions pas sûrs de vendanger hier soir encore. Les vendangeurs ont dû appeler ce matin à 7h30 pour savoir s’ils viendraient ou non. Vendredi 12 octobre : un temps souvent couvert le matin, du brouillard mais quelques éclaircies entre deux averses nous accompagnent depuis trois jours. La pluie nous arrête aujourd’hui. Jeudi 25 octobre : reprise après 12 jours de pluie non-stop. Lundi 29 à mercredi 31 octobre : trois jours qui sauvent la récolte. Jeudi 1er novembre : fin de vendanges à 10h. Nous nous sommes faits sortir des vignes par un grand abat d’eau sous un ciel tout noir. C’est donc fini. Nous avons vendangé des raisins botrytisés et concentrés uniquement les 29, 30 et 31 octobre. Avant et après il n’y a rien de très bon, même si cela est correct. Seuls ces trois jours nous ont permis de rentrer des lots dignes de Château Guiraud. Nous verrons après vinification si les promesses du raisin sont tenues. En trente ans, je n’ai vécu cela qu’en 92, 93 et 94. Heureusement ces trois belles et rares journées de la fin octobre vont nous permettre de faire un peu de premier cru. L’honneur est sauf ! »
Xavier Planty, directeur. Février 2013.
Domaine d’Arton, Côtes de Gascogne
« Cette année fut l’année des contrastes climatiques, épisode hivernal allant jusqu’à -18°C et 20 cm de neige, épisode printanier pluvieux et épisode estival aride avec moins de 20 mm de pluie en 2 mois. Le débourrement a été précoce avec un ralentissement dû à un printemps pluvieux et frais et à un orage de grêle touchant la propriété de plein fouet : 50% de pertes de récolte avec des parcelles touchées à plus de 70%. La floraison très étalée s’est faite dans de mauvaises conditions et la véraison des raisins a débuté aux alentours du 8 août. Cependant, sur une même grappe, elle démarrait pour certains grains avec presque deux semaines de décalage. Les vendanges ont commencé le 10 septembre avec le sauvignon pour se terminer le 29 octobre avec la récolte de nos petits mansengs destinés à l’élaboration de notre récolte tardive (Victoire). Elles se sont déroulées sous des conditions climatiques idéales alliant fraîcheur et beau temps. Malgré de multiples points faibles, le millésime 2012 se caractérise par des vins fruités et souples. Cette année a été difficile, tant pour maintenir l’état sanitaire de la vigne face à la forte pression des maladies que pour réussir à déterminer une date optimale de récolte. La dégustation des baies a été un des facteurs déterminants pour décider, in fine, des dates de vendange. »
Patrick de Montal, propriétaire. Janvier 2013.
Vignobles Lorgeril, Languedoc Roussillon
« Une pluviométrie normale a reconstitué les réserves des sols et a permis aux vignes de s’épanouir tout au long du cycle de végétation. Les années plus humides sont de belles années sous nos cieux ensoleillés. La vigne s’est donc bien développée avec une végétation bien équilibrée jusqu’à fin août, même si les grappes étaient petites, (peu de grains), ce qui a conduit à une récolte faible. L’été a été beau sans canicule, avec les trois beaux orages “habituels”, puis une forte pluie fin septembre qui a rafraîchi le temps. Les cieux clairs ont fait baisser la température de nuit, ce qui a conduit à une maturation lente malgré les après-midis chauds. Ces écarts de températures entre nuits et jours sont propices à une maturation lente et donc au développement des arômes. Nos zones d’altitude se révèlent plus précieuses encore. Le temps a été ensuite exceptionnellement beau pendant les vendanges. Notre équipe a été bien préparée et motivée par Bernard Durand, notre nouveau directeur technique qui nous a rejoint cet hiver, après avoir dirigé la production Sud de François Lurton pendant 17 ans. Nous avons vendangé pendant plus de six semaines, du 10 septembre (pour renforcer la vivacité des chardonnays et des rosés) jusqu’au 25 octobre pour les derniers cabernets et au 3 novembre pour la vendange tardive de chardonnay. Nous avons beaucoup plus vendangé de nuit pour conserver la fraîcheur. Il a fallu être spécialement vigilant sur l’état sanitaire cet été, la pression d’oïdium étant très forte. Un raté de traitement sur quelques rangées de chardonnay nous a donné une idée de ce qu’auraient pu être les dégâts. Bien sûr, nous poursuivons nos travaux en agriculture raisonnée et la traçabilité pour protéger l’état sanitaire, tout en utilisant le moins de produits possible et en travaillant les sols. Les cépages tardifs (mourvèdres en zones méditerranéennes, grenaches et cabernets en Cabardès) ont eu besoin de temps pour mûrir compte tenu de la fraîcheur de la fin de saison, mais le bon état sanitaire a permis d’attendre qu’ils finissent de mûrir lentement et complètement en offrant une belle fraîcheur. Ceci explique la longueur des vendanges. Ce millésime 2012 présente un très joli fruit, de la fraîcheur et un bel équilibre Les raisins bien mûrs ont livré spécialement facilement leurs couleurs, arômes et tanins. Les fermentations ont été régulières, sans accélération, ni écarts trop forts de température. Les vins sont donc encore davantage que l’année dernière “sur le fruit”, croquants et gourmands, frais et élégants, structurés avec des tanins bien fondus. Nous pensons avoir continué à progresser notamment à Ciffre, en Roussillon et à la Livinière, les vins exprimant une belle intensité de fruit par cette extraction douce. »
Miren de Lorgeril, propriétaire. Janvier 2013.
Château Lauzade, Côtes de Provence
« Ce millésime 2012 au vignoble nous aura fait passer des nuits blanches. En effet nous avons connu un hiver extrêmement rude, avec des températures ressenties proches de -15°C. Les traces les plus visibles se sont constatées avec certains bourgeons brûlés, et donc un manque de production. Au printemps, la grêle a frappé le département du Var et le couloir n’est passé qu’à quelques kilomètres de la propriété. Pour vous faire partager la violence du phénomène, apprenez que certains de nos voisins ont tout simplement perdu leur récolte ainsi que celle de l’année prochaine. De mai à août, nous avons enregistré très peu de pluie. Fort heureusement les ressources souterraines étaient bien fournies et la vigne, grâce aux soins apportés au vignoble, a réussi à trouver la force d’aller puiser cette eau et nous donner de beaux raisins à maturité. La pluie est arrivée en même temps que le mois de septembre, ce qui nous a fait gagner en volume ! Le mois d’août avait été consacré aux travaux de rénovation de notre chai béton et à l’installation de notre système de thermorégulation et les travaux ont fini quelques jours avant le début des vendanges. La combinaison de raisins sains et équilibrés et de cette avancée au chai a permis de dégager un temps non négligeable pour suivre de très près nos différentes cuvées. Les vendanges débutées fin août se sont arrêtées quelques jours, le temps de laisser la plante absorber la pluie, pour reprendre sans discontinuité jusqu’à la mi octobre. A cette heure, les assemblages des rosés et des blancs sont validés et laissent présager de grands moments de plaisir. Nous finalisons la seconde partie des futurs investissements nécessaires au chai, qui vont nous permettre de faire un bond considérable dans la manière d’apprivoiser ce terroir magnifique et unique. »
Nicolas Perolini, directeur d’exploitation. Janvier 2013.
Maison Louis Jadot, Bourgogne
« Ce millésime est né d’une saison chahutée, pleine de contraste de vie au rythme peu commun. Chaque année le vigneron assure le suivi régulier de ses ceps. En 2012, il a dû s’arcbouter et ne rien “lâcher” pour combattre et vaincre les maladies cryptogamiques et sauver la récolte. Mais ce travail laborieux a payé. La nature, dans une grâce mille fois appréciée, nous a préservé de la pourriture et les raisins rentrés aux chais étaient d’une qualité étonnante, rendant aux visages inquiets des hommes une clarté nouvelle. On parle de ce qui est sauvé. Car tous les aléas, avec la grêle en plus, ont divisé par deux la récolte. La réponse optimiste est dans la qualité des vins. Les rouges sont une belle réussite. Les blancs semblent prendre un chemin d’élégance, sans lourdeur, et ce style devrait plaire à tous. »
Jacques Lardière. Décembre 2012
Champagne Philipponnat Clos des Goisses, Champagne
« Les vendanges se sont achevées le lundi 24 septembre. Elles avaient commencé le 13, et s’étaient interrompues le 15 pour reprendre le 18 afin de rechercher la maturité idéale. Les gelées d’hiver, de printemps, le froid subi juste après la floraison et la coulure qui s’en est suivie ont eu raison des espoirs d’une belle récolte en quantité. L’humidité de juillet nous a donné beaucoup de travail, surtout pour le désherbage des sols, au tracteur équipé d’interceps, au cheval de trait et même à la sarclette manuelle dans les pentes ardues du Clos des Goisses. Le mildiou a encore fait sécher quelques grappes, mais le feuillage a été protégé et est resté bien vert, assurant une bonne photosynthèse. Le rendement n’atteint que 6 à 7000 kilos/hectare. En revanche, la qualité est au rendez-vous, particulièrement dans les pinots noirs, où la grande richesse en sucre, de 11°5 à plus de 12°, plus haute qu’en 1976, 2000 ou 2003, est associée à une acidité très satisfaisante, et plus agréable qu’en 1996. La proportion élevée d’acide malique permettra de conserver une belle fraîcheur, sans excès. Cela est à mettre au crédit d’un mois d’août exceptionnellement sec et à trois semaines de septembre également sèches, aux nuits froides. Le dicton est vérifié : août fait le moût. Originalité du millésime, le Clos des Goisses est un peu moins mûr qu’Ay (base de la cuvée 1522), car le rendement y est un peu meilleur, ce terroir très chaud ayant fleuri avant la vague de froid de juin. Les moûts sont clairs, peu ou pas oxydatifs, et présentent déjà une belle qualité aromatique. Les meilleurs fermentent déjà en fûts de bois. Cela promet de la pureté et de la longévité. Tout sera à confirmer dans quelques semaines à la dégustation des vins clairs, mais d’ores et déjà, ce que nous voyons se situe entre 2002 et 1959, grands millésimes s’il en fut en Champagne. »
Charles Philipponnat, président directeur général. Septembre 2012.
Chateau Marsyas, Liban
« Ici, l’automne fut très pluvieux et l’hiver froid et très neigeux. Les précipitions qui furent abondantes et supérieures à la moyenne se sont arrêtées très tôt, au début avril. S’en est suivi un printemps chaud et sec ainsi qu’un été assez chaud avec une fin juin assez caniculaire. Les rendements ont été diminués pour permettre une maturité des peaux correctes et éviter la déshydratation des baies. Les vendanges ont commencées la troisième semaine d’août et se sont terminées un mois plus tard. »
Karim et Sandro Saadé, propriétaires. Février 2013.